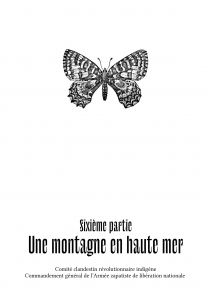Cet article contient les textes et les brochures des six communiqués Zapatistes,
les uns à la suite des autres.
Déroulez l’article pour les fichiers pdf des autres textes.
Sixième partie : une montagne en haute mer
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte sur le site La voie du Jaguar
Texte de la brochure :
Communiqué du Comité clandestin révolutionnaire indigène Commandement général de l’Armée zapatiste de libération nationale
Mexique,
5 octobre 2020,
Au Congrès national indigène-Conseil indigène de gouvernement,
À la Sexta nationale et internationale,
Aux Réseaux de résistance et de rébellion,
Aux personnes honnêtes qui résistent dans tous les coins de la planète,
Sœurs, frères, et adelphes,
Compañeras, compañeros y compañeroas,
Nous, peuples originaires de racine maya et zapatistes, nous vous saluons et vous disons ce qui est venu à notre pensée commune, en accord avec ce que nous voyons, entendons et sentons.
Premièrement. Nous voyons et entendons un monde malade dans sa vie sociale, fragmenté en des millions de personnes étrangères les unes aux autres , accrochées à leur survie individuelle, mais unies sous l’oppression d’un système prêt à tout pour assouvir sa soif de profit, même lorsqu’il est clair que sa voie va à l’encontre de l’existence de la planète Terre.
L’aberration du système et sa stupide défense du « progrès » et de la « modernité » se heurte à une réalité criminelle : les féminicides. L’assassinat de femmes n’a ni couleur ni nationalité, il est mondial. S’il est absurde et insensé que quelqu’un·e soit poursuivi·e, enlevé·e, assassiné·e en raison de la couleur de sa peau, de sa race, de sa culture, de ses croyances, on ne peut pas croire que le fait d’être une femme équivaille à une sentence de marginalisation et de mort.
Dans cette escalade prévisible (harcèlement, violence physique, mutilation et meurtre), et avec l’aval d’une impunité structurelle (« elle le méritait », « elle avait des tatouages », « que faisait-elle dans ce endroit-là à ce moment-là ? », « dans cette tenue, il fallait s’y attendre »), les meurtres de femmes n’ont pas d’autre logique criminelle que celle du système. De différentes couches sociales, de différentes races, d’âges allant de la petite enfance à la vieillesse, et dans des géographies très éloignées les unes des autres, la seule constante est le genre. Et le système est incapable d’expliquer pourquoi cela va de pair avec son « développement » et son « progrès ». Dans la révoltante statistique des décès, plus une société est « développée », plus le nombre de victimes est élevé dans cette authentique guerre de genres.
Et la « civilisation » semble nous dire, à nous les peuples autochtones : « La preuve de votre sous-développement réside dans votre faible taux de féminicide. Ayez vos mégaprojets, vos trains, vos centrales thermoélectriques, vos mines, vos barrages, vos centres commerciaux, vos magasins d’électroménager – avec une chaîne de télévision inclue – et apprenez à consommer. Soyez comme nous. Pour payer la dette de cette aide progressiste, vos terres, vos eaux, vos cultures, vos dignités ne suffisent pas. Il faut y ajouter la vie des femmes. »
Deuxièmement. Nous voyons et entendons la nature blessée à mort qui, dans son agonie, avertit l’humanité que le pire est encore à venir. Chaque catastrophe « naturelle » annonce la suivante et fait oublier, comme par hasard, que c’est l’action d’un système humain qui en est la cause.
La mort et la destruction ne sont plus désormais une chose lointaine, limitée par des frontières, respectant les douanes et les conventions internationales. La destruction, dans n’importe quel coin du monde, a des répercussions sur toute la planète.
Troisièmement. Nous voyons et entendons les puissant·es battre en retraite et se cacher derrière les soi-disant États-nations et leurs murs. Et, dans cet impossible bond en arrière, iels ravivent des nationalismes fascistes, des chauvinismes ridicules et des discours assourdissants. Face à cela, nous attirons l’attention sur les possibles guerres à venir : celles qui se nourrissent d’histoires fausses, creuses et mensongères, et qui convertissent nationalités et races en suprématies imposées par le biais de la mort et de la destruction. Dans les différents pays, le conflit se joue entre les contremaîtres et celleux qui aspirent à leur succéder, masquant le fait que le patron, le maître, le donneur d’ordre reste le même, et qu’il n’a pas d’autre nationalité que celle de l’argent. Pendant ce temps, les organismes internationaux dépérissent et se réduisent à de simples sigles, tels des pièces de musée – voire moins.
Au milieu de l’obscurité et de la confusion qui précèdent ces guerres, nous écoutons et observons comment toute lueur de créativité, d’intelligence et de rationalité est attaquée, assiégée et persécutée. Face à la pensée critique, les puissant·es requièrent, exigent et imposent leurs fanatismes. La mort qu’iels sèment, cultivent et récoltent n’est pas seulement la mort physique ; elle comprend également l’extinction de l’universalité propre à l’humanité – l’intelligence –, ses avancées et ses réalisations. De nouveaux courants ésotériques, laïques ou non, renaissent ou sont créés, déguisés en modes intellectuelles ou en pseudo-sciences ; et on prétend inféoder les arts et les sciences à des militantismes politiques.
Quatrièmement. La pandémie de Covid 19 a montré non seulement les vulnérabilités de l’être humain, mais aussi l’avidité et la stupidité des différents gouvernements nationaux et de leurs soi-disantes oppositions. Les mesures du plus élémentaire bon sens ont été méprisées, en pariant toujours que la pandémie serait de courte durée. Lorsque l’avancée de la maladie a pris des proportions toujours plus importantes, les chiffres ont commencé à se substituer aux tragédies. La mort a ainsi été convertie en un chiffre noyé quotidiennement au milieu des scandales et des déclarations. Un comparatif morbide entre des nationalismes ridicules. La moyenne des buts et des passes décisives pour déterminer quelle est la pire ou la meilleure équipe, la meilleure nation.
Comme le précise l’un des textes précédents, au sein du zapatisme nous avons opté pour la prévention et l’application de mesures sanitaires qui avaient alors été prises suite à la consultation de scientifiques qui nous ont guidé·es et nous ont offert leur aide, sans aucune hésitation. Nous, les peuples zapatistes, leur en sommes reconnaissant·es et nous avons voulu le démontrer ainsi. Après 6 mois d’application de ces mesures (masques ou équivalents pour se couvrir la bouche, distance entre les personnes, cessation des contacts personnels directs avec les zones urbaines, quarantaine de 15 jours pour les personnes ayant pu avoir été en contact avec des personnes infectées, lavage fréquent à l’eau et au savon), nous regrettons le décès de 3 camarades qui présentaient deux ou plusieurs symptômes associés au Covid 19 et qui avaient eu un contact direct avec des personnes infectées.
Huit autres compañeros et une compañera, morts pendant cette période, présentaient un des symptômes. Comme nous ne sommes pas en mesure de réaliser des tests, nous assumons qu’un total de 12 compañer@s sont morts à cause du coronavirus (des scientifiques nous ont conseillé d’assumer le fait que toute difficulté respiratoire serait due au Covid 19). Ces 12 disparitions relèvent de notre responsabilité. Ce n’est pas la faute de la 4T1 ni de l’opposition, ni des néolibéraux ni des néoconservateurs, ni des conspirations ni de complots. Nous pensons plutôt que nous aurions dû prendre encore davantage de précautions.
Actuellement, avec la disparition de ces 12 compañer@s sur les épaules, nous avons amélioré dans toutes les communautés les mesures de prévention, avec le soutien d’organisations non gouvernementales et de scientifiques qui, à titre individuel ou collectif, nous guident quant à la manière de mieux nous préparer pour affronter une possible résurgence. Des dizaines de milliers de masques (conçus spécialement afin qu’un probable porteur de virus ne puisse pas contaminer d’autres personnes, à bas prix, réutilisables et adaptés aux circonstances) ont été distribués dans toutes les communautés. D’autres dizaines de milliers sont fabriqués dans les ateliers de broderie et de couture des insurgé·es et dans les villages. L’emploi massif des masques, les quarantaines de deux semaines pour celleux qui pourraient être infecté·es, la distance et le lavage récurrent des mains et du visage avec de l’eau et du savon, ainsi que le fait d’éviter dans la mesure du possible d’aller dans les villes sont des mesures recommandées également aux adelphes membres des partis politiques, afin de contenir la diffusion des contagions et de permettre le maintien de la vie communautaire.
Le détail précis de notre stratégie passée et actuelle pourra être consulté au moment venu. Pour le moment nous disons, avec le souffle de vie parcourant nos corps, que, selon notre bilan (sur lequel nous pouvons probablement nous tromper), le fait d’affronter la menace en tant que communauté et non comme un problème individuel, ainsi que le fait de diriger notre effort principal en direction de la prévention nous permettent de dire, en tant que peuples zapatistes : nous sommes là ; nous résistons, nous vivons, nous luttons.
Et aujourd’hui, dans le monde entier, le grand capital prétend faire retourner les gens dans les rues pour leur faire réassumer leur condition de consommateur·ices. Parce que les problèmes qui les préoccupent, ce sont ceux du Marché : la léthargie dans la consommation de marchandises.
Il faut retourner dans les rues, oui, mais pour lutter. Parce que, comme nous l’avons dit précédemment, la vie, la lutte pour la vie, ce n’est pas un problème individuel, mais collectif. Et maintenant on se rend compte que ce n’est pas non plus un problème de nationalités, c’est un problème mondial.
Il y a plein de choses de cet ordre que nous observons et que nous écoutons. Et plein sur lesquelles nous réfléchissons. Mais pas seulement…
Cinquièmement. Nous entendons et voyons également les résistances et les rébellions qui, bien que réduites au silence ou oubliées, n’en demeurent pas moins essentielles, traçant des pistes pour une humanité qui se refuse à suivre le système dans sa marche forcée vers l’effondrement : le train mortel du progrès qui avance, arrogant et impeccable en direction du précipice, tandis que le machiniste oublie qu’il n’est qu’un employé de plus et croit naïvement que c’est lui qui décide du chemin, alors qu’il ne fait que suivre la prison des rails vers l’abîme.
Des rébellions et des résistances qui, sans oublier les pleurs pour les personnes disparues, s’acharnent à lutter pour – qui le dirait – la chose la plus subversive qu’il y ait en ces mondes divisés entre néolibéraux et néoconservateurs : la vie.
Des résistances et des rébellions qui comprennent, chacune à leur manière, à leur rythme et selon leur géographie, que les solutions ne reposent pas sur la foi dans les gouvernements nationaux, qu’elles ne se génèrent pas à l’abri des frontières et ne revêtent ni drapeaux ni langues différentes.
Des rébellions et des résistances qui nous apprennent à nous, tous et tou·tes, zapatistes, que les solutions pourraient se trouver en bas, dans les soubassements et les recoins du monde. Pas dans les palais gouvernementaux. Pas dans les bureaux des grandes entreprises.
Des résistances et des rébellions qui nous montrent que, si celleux d’en haut coupent les ponts et ferment les frontières, nous pouvons toujours naviguer le long des rivières et des mers pour nous rencontrer. Que la guérison, si elle existe, est mondiale ; qu’elle porte la couleur de la terre, du travail qui vit et qui meurt dans les rues et les quartiers, dans les mers et dans le ciel, dans les montagnes et dans leurs entrailles. Que, tout comme le maïs originaire, nombreuses sont ses couleurs, ses tonalités et ses sonorités.
Nous voyons et nous entendons tout cela, et plus encore. Et nous nous voyons et nous nous écoutons comme ce que nous sommes : un nombre qui ne compte pas. Parce que la vie ne compte pas, elle ne vend pas, elle ne fait pas la une des journaux, elle n’entre pas dans les statistiques, elle n’entre pas en compétition dans les sondages, elle n’a pas d’appréciation sur les réseaux sociaux, elle ne provoque pas, elle ne représente aucun capital politique, aucun drapeau de parti, aucun scandale à la mode. Qui se soucie qu’un petit, minuscule groupe d’originaires, d’indigènes vive, c’est-à-dire lutte ?
Parce qu’il se trouve que nous vivons. Que malgré les paramilitaires, les pandémies, les mégaprojets, les mensonges, les calomnies et les oublis, nous vivons. C’est-à-dire que nous luttons.
Et là dessus nous réfléchissons : nous continuons à lutter. C’est-à-dire nous continuons à vivre. Et nous pensons que, durant toutes ces années, nous avons reçu l’embrassade fraternelle de personnes de notre pays et du reste du monde. Et nous pensons que si la vie résiste ici et que malgré les difficultés elle arrive à fleurir, c’est grâce à ces personnes qui ont défié les distances, les démarches, les frontières et les différences culturelles et linguistiques. Grâce à elles, à eux, à elleux – mais surtout grâce à elles –, qui ont bravé et vaincu les calendriers et les géographies.
Dans les montagnes du Sud-est mexicain, tous les mondes du monde ont rencontré et rencontrent toujours une écoute dans nos cœurs. Leur parole et leur action ont alimenté la résistance et la rébellion, qui ne sont que la continuation de celles de nos prédécesseurs.
Des personnes avec les sciences et les arts pour chemin ont trouvé la manière de nous embrasser et de nous encourager, même à distance. Des journalistes, bobos ou non, qui ont relaté la misère et la mort d’avant, la dignité et la vie de toujours. Des personnes de toutes les professions et de tous les corps de métier qui, bien que ce soit beaucoup pour nous et peut-être pas grand-chose pour elleux, ont été là, et continuent à l’être.
Et nous pensons à tout cela dans notre cœur collectif, et il est arrivé à notre pensée que c’est le moment désormais pour que nous, zapatistes, nous rendions la pareille à l’écoute, à la parole et à la présence de ces mondes, proches ou lointains par la géographie.
Sixièmement. Et nous avons décidé ceci :
Qu’il est temps de nouveau que dansent les cœurs, et que ni leur musique, ni leurs pas ne soient ceux des lamentations et de la résignation.
Que différentes délégations zapatistes, hommes, femmes et autres de la couleur de notre terre, nous allons sortir pour parcourir le monde. Que nous prendrons la route ou que nous naviguerons jusqu’aux terres, aux mers et aux ciels lointains, à la recherche non pas de la différence, ni de la supériorité, ni de l’affrontement, et encore moins du pardon et du regret.
Nous partirons à la rencontre de ce qui nous rend égaux.
Non seulement l’humanité qui anime nos peaux différentes, nos différentes manières, nos langues et nos couleurs diverses. Mais aussi, et surtout, le rêve commun que nous partageons en tant qu’espèce, depuis que dans cette Afrique qui nous parait lointaine, nous avons commencé à faire notre chemin, bercés sur les genoux de la première femme : la recherche de la liberté, qui a animé ce premier pas… et qui continue depuis à faire son chemin.
Que la première destination de ce voyage planétaire sera le continent européen.
Que nous naviguerons jusqu’aux terres européennes. Que nous quitterons les terres mexicaines et lèverons l’ancre durant le mois d’avril de l’an 2021.
Que, après avoir parcouru différents recoins de l’Europe d’en bas à gauche, nous arriverons à Madrid, la capitale espagnole, le 13 août 2021 – 500 ans après la prétendue conquête de ce qui est aujourd’hui le Mexique. Et que, immédiatement après, nous reprendrons la route.
Que nous parlerons au peuple espagnol. Pas pour le menacer, ni pour lui faire des reproches, l’insulter ou exiger de lui quelque chose. Pas pour lui exiger qu’il nous demande pardon. Pas pour le servir, ni pour nous servir.
Nous irons dire au peuple d’Espagne deux choses simples :
Un : Que nous n’avons pas été conquis·es. Que nous sommes toujours en résistance et en rébellion.
Deux : Qu’iels n’ont pas de raison de demander qu’on leur pardonne quoi que ce soit. Il y en a marre que l’on joue avec le passé lointain pour justifier, avec démagogie et hypocrisie, les crimes actuels et toujours en cours : l’assassinat de militants, comme le frère Samir Flores Soberanes ; les génocides camouflés derrière des mégaprojets, conçus et réalisés pour la satisfaction du puissant – celui-là même qui flagelle tous les recoins de la planète – ; le soutien financier et l’impunité accordée aux paramilitaires ; l’achat des consciences et des dignités avec quelques centimes.
Nous autres, les zapatistes, nous NE voulons PAS retourner à ce passé, ni seul·es, ni encore moins guidé·es par celleux qui cherchent à semer la rancœur raciale, qui prétendent alimenter leur nationalisme désuet avec la soi-disant splendeur d’un empire, l’empire aztèque, construit sur le sang de ses semblables, et qui prétendent nous convaincre qu’avec la chute de cet empire, nous, les peuples originaires, avons été vaincus.
Ni l’État espagnol ni l’Église catholique n’ont à nous demander pardon de quoi que ce soit. Nous ne nous ferons pas l’écho des marioles qui se dressent sur notre sang et qui cherchent ainsi à cacher que leurs mains en sont souillées.
De quoi l’Espagne va-t-elle nous demander pardon ? D’avoir enfanté Cervantes ? José Espronceda ? León Felipe ? Federico García Lorca ? Manuel Vázquez Montalbán ? Miguel Hernández ? Pedro Salinas ? Antonio Machado ? Lope de Vega ? Bécquer ? Almudena Grandes ? Panchito Varona, Ana Belén, Sabina, Serrat, Ibáñez, Llach, Amparanoia, Miguel Ríos, Paco de Lucía, Víctor Manuel, Luis Eduardo Aute pour toujours ? Buñuel, Almodóvar et Agrado, Saura, Fernán Gómez, Fernando León, Bardem ? Dalí, Miró, Goya, Picasso, el Greco et Velázquez ? D’une partie du meilleur de la pensée critique mondiale, estampillée du Ⓐ libertaire? De la République ? De l’exil ? Du frère maya Gonzalo Guerrero ?
De quoi l’Église catholique va-t-elle nous demander pardon ? Du passage de Bartolomé de las Casas ? De Don Samuel Ruiz García ? D’Arturo Lona? De Sergio Méndez Arceo ? De la sœur Chapis ? De celui des prêtres, des sœurs religieuses et des séculiers qui ont cheminé aux côtés des autochtones, sans les diriger ni les supplanter ? De celui des personnes qui risquent leur liberté et leur vie pour défendre les droits humains ?
L’année 2021 sera celle des vingt ans de la Marche de la couleur de la Terre, que nous avons réalisée, aux côtés des peuples frères du Congrès national indigène, afin de réclamer une place dans cette nation qui s’écroule aujourd’hui.
Vingt ans après, nous naviguerons et nous marcherons pour dire à la planète que, dans le monde que nous percevons dans notre cœur collectif, il y a de la place pour toutes, tous, tou·tes. Tout simplement parce que ce monde n’est possible que si toutes, tous, tou·tes, nous luttons pour le mettre debout.
Les délégations zapatistes seront formées majoritairement par des femmes. Pas seulement parce que de cette manière elles veulent rendre l’embrassade qu’elles ont reçue durant les rencontres internationales antérieures. Mais aussi, et surtout, pour que nous, hommes zapatistes, manifestions clairement que nous sommes ce que nous sommes, et que nous ne sommes pas ce que nous ne sommes pas, grâce à elles, à cause d’elles et avec elles.
Nous invitons le Congrès national indigène – Conseil indigène de gouvernement à former une délégation pour nous accompagner et que soit ainsi plus riche notre parole pour l’autre qui lutte au loin. Nous invitons tout spécialement une délégation des peuples qui portent haut le nom, l’image et le sang du frère Samir Flores Soberanes, pour que sa douleur, sa rage, sa lutte et sa résistance arrivent plus loin.
Nous invitons les personnes qui ont pour vocation, engagement et horizon les arts et les sciences, à accompagner à distance nos navigations et nos pas. Et qu’ainsi elles nous aident à diffuser que c’est dans les sciences et les arts que repose la possibilité, non seulement de la survie de l’humanité, mais aussi d’un monde nouveau.
En résumé : nous partons pour l’Europe en avril de l’an 2021. La date et l’heure? On ne la connaît pas… encore.
Compañeras, compañeros, compañeroas,
Soeurs, frères, et adelphes,
Ceci est notre détermination :
Face à la puissance des trains, nos canots.
Face aux centrales thermoélectriques, les petites lueurs que nous, femmes zapatistes ont confié aux femmes en lutte dans le monde entier.
Face aux murs et aux frontières, notre navigation collective.
Face au grand capital, une parcelle de maïs en commun.
Face à la destruction de la planète, une montagne naviguant au petit matin.
Nous sommes zapatistes, porteur·euses du virus de la résistance et de la rébellion. En tant que tel·les, nous irons sur les cinq continents.
C’est tout… Pour l’instant.
Depuis les montagnes du Sud-est mexicain.
Au nom des femmes, des hommes et des autres zapatistes.
Sous-commandant insurgé Moisés.
Mexique,
Octobre 2020.
P.S. Oui, c’est la sixième partie et, tout comme le voyage, elle continuera en sens inverse. C’est-à-dire que suivra la cinquième partie, ensuite la quatrième, puis la troisième, suivie de la seconde avant de terminer par la première.
Cette traduction est un collage dé·genré de celle de Joani Hocquenghem sur La voie du Jaguar et celle, anonyme, publiée sur le site Enlace Zapatista.
Cinquième partie : Le regard et la distance à la porte
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte sur le site La voie du Jaguar
Texte de la brochure :
Octobre 2020
Supposons qu’il est possible de choisir, par exemple, où porte le regard. Supposons que vous puissiez vous libérer, ne serait-ce qu’un instant, de la tyrannie des réseaux sociaux qui imposent non seulement ce qu’on regarde et de quoi on parle, mais aussi comment regarder et comment parler. Donc, supposons que vous leviez le regard. Encore plus haut : de l’immédiat jusqu’au local, au régional, au national et au mondial. Vous le voyez ? Effectivement, un chaos, de la confusion, du désordre. Donc supposons que vous soyez un être humain ; bon, que vous n´êtes pas une application digitale qui, rapidement, regarde, classe, hiérarchise, juge et sanctionne. Donc vous, vous choisissez quoi regarder… et comment le regarder. Il se pourrait, c’est une supposition, que regarder et juger ne seraient pas la même chose. C’est-à-dire que vous ne faites pas que choisir où, mais que vous pouvez aussi décider comment. Changer la question de « Ça, c’est bien ou mal ? », à « Qu’est-ce que c’est ? ». Bien sûr, la première question nous emmène à un débat savoureux (mais y a-t-il encore des débats ?), et de là, au « Ça, ce n’est pas bien – ou mal – parce que c’est moi qui le dis ». Ou, peut-être, il y aurait débat sur ce qu’est le bien et le mal, et à partir de là les arguments et les citations en note de bas de page. Bien sûr, vous avez raison, c’est bien mieux que de recourir à des « likes » et des « pouces bleus », mais je vous avais proposé de changer de point de départ : choisir l’objectif de votre regard.
Par exemple : vous décidez de regarder les musulman·es. Vous pouvez décider, par exemple, entre celleux qui ont perpétré l’attentat de Charlie Hebdo ou entre celleux qui marchent aujourd’hui sur les routes de France pour réclamer, exiger, imposer leurs droits. Vu que vous êtes arrivé·es à ces lignes, il est très probable que vous optiez pour les « sans-papiers ». Bien sûr, vous vous sentez aussi dans l’obligation de déclarer que Macron est un imbécile. Mais, détournant le regard de ce rapide coup d’œil vers le sommet, vous vous remettez à regarder les occupations, les campements et les marches des migrant·es. Vous vous demandez combien iels sont. Cela vous paraît beaucoup, peu, trop ou pas assez. On est passé de l’identité religieuse à la quantité. Et donc vous vous demandez ce qu’iels veulent, pour quoi iels se battent ? Et là, vous décidez si vous vous servez des médias et des réseaux sociaux pour le savoir… ou si vous les écoutez. Supposons que vous pouvez leur poser des questions. Vous allez leur demander leur croyance religieuse ou combien sont-iels ? Ou leur demander pourquoi iels ont décidé d’abandonner leur terre pour se rendre à des terres et sous des cieux qui ont une autre langue, une autre culture, d’autres lois, d’autres modes de vie ? Peut-être qu’iels vous répondront avec un seul mot : guerre. Ou bien peut-être qu’iels vont vous détailler ce que cette parole signifie dans leur réalité à elleux. Guerre. Vous décidez d’enquêter : la guerre, où ça ? Ou encore mieux, pourquoi cette guerre ? Alors iels vous inondent d’explications: les croyances religieuses, les guerres territoriales, le pillage des ressources naturelles, ou purement et simplement, la stupidité. Mais vous ne vous en contentez pas et vous demandez à qui profite la destruction, le dépeuplement, la reconstruction, le re-peuplement. Vous trouvez les données de plusieurs entreprises. Vous faites des recherches sur ces entreprises et découvrez qu’elles sont présentes dans différents pays, qu’elles ne fabriquent pas seulement des armes, mais aussi des voitures, des fusées interstellaires, des micro-ondes, des services de messagerie postale, des banques, des réseaux sociaux, des « contenus médiatiques », des vêtements, des téléphones portables, des ordinateurs, des chaussures, des aliments bio ou pas, des entreprises de navigation, de ventes en ligne, des trains, des chefs de gouvernement et des cabinets, des centres de recherche scientifique – ou pas, des chaînes d’hôtels et de restaurants, des fast-food, des lignes aéronautiques, des centrales thermoélectriques et, évidemment, des fondations d’aide « humanitaire ». Vous pourriez dire, donc, que la responsabilité en revient à l’humanité ou au monde entier.
Mais vous vous demandez si le monde ou l’humanité ne sont pas responsables du même coup aussi de cette marche, de cette occupation, de ce campement de migrant·es, de cette résistance. Et vous en arrivez à la conclusion qu’il est possible, probable, que peut-être que le responsable, c’est un système tout entier. Un système qui produit et reproduit la douleur, qui l’inflige à celleux qui la subissent.
Maintenant retournez votre regard vers la marche qui parcourt les routes de France. Supposons qu’iels ne sont pas beaucoup, très peu, que c’est juste une femme qui porte son pitchounet. C’est important, là, sa croyance religieuse, sa langue, ses habits, sa culture, son mode de vie ? C’est important pour vous si c’est juste une femme qui porte son pitchounet dans ses bras ? Maintenant oubliez cette femme un moment, et concentrez votre regard seulement sur le bébé. C’est important de savoir si c’est un garçon, une fille, ou un·e autre ? La couleur de sa peau ? Peut-être découvrirez-vous, maintenant, que ce qui importe c’est sa vie.
Maintenant, allez plus loin, après tout vous êtes déjà arrivé jusqu’à ces lignes, donc quelques-unes de plus ne vous feront pas de mal. Ok, pas trop de mal.
Supposons que cette femme vous parle et que vous ayez le privilège de comprendre ce qu’elle vous dit. Vous pensez qu’elle, elle va vous exiger de lui demander pardon pour la couleur de peau de votre peau à vous, votre croyance, religieuse ou non, votre nationalité, vos ancêtres, votre langue, votre genre, votre mode de vie ? Allez-vous vous dépêcher de lui demander pardon d’être qui vous êtes ? Espérez-vous qu’elle vous pardonne et que vous puissiez mettre les compteurs à zéro et retourner à votre vie quotidienne ? Ou qu’elle ne vous pardonne pas et que vous vous disiez « bon, au moins j’aurais essayé et je regrette sincèrement d’être qui je suis » ?
Ou vous avez peur qu’elle ne vous parle pas, qu’elle ne fasse que vous regarder en silence, que vous sentiez que son regard vous demande: « Toi, qu’est ce que tu veux ? »
Si vous en arrivez à ce raisonnement-sentiment-angoisse-désespoir, alors, je suis désolé, c’est sans remède : vous êtes un être humain.
Une fois prouvé ainsi que vous n’êtes pas un bot, répétez l’exercice sur l’île de Lesbos ; au Rocher de Gibraltar ; sur le canal de La Manche ; à Naples ; sur le Río Suchiate ; sur le Río Bravo.
Maintenant déplacez votre regard et cherchez la Palestine, le Kurdistan, Euskadi et le Wallmapu. Oui, je sais, ça donne un peu le tournis… et ce n’est pas tout. Mais dans ces lieux, il y a celleux (beaucoup, peu, trop ou pas assez) qui luttent aussi pour la vie. Mais en fait il se trouve qu’iels conçoivent la vie inséparablement liée à leur terre, leur langue, leur culture, leur mode de vie. À ce que le Congrès National Indigène nous a appris à appeler « territoire », et qui n’est pas seulement un lopin de terre. Vous n’avez pas envie que ces personnes vous racontent leur histoire, leur lutte, leurs rêves ? Oui, je sais, ce serait peut-être mieux pour vous de vous en remettre à Wikipedia, mais ça ne vous tente pas de les écouter directement et d’essayer de les comprendre ?
Retournez maintenant à ce truc qu’il y a entre le Río Bravo et le Río Suchiate. Approchez-vous de ce lieu appelé « Morelos ». Un nouveau zoom de votre regard sur la commune de Temoac. Focalisez maintenant le regard sur la communauté d’Amilcingo. Vous voyez cette maison ? C’est la maison d’un homme qui, de son vivant, portait le nom de Samir Flores Soberanes. Là, face à cette porte, il a été assassiné. Son crime ? S’opposer à un mégaprojet qui représente la mort pour la vie des communautés auxquelles il appartient. Non, je ne me suis pas trompé en écrivant : Samir a été assassiné non pas parce qu’il défendait sa vie individuelle, mais celle de ses communautés.
Plus encore : Samir a été assassiné parce qu’il défendait la vie des générations qui ne sont même pas encore nées. Parce que, pour Samir, pour ses compañeras et ses compañeros, pour les peuples originaires regroupés dans le CNI et pour nous, les zapatistes, la vie de la communauté n’a pas lieu que dans le présent. Il s’agit, et surtout, de ce qui viendra. La vie de la communauté se construit aujourd’hui, mais pour demain. La vie dans la communauté est quelque chose qui se reçoit en héritage, donc. Vous croyez que le compte est bon si les criminel·les – intellectuel·les et matériel·les – demandent pardon ? Vous pensez que pour sa famille, son organisation, le CNI, nous, il serait suffisant que les criminels demandent pardon pour que nous nous sentions quittes ? « Excusez-moi, c’est moi qui l’ai montré du doigt pour que les hommes de main l’exécutent, j’ai toujours été une balance. Je vais voir si je me corrige, ou pas. Je vous ai déjà demandé pardon, maintenant abandonnez le piquet de lutte et on va terminer la centrale thermoélectrique, parce que sinon, on va perdre beaucoup d’argent ». Vous croyez que c’est ce qu’iels attendent, ce que que nous attendons, que c’est pour cela qu’ils luttent, que nous luttons ? Pour qu’iels demandent pardon ? Qu’iels déclarent : « Excusez-nous, oui, nous avons assassiné Samir et au passage, avec ce projet, nous assassinons vos communautés. C’est bon, pardonnez-nous. Et si vous ne nous pardonnez pas, ben on s’en fiche, le projet doit se réaliser » ?
Et il se trouve que celleux qui demanderaient pardon pour la centrale thermoélectrique sont les mêmes qui sont impliqué·es dans le mal nommé « Train Maya », les mêmes pour le « couloir transisthmique », les mêmes pour les barrages, les mines à ciel ouvert et les centrales électriques, les mêmes qui ferment les frontières pour empêcher la migration provoquée par les guerres qu’elleux mêmes nourrissent, les mêmes qui pourchassent les Mapuches, les mêmes qui massacrent les Kurdes, les mêmes qui détruisent la Palestine, les mêmes qui tirent sur les Afro-Américain·es, les mêmes qui exploitent (directement ou indirectement) des travailleur·euses dans n’importe quel coin de la planète, les mêmes qui cultivent et glorifient la violence de genre, les mêmes qui prostituent l’enfance, les mêmes qui vous espionnent pour connaître vos goûts et vous vendre ceci ou cela – et si rien n’est à votre goût, et bien on fera en sorte que cela vous plaise quand même -, les mêmes qui détruisent la nature. Les mêmes qui veulent vous faire croire, à vous, aux autres, à nous que la responsabilité de ce crime mondial en marche est la faute de nations, de croyances religieuses, de résistance au progrès, de conservateurs, de langues, d’histoires, de modes de vie. Que tout se résume à un individu… ou une individue (ne pas oublier la parité de genre).
Si on pouvait se rendre dans tous ces recoins de cette planète moribonde, que feriez-vous ? Bon, nous ne savons pas. Mais nous, hommes, femmes, autres zapatistes, nous irions apprendre. Bien sûr, nous irions aussi danser, mais l’un n’exclut pas l’autre, je crois. Si nous en avions l’opportunité, nous serions prêt·es à tout risquer, tout. Pas seulement notre vie individuelle, mais aussi notre vie collective. Et si cette possibilité n’existait pas, nous lutterions pour la créer. Pour la construire, comme s’il s’agissait d’un navire. Oui, je sais, c’est une folie. C’est impensable. Qui oserait penser que le destin de celleux qui résistent à la centrale thermoélectrique, dans un tout petit recoin du Mexique, pourrait intéresser la Palestine, les Mapuches, les Basques, les migrant·es, les Afro-Américain·es, la jeune environnementaliste suédoise, la guerrière kurde, la femme qui lutte ailleurs dans le monde, le Japon, la Chine, les Corées, l’Océanie, la mère Afrique ?
Ne devrions-nous pas, au contraire, aller par exemple à Chablekal, dans le Yucatán, au local de l’Equipo Indignación1 et leur réclamer « hey, vous avez la peau blanche et vous êtes croyant·es, demandez pardon ! » ? Je suis presque sûr qu’iels répondraient « Pas de souci, mais attendez votre tour, parce qu’en ce moment nous sommes occupé·es à accompagner celleux qui résistent au Train Maya, celleux qui subissent la dépossession, la persécution, la prison, la mort ». Et iels ajouteraient :
« De plus, nous devons affronter l’accusation lancée par le dirigeant suprême comme quoi nous sommes financé.e.s par les Illuminati dans le cadre d’un complot interplanétaire qui prétend stopper la 4T2 ». Ce dont je suis sûr, c’est qu’iels utiliseraient le verbe « accompagner », et pas « diriger », « commander », « mener ».
Ou plutôt devrions-nous envahir les Europes au cri de « rendez-vous visages-pâles ! », et détruire le Parthénon, le Louvre et le Prado, et, au lieu de sculptures et de peintures, tout remplir de broderies zapatistes, particulièrement de masques zapatistes – qui, soit dit en passant, sont efficaces et très jolis -, et au lieu de pâtes, de fruits de mer et de paellas, imposer la consommation de maïs, de cacaté, et de yerba mora ; au lieu de sodas, de vins et de bières, du pozol obligatoire ; et si quelqu’un sort dans la rue sans passe-montagne : amende ou prison (en option, parce qu’il faut quand même pas exagérer), et exclamer : « Alors, pour les rockeurs, marimba obligatoire ! Et à partir de maintenant, des cumbias exclusivement, pas de reggaeton (ça vous tente, hein ?) ! Tiens, toi, Pancho Varona et Sabina, les autres, vous faites les chœurs, commencez avec «Cartas Marcadas», et en boucle, même si on rallonge jusqu’à dix, onze heures, minuit, une, deux ou trois heures3, et basta, car demain il faut se lever tôt ! Hey, l’autre toi, ex-roi en cavale, laisse en paix ces éléphants et mets-toi au travail en cuisine ! Soupe de courge pour toute la cour ! » (je sais, ma cruauté est exquise) ?
Alors, dites-moi : croyez-vous que le cauchemar de celleux d’en-haut c’est qu’on les oblige à demander pardon ? Ce qui peuple leurs cauchemars, ce sont des horribles choses telles que leur disparition, le fait qu’iels n’aient plus d’importance, qu’on ne tienne pas compte d’elleux, qu’iels ne soient rien, que leur monde s’effrite sans à peine faire de bruit, sans que personne ne se souvienne d’elleux, sans qu’on leur érige des statues, des musées, des cantiques, des jours de fête ? Ne serait-ce pas plutôt qu’iels paniquent face à la possible réalité ?
Ce fut l’une des rares fois où le feu SupMarcos n’avait pas recouru à une métaphore cinéphile pour expliquer quelque chose. Parce que, vous n’êtes pas censé le savoir, ni moi vous le raconter, mais le défunt pouvait relier chacune des étapes de sa courte vie à un film particulier. Ou accompagner une explication sur la situation nationale ou internationale d’un « comme dans tel film ». Bien sûr, il devait parfois réécrire le scénario pour le faire correspondre à sa narration. Comme la plupart d’entre nous n’avait pas vu le film en question, et que nous n’avions pas de réseau pour consulter wikipédia sur nos portables, et bien nous le croyions. Mais ne nous dévions pas du sujet. Attendez, je crois qu’il l’avait écrit sur l’un de ces papiers qui saturent sa malle à souvenirs… Le voilà ! Donc voici :
« Pour comprendre notre engagement et la taille de notre audace, imaginez que la mort est une porte à franchir. Il y aura une grande quantité et variété de spéculations concernant ce qu’il y a derrière la porte: le ciel, l’enfer, les limbes, le néant. Et sur ces options, des dizaines de descriptions. La vie, alors, pourrait être conçue comme le chemin vers cette porte. La porte, la mort donc, serait alors un point d’arrivée… ou une interruption, l’entaille impertinente de l’absence blessant l’air de la vie.
On arriverait à cette porte, alors, par la violence de la torture et le meurtre, l’infortune d’un accident, le douloureux entrebâillement de la porte lors d’une maladie, lors de fatigue ou de désir. En effet, bien que la plupart des fois on arrivait à cette porte sans le vouloir ni le prétendre, il serait aussi possible que ce soit choisi.
Pour les peuples originaires, aujourd’hui zapatistes, la mort était une porte qui surgissait presque au tout début de la vie. Les enfants s’y confrontaient avant l’âge de cinq ans, et la traversait entre fièvres et diarrhées. Ce que nous avons fait le premier janvier 1994, c’est tenter d’éloigner cette porte. Bien sûr, il a fallu être disposé·es à la traverser pour y arriver, bien que nous ne le souhaitions pas. Depuis, tout notre effort a consisté, et consiste, à éloigner la porte le plus possible. « Allonger l’espérance de vie », diraient les spécialistes. Mais d’une vie digne, ajouterions-nous. L’éloigner jusqu’à arriver à la mettre de côté, mais beaucoup plus loin sur le chemin. C’est pour cela qu’au début de notre soulèvement, nous avions dit que « pour vivre, nous mourons ». Car si nous ne léguons pas la vie, c’est-à-dire le chemin, à quoi bon vivons-nous ? »
Léguer la vie.
C’est ce qui précisément inquiétait Samir Flores Soberanes. Et c’est ce qui peut résumer la lutte du Front de Peuples en Défense de l’Eau et de la Terre de Morelos, Puebla et Tlaxcala, dans sa résistance et sa rébellion contre la centrale thermoéléctrique et le soi-disant « Projet Intégral Morelos ». A leurs demandes de stopper et faire disparaître un projet mortifère, le mauvais gouvernement répond en argumentant que beaucoup d’argent serait perdu.
Là-bas, dans l’État de Morelos, se résume la confrontation en cours dans le monde entier : argent versus vie. Et dans cette confrontation, dans cette guerre, aucune personne honnête ne devrait rester neutre : soit avec l’argent, soit avec la vie.
On pourrait donc conclure que la lutte pour la vie n’est pas une obsession chez les peuples originaires. C’est plutôt… une vocation… et une vocation collective.
Bon. Salut, et n’oublions pas que pardon et justice ne sont pas la même chose.
Depuis les montagnes des Alpes, en doutant
de quoi envahir en premier : l’Allemagne, l’Autriche,
la Suisse, l’Italie, la Slovénie, Monaco, le Liechtenstein?
Nan, je blague… ou pas?
Le SupGaleano,
qui s’exerce à son gribouillis le plus élégant.
Mexique,
Octobre 2020.
Carnet de notes du Chat-Chien
Le radeau.
«Et dans les mers de tous les mondes qu’il y a dans le monde, on a vu des montagnes qui se mouvaient sur l’eau et, sur elles,
le visage caché, des femmes, des hommes et des autres ».
«Chroniques du lendemain». Don Durito de la Lacandona. 1990.
Après une troisième tentative loupée, Maxo resta dubitatif puis, après quelques secondes, il s’exclama : « Faut plus de cordes. ». « Je te l’avais dit », assura Gabino. Les restes du radeau flottaient épars, s’entrechoquant les uns aux autres au rythme du courant du fleuve qui, faisant honneur à son nom de « Colorado », teintait ses eaux de la terre rouge qu’il arrachait des rives.
Ils appelèrent alors un escadron de miliciens de cavalerie qui arriva au son de la Cumbia sobre el río suena, du maestro Celso Piña. Ils se mirent à attacher des cordes bout à bout pour faire deux longues sections. Ils envoyèrent une équipe de l’autre côté du fleuve. Une fois les cordes attachées au radeau, les deux groupes pourraient contrôler la trajectoire du navire, cette poignée de troncs traînée par un fleuve qui n’était même pas au courant de la tentative de navigation, sans qu’il ne finisse en miettes.
L’absurdité de la situation en cours avait surgi suite à la décision de l’invasion… pardon, la visite aux cinq continents. Et puis tant pis, c’est comme ça. Car, au moment du vote et quand au final le SupGaleano leur a dit : « Vous êtes fous, nous n’avons pas de bateau », Maxo avait répondu : « On en construit un ». Aussitôt, iels avaient commencé à faire des propositions.
Comme tout ce qui est absurde en terres zapatistes, la construction du « bateau » ameuta la bande de Defensa Zapatista.
« Les compañeras vont mourir misérablement », jugea Esperanza avec son légendaire optimisme (la petite fille avait trouvé ce mot dans un livre et elle avait compris qu’on l’utilisait pour faire référence à quelque chose d’horrible et irrémédiable, et elle l’utilise à tout bout de champ : « Mes mamans m’ont peigné misérablement », « La maîtresse m’a rendu une copie misérablement corrigée », etc), quand, à la quatrième tentative, le radeau s’effilocha presque immédiatement.
« Et les compañeros aussi», se sentit obligé d’ajouter Pedrito, doutant de si la solidarité de genre était nécessaire dans ce destin… misérable.
« Tu parles », répliqua Defensa. « Des compañeros de toutes façons ça se remplace, mais des compañeras… où est-ce qu’on va en trouver ? Des compañeras, de vraies compañeras, pas n’importe lesquelles ».
La bande de Defensa était placée stratégiquement. Non pas pour contempler les vicissitudes des comités de construction du bateau. Defensa et Esperanza tenaient par les mains Calamidad qui avait déjà tenté par deux fois de se jeter dans la rivière pour sauver le radeau, mais les deux fois elle avait été taclée par Pedrito, Pablito et Amado le bienaimé. Le cheval borgne et le chat-chien avaient été court-circuités dès le départ. Ils s’inquiétaient pour rien. Quand le SupGaleano vit la horde arriver, il assigna trois pelotons de miliciennes sur le bord du fleuve. Avec son habituelle diplomatie et le sourire aux lèvres, le Sup leur dit : « Si cette fillette arrive dans l’eau, vous mourrez toutes ».
Après le succès de la sixième tentative, les comités essayaient de charger le radeau de ce qu’ils avaient appelé « des biens de première nécessité » pour le voyage (un espèce de kit de survie zapatiste) : un sac de tostadas, du sucre de canne, un petit sac de café, quelques boules de pozol, une strère de bois, un bout de bâche pour si jamais il pleut. Iels restèrent là, contemplatif·ves, et se rendirent compte qu’il manquait quelque chose. Évidemment, iels ne mirent pas longtemps à apporter la marimba.
Maxo alla vers le Monarque et le SupGaleano qui révisaient quelques projets dont je vous parlerai à une autre occasion et dit : « Eh, Sup, il faut que tu leur envoies une lettre à celleux de l’autre côté : qu’iels cherchent des cordes et qu’iels les mettent bout à bout pour qu’elles soient bien longues, et qu’iels les lancent par ici et comme ça on pourra bouger le «bateau» depuis les deux côtés. Mais il faut qu’iels s’organisent, parce que si chacun·e lance une corde de son côté, et bien elles n’arriveront pas. Il faut qu’iels les mettent bien bout-à-bout quoi, et de façon organisée ».
Maxo n’attendit pas que le SupGaleano soit sorti de son désarroi et qu’il tente de lui expliquer qu’il y avait une grande différence entre un radeau fait de troncs attachés avec des lianes, et un bateau pour traverser l’Atlantique.
Maxo s’en alla superviser l’essai du radeau chargé de tous les bagages. Iels discutèrent de qui allait monter pour l’essayer avec des gens à bord, mais le fleuve faisait un bruit de fouet effrayant, alors il fut décidé de faire un mannequin et de l’arrimer au milieu du bateau. Maxo était l’équivalent d’un ingénieur naval car il y a des années, lorsqu’une délégation zapatiste était allée soutenir le campement des Cucapás4, il s’était lancé dans la mer de Cortés. Maxo n’expliqua pas qu’il avait failli se noyer parce que son passe-montagne lui collait au nez et à la bouche et qu’il n’arrivait pas à respirer. Tel un vieux loup de mer, il expliqua : « C’est comme une rivière, mais sans courant, et plus large, bien plus grand, un peu comme la lagune de Miramar ».
Le SupGaleano essayait de déchiffrer comment on dit « corde » en allemand, italien, français, anglais, grec, basque, turc, catalan, finnois etc., quand la Major Irma s’approcha et lui dit : « Dis-leur qu’elles ne sont pas seules ». « Ni seuls », ajouta le lieutenant-colonel Rolando. « Ni seul·es », a ajouté Marijosé, qui arrivait pour demander aux musicien·nes de faire une version du Lac des Cygnes, mais en cumbia. « Comme ça, joyeux quoi, qu’iels dansent, que leur cœur ne soit pas triste. » Les musiciens demandèrent ce qu’était un « cygne ». « C’est comme des canards mais en plus mignon, comme s’ils avaient tendu le cou et qu’ils étaient restés comme ça. C’est comme des girafes mais qui marchent comme des canards ». « Est-ce ça se mange ? » demandèrent les musiciens, qui savaient que c’était l’heure du pozol et étaient venus seulement pour amener la marimba. « Qu’est-ce que vous croyez ! Les cygnes ça se danse ». Les musiciens se dirent qu’une version de « pollito con papas » pourrait faire l’affaire. « On va y réfléchir », dirent-ils, et ils partirent se servir du pozol.
Pendant ce temps-là, Defensa Zapatista et Esperanza avaient convaincu Calamidad que, comme le SupGaleano était occupé, sa cabane était vide et qu’il avait très probablement caché un paquet de galettes dans la boîte à tabac. Calamidad hésitait, alors elles avaient dû lui dire que là-bas elles pourraient faire du pop-corn. Elles partirent. Le Sup les vit s’éloigner, mais il ne s’inquiéta pas, il leur était impossible de trouver la cachette des galettes, cachée sous des paquets de tabac moisi, et, se tournant vers le Monarque et lui montrant quelques schémas, il demanda : « Tu es sûr qu’il ne coulera pas ? Parce qu’on dirait que ça va être lourd ». Le Monarque resta pensif et répondit : « Possible ». Et puis, plus sérieusement : « Eh bien qu’ils emportent des vessies, comme ça ils flotteront » (note : vessies = ballons).
Le Sup soupira et dit : « Plus que d’un bateau, c’est d’un peu de bon sens dont nous avons besoin ». « Et de plus de corde », ajouta le SubMoy qui arrivait juste au moment où le radeau, plein à ras bord, commençait à sombrer.
Alors que, sur la berge, le groupe des comités contemplait les restes du naufrage et la marimba qui flottait à l’envers, quelqu’un dit : « Heureusement qu’on n’y avait pas mis la sono, ça coûte plus cher. »
Tout le monde a applaudi lorsque le mannequin a refait surface. Quelqu’un, avec clairvoyance, lui avait mis deux vessies gonflées sous les bras.
J’en témoigne.
Miaouaf.
Cette traduction est un collage dé·genré de celle de Joani Hocquenghem sur La voie du Jaguar et celle, anonyme, publiée sur le site Enlace Zapatista.
Quatrième partie : Souvenir de ce qui adviendra
 La brochure page à page en pdf
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte sur le site La voie du Jaguar
Le texte sur le site Portapluma
Texte de la brochure :
Octobre 2020.
Cela se passe il y a trente-cinq octobres.
Le Vieil Antonio regarde le feu de bois qui résiste à la pluie. Sous son chapeau de paille ruisselant, il allume à la braise sa cigarette roulée dans une feuille de maïs. Le feu couve, se cachant parfois sous les bûches ; le vent l’aide et, de son souffle, ravive les braises qui en rougissent en furie.
Le campement est celui que l’on nomme le « Watapil », dans la chaîne montagneuse dite « Sierra Cruz de Plata » qui se dresse entre les bras humides des fleuves Jataté et Perlas. Nous sommes en 1985, et le mois d’octobre reçoit le groupe avec un orage, présage de leurs jours à venir. Le grand amandier (qui donnera son nouveau nom à cette montagne en langue insurgée), compatissant, regarde à ses pieds cette petite, infime, insignifiante poignée de femmes et d’hommes. Les visages sont émaciés, les peaux sèches, le regard brillant (la fièvre peut-être, l’obstination, la peur, le délire, la faim, le manque de sommeil), les vêtements marron et noirs déchirés, les bottes déformées par les lianes qui s’efforcent de maintenir en place les semelles.
Posément, doucement, à peine audible dans le bruit de l’orage, le Vieil Antonio leur parle comme s’il s’adressait à lui-même :
« Le Petit Chef reviendra encore pour imposer à la couleur de la terre ses mots durs, son JE assassin qui tue toute raison, ses pots-de-vin déguisés en aumône.
Viendra le jour où la mort revêtira ses habits les plus cruels. Accompagnée dans ses pas par les rouages et les grincements de la machine qui rend malades les chemins, elle mentira en disant qu’elle apporte la prospérité alors qu’elle sème la destruction. Quiconque s’opposera à ce bruit qui terrifie les plantes et les animaux sera assassiné dans sa vie comme dans sa mémoire. Dans la première par le plomb, dans la seconde par le mensonge. La nuit sera ainsi plus longue. La douleur encore prolongée. La mort plus mortelle.
Les Aluxo’ob alerteront alors la mère et iels diront ainsi : « La mort s’en vient, mère, en tuant elle vient ».
La Terre Mère, la toute première, se réveillera alors – sortant perroquets, aras et toucans de leur sommeil -, elle réclamera le sang de ses gardiens et de ses gardiennes et, s’adressant à leurs descendance, elle parlera en ces mots : « Que les un·es aillent déjouer l’envahisseur. Que les autres aillent convoquer le sang qui lie les adelphes. Que les eaux ne vous effraient pas, que ne vous découragent ni les froids ni les chaleurs. Ouvrez des chemins là où il n’y en a pas. Remontez fleuves et mers. Naviguez par les montagnes. Volez comme pluies et nuages. Soyez nuit, soyez jour, partez à l’aube et alertez le tout. Car mes noms et couleurs sont nombreux mais mon cœur est unique, et ma mort sera aussi celle du tout. Que votre peau n’ait pas honte de la couleur que je lui ai données, ni les paroles que j’ai semées dans vos bouches, ni de votre taille je suis près de vous. Car je donnerai lumière à vos yeux, abri à vos oreilles et force à vos pieds et à vos bras. Ne craignez pas les couleurs et les autres manières de faire, ni les chemins différents. Parce qu’un seul est le cœur que je vous ai donné en héritage, une seule la raison et un seul le regard. »
Alors, sous l’assaut des Aluxo’ob, les machines du mensonge mortel tomberont en panne, leur arrogance sera détruite et détruite leur avidité. Et les puissant·es feront venir d’autres nations les laquais qui répareront les machines de mort en panne. Les entrailles des machines de mort seront examinées ; iels découvriront pourquoi elles sont endommagées et diront ainsi : «Elles sont pleines de sang ». Tout en essayant d’expliquer la raison de cette terrible merveille, iels annonceront ainsi à leurs patrons : « Nous ne savons pas pourquoi, nous savons juste qu’il s’agit de sang, héritier du sang originel ».
Alors, le mal pleuvra sur lui-même dans les grandes demeures où le Puissant se saoule et abuse. La déraison entrera dans ses domaines et ce sera non pas de l’eau mais du sang qui jaillira des sources. Ses jardins se faneront et se fanera le cœur de celleux qui travaillent pour lui et le servent. Le Puissant fera venir d’autres vassaux pour les utiliser. Iels viendront de terres lointaines. Et la haine entre égales·ux naîtra, encouragée par l’argent. Iels se battront entre elleux et la mort et la destruction se répandront parmi celleux qui ont en partage la même histoire et la même douleur.
Celleux qui auparavant travaillaient la terre et vivaient en elle, transformés à présent en serviteurs et en esclaves du Puissant sur les sols et sous les cieux de leurs ancêtres, verront l’arrivée des malheurs dans leurs maisons. Leurs filles et leurs fils se perdront, noyé·es dans la pourriture de la corruption et le crime. Reviendra le droit de cuissage avec lequel l’argent tue l’innocence et l’amour. Et les enfants seront arrachés des bras de leur mère et leur jeune chair sera prise par les grands Seigneurs pour rassasier leur vilénie et leur lâcheté. À cause de l’argent, le fils lèvera la main contre ses parents et le deuil habillera leur maison. La fille se perdra dans l’obscurité ou dans la mort, tuée dans sa vie et son être par les Seigneurs et leur argent. Des maladies inconnues s’abattront sur celleux qui ont vendu leur dignité et celle des leurs en échange de quelques pièces, celleux qui ont trahi leur race, leur sang et leur histoire, et celleux qui ont proclamé et propagé le mensonge.
La Ceiba Mère, celle qui porte les mondes, hurlera si fort que même la surdité la plus éloignée entendra son cri blessé. Et sept voix distantes se rapprocheront d’elle. Et sept bras lointains l’embrasseront. Et sept poings différents se joindront à elle. La Ceiba Mère soulèvera alors ses jupons et ses mille pieds piétineront et démoliront les routes de fer. Les machines à roues sortiront de leurs chemins de métal. Les eaux déborderont des fleuves et des lagunes, et la mer elle-même bramera avec furie. Dans tous les mondes, s’ouvriront alors les entrailles de la terre et des cieux.
Alors, la toute première, la Terre Mère se soulèvera et réclamera par le feu sa maison et une place à soi. Et par dessus les édifices orgueilleux du Pouvoir, arbres, plantes et animaux se mettront en marche, et avec leur cœur, iels feront revivre le Votán Zapata, gardien et cœur du peuple. Et le jaguar marchera à nouveau sur ses pistes ancestrales, régnant à nouveau là où l’argent et ses laquais avaient voulu régner.
Et le Puissant ne mourra pas sans avoir vu comment s’effondre presque sans un bruit son ignorante arrogance. Et dans son dernier souffle, le Petit Chef saura qu’il ne sera plus, au pire, qu’un mauvais souvenir dans le monde qui se sera rebellé et aura résisté à la mort que son commandement commandait.
Et c’est cela dit-on que disent les mort·es de toujours, celleux qui mourront à nouveau mais cette fois pour pouvoir vivre.
Et on dit qu’iels disent que cette parole doit être connue dans les vallées et les montagnes ; qu’elle soit portée par monts et par vaux ; que la répète l’oiseau tapacamino, et qu’ainsi il annonce les pas du cœur qui marche en adelphe ; que la pluie et le soleil la sèment dans le regard des habitant·es de ces terres ; et que le vent la porte loin et la niche dans la pensée compañera.
Parce que ces cieux et cette terre verront advenir des choses terribles et merveilleuses.
Et le jaguar marchera à nouveau sur ses pistes ancestrales, régnant à nouveau là où l’argent et ses laquais avaient voulu régner. »
Le Vieil Antonio se tait, et avec lui, la pluie. Rien ne dort. Tout rêve.
Depuis les montagnes du Sud-Est mexicain,
SupGaleano
Mexique,
Octobre 2020.
Carnet de notes du Chat-Chien
Les pirogues.
Je vous rappelle que les divisions entre pays ne servent qu’à caractériser le délit de « contrebande » et à donner un sens aux guerres. Il est clair qu’il y a au moins deux choses qui sont au-dessus des frontières : l’une est le crime qui, sous couvert de modernité, distribue la misère à l’échelle mondiale ; l’autre est l’espoir que la honte n’existe que lorsqu’en dansant on fait un faux pas, et non pas chaque fois que l’on se voit dans un miroir. Pour mettre fin à la première et faire prospérer la seconde, il suffit de se battre et d’être meilleurs. Le reste vient tout seul et c’est ce qui remplit habituellement les bibliothèques et les musées. Il n’est pas nécessaire de conquérir le monde, il suffit de le refaire. D’accord. Santé et sachez que, pour l’amour, un lit n’est qu’un prétexte ; pour la danse, un air n’est qu’un ornement ; et pour la lutte, la nationalité n’est qu’un simple accident de circonstance.
Don Durito de la Lacandona, 1995.
Le SubMoy dit à Maxo qu’il faudrait peut-être essayer avec du bois de balsa (« du liège » comme on dit par ici), mais l’ingénieur naval lui rétorqua que, étant donné sa légèreté, le courant risquait d’autant plus de l’emporter.
« Mais tu as dit qu’il n’y avait pas de courant en mer.
– Mais s’il y en a ? », se défendit Maxo.
Le SubMoy dit aux autres des comités que venait l’épreuve suivante : les pirogues.
Iels se mirent à sculpter plusieurs pirogues. Avec des haches et des machettes, iels façonnèrent et donnèrent vocation marine à des troncs dont le destin originel était d’être du bois pour le feu. Comme le SubMoy s’était absenté quelques instants, iels partirent demander au SupGaleano s’iels donneraient des noms aux embarcations. Le Sup qui regardait comment le Monarque vérifiait un vieux moteur diesel répondit distraitement : « Oui, bien sûr ».
Iels s’en allèrent et commencèrent à graver et à peindre sur les côtés des noms rationnels et mesurés. Sur l’un d’eux, on lisait : « Le Chompiras1 Nageur et Sauteur-de-Flaques ». Sur un autre : « L’internationaliste. Une chose est une chose, et autre chose c’est dont fuck me, compadre ». Un autre encore : « J’arrive tout de suite, je me dépêche mon amour ». Et celui-là : « Allez, c’est ta tournée, fallait pas m’inviter ». Ceux du puy Jacinto Canek avait baptisé le leur Jean Robert2, c’était leur façon à eux de faire en sorte qu’il accompagne le voyage.
Sur un autre qui était plus éloigné, on pouvait lire : « A quoi bon pleurer, ce n’est pas l’eau salée qui manque » et puis il continuait : « Ce bateau a été construit par la Commission Maritime de la commune autonome rebelle zapatiste « On-nous-critique-car-on-donne-des-noms-trop-longs-aux-MAREZ-et-aux-Caracoles-mais-on-s’en-fiche », et du Conseil de Bon Gouvernement « Pareil ». Produit périssable. A consommer avant : ça dépend. Nos embarcations ne coulent pas, mais elles ont une date de péremption, c’est pas la même chose. On recrute des fabricant·es de pirogues et des musicos au CRAREZ (marimba et sono non inclues – pour si jamais elles coulent et qu’on ait pas à les remplacer –, mais on se donne à fond pour chanter… bon, plus ou moins. Ça dépend, hein). Cette embarcation est uniquement cotée à la bourse de la résistance. La suite à la prochaine pirogue… » (Bien sûr, il fallait faire le tour du bateau et des parois intérieures pour lire le nom complet ; oui, vous avez raison, le sous-marin ennemi va tellement tarder à transmettre le nom complet du navire à couler que, quand il aura terminé, l’embarcation sera déjà amarrée sur les côtes européennes).
Le fait est que, pendant qu’iels sculptaient les troncs, la rumeur s’était répandue. Amado le bien-aimé l’avait raconté à Pablito, qui l’avait raconté à Pedrito qui en avait informé Defensa Zapatista qui en avait parlé avec Esperanza qui l’avait dit à Calamidad « ne le dis à personne » qui l’avait raconté à ses mamans, qui le dirent dans le groupe « comme que femmes que nous sommes ».
Quand on dit au SupGaleano que les femmes arrivaient, le Sup haussa les épaules et donna au Monarque la clé, dite espagnole, d’un demi pouce, tout en crachant des morceaux du tuyau de sa pipe.
Plus tard arriva Jacobo : « Eh Sup, il va tarder le SupMoy ?
– Aucune idée », répondit le SupGaleano, regardant, inconsolable, sa pipe brisée.
Jacobo : – « Et toi, tu sais combien de personnes vont faire le voyage ?
Le Sup : – Pas encore. L’Europe d’en-bas n’a pas répondu combien iels peuvent en recevoir. Pourquoi ?
Jacobo : – Ben, c’est que… Viens plutôt voir. »
Le SupGaleano cassa une autre pipe en voyant la «flotte» zapatiste. Sur la rive du cours d’eau, les six pirogues aux noms rocambolesques, alignées, étaient remplies de pots et de fleurs.
« Et ça, c’est quoi ? demanda le Sup, comme une simple formalité.
– C’est le chargement des compañeras, répondit Ruben résigné.
Le Sup : – Le chargement ?
Ruben : – Oui, elles sont venues et elles ont dit : « Ça, on va en avoir besoin » et elles ont laissé ces petites plantes. Et après, une petite fille est arrivée, je sais pas comment elle s’appelle, mais elle a demandé si le voyage allait durer, ou si on allait mettre du temps à arriver là où on va. Je lui ai demandé pourquoi, s’il y avait aussi ses mamans qui partaient ou quoi. Elle m’a dit que non, que c’était parce qu’elle voulait envoyer un arbre, un petit comme ça et que si, tout à coup, on tardait pendant le voyage, eh ben il serait déjà grand en arrivant et on pourrait prendre le pozol à l’ombre si le soleil tapait trop fort.
– Mais c’est toutes les mêmes, a répliqué le Sup (en se référant aux plantes, évidemment).
– Non, dit Alejandra, du comité. Celle-ci, c’est de l’ambroisie, pour le mal au ventre ; elle, c’est du thym, celle-là c’est de la menthe ; là-bas, il y a la camomille, l’origan, le persil, la coriandre, le laurier, l’épazote, l’aloe vera ; celle-ci, c’est au cas où tu as la diarrhée, celle-ci pour les brûlures, celle-là pour les insomnies, celle-là pour le mal de dents, ici celle pour les coliques, celle-ci s’appelle «soigne-tout», une autre là-bas pour les envies de vomir, il y a aussi du poivre, du momo, de la yerba mora, de la ciboulette, de la rue, des géraniums, des œillets, des tulipanes, des roses, des mañanitas, etc. »
Jacobo se sentit obligé de préciser : « On a fini la première pirogue, et quand on est revenu·es, elle était déjà pleine de buissons ; un autre canot, et tout de suite plein. On en a déjà six. C’est pour ça que je demande si on continue à en faire d’autres, parce qu’elles vont les remplir de toute façon.
– Mais si vous envoyez tout ça, où vont se mettre les compañeros ? » voulut argumenter le Sup en s’adressant à une compañera, coordinatrice de femmes, qui portait dans ses bras deux pots de fleurs et un gamin dans un châle noué dans le dos.
– Ah bon ? Les hommes vont y aller ? dit-elle.
– De toutes façons, les femmes non plus ne tiendront pas là-dedans, rétorqua le Sup, au bord de la crise de nerfs.
Elle : – Ah, c’est que nous, nous n’allons pas partir en bateau. Nous, nous allons y aller en avion, comme ça, on ne vomira pas. Bon, toujours un peu, mais quand même moins.
Le Sup : – Et qui vous a dit que vous, vous iriez en avion ?
Elle : – C’est nous.
Le Sup : – Mais d’où ça vient, tout ce que tu me racontes ?
Elle : – C’est Esperanza qui est venue à la réunion du groupe « Comme femmes que nous sommes » et qui nous a informées qu’on allait toutes mourir misérablement si on partait avec ces maudits hommes. Alors, on a réfléchi en assemblée et on est tombées d’accord sur l’idée qu’on n’a pas peur et qu’on est vraiment prêtes et déterminées à ce que les hommes meurent misérablement et pas nous.
On a déjà fait les comptes et on va louer l’avion qu’a acheté Calderón pour Peña Nieto ; les mauvais gouvernements de maintenant ne savent plus quoi en faire. Ils disent que le billet, c’est 500 pesos par personne. Il y a déjà 111 compañeras sur la liste, mais je crois qu’il manque les équipes de football des miliciennes. Donc, si on est juste 111, ça ferait 55 500 pesos, mais les femmes et les gamins ne paient que la moitié, alors ça fait 27 750. Il reste à enlever la TVA et le bonus pour frais de représentation, disons qu’en gros ça fait 10 000 pesos pour toutes. Et ça, c’est si le dollar ne dévalue pas, sinon ça fera encore moins. Mais pour ne pas discuter du prix, on va leur donner le bœuf d’un copain, qui ressemble à je ne dirai pas qui, mais qu’est-ce qu’on y peut, tous les petits mâles sont comme ça. »
Le SupGaleano se tut une bonne fois pour toutes, essayant de se souvenir où il avait bien pu laisser sa pipe d’urgence. Mais quand il vit que les femmes commençaient à transporter des poules, des coqs, des poussins, des cochons, des canards et des dindons, il dit au Monarque : « Vite, appelle le SubMoy et dis-lui qu’il faut qu’il vienne de toute urgence. »
La procession des femmes, des plantes et des animaux s’étendait jusqu’au-delà du corral. La file de la bande de Defensa Zapatista les suivait : la colonne de la horde avec Pablito en tête sur son cheval, en mode « Si tu ne peux pas les vaincre, unis-toi à elles », suivi d’Amado le bien-aimé avec son vélo – et un pneu crevé. Ensuite, le chat-chien menant un troupeau de bétail. Defensa et Esperanza mesuraient les pirogues pour calculer s’il y avait encore de la place pour les cages de foot. Le cheval borgne mâchonnait une bouteille en pastique. Calamidad passa portant dans ses bras un petit cochon qui gémissait terrorisé, craignant qu’elle le jette dans la rivière pour le sauver après… ou non ?
Fermait la marche quelqu’un qui ressemblait de façon extraordinaire à un scarabée, avec un bandeau de pirate sur l’œil droit, un bout de fil de fer tordu sur une de ses petites pattes – tel un crochet -, et sur l’autre une sorte de jambe de bois, même si ce n’était en fait qu’une écharde de liane sculptée. L’étrange créature, avec un mouchoir de papier pour masque, déclamait avec une intonation honorable :
Avec dix canons de chaque côté,
le vent en poupe, toutes voiles dehors,
ne fend pas les mers, mais vole
un voilier brigantin.
Navire pirate, nommé
pour son courage «Le Redouté»,
Sur toutes les mers, il est connu
d’un bout à l’autre.
Quand revint le Sous-commandant insurgé Moises, chef de l’expédition en préparation, il trouva le SupGaleano qui souriait inexplicablement. Le Sup avait trouvé une autre pipe, celle-ci intacte, dans la poche de son pantalon.
J’en témoigne.
Miaouaf.
Cette traduction est un collage dé·genré de celle de Joani Hocquenghem sur La voie du Jaguar, de celle du SerpentⒶplumes sur son blog portapluma.blogspot.com et celle, anonyme, publiée sur le site Enlace Zapatista.
Troisième partie : La mission
 La brochure page à page en pdf
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte sur le site La voie du Jaguar
Le texte de la brochure :
De comment Defensa Zapatista
tente d’expliquer à Esperanza
quelle est la mission du zapatisme
et autres heureux raisonnements.
« Bon, alors je vais t’expliquer quelque chose de très important. Mais tu ne peux pas prendre de notes, ce que je veux c’est que tu le gardes en tête. Parce que le cahier, tu le laisses traîner n’importe où, mais ta tête t’es forcée de l’avoir toujours sur toi. »
Defensa Zapatista marche de long en large, comme on dit que faisait le défunt quand il expliquait quelque chose de très important. Esperanza est assise sur un tronc et, prévoyante, elle a posé un plastique sur le bois humide, florissant de mousse, de champignons et de rameaux secs.
« Est-ce que nous allons voir l’endroit où nous arrivons pour la lutte ? » lâche Defensa Zapatista tendant ses menottes vers nulle part.
Esperanza réfléchit à une réponse, mais il est évident que Defensa a posé une question rhétorique, autrement dit ce n’est pas la réponse qui l’intéresse, mais les interrogations qui suivent la première question. Defensa Zapatista, d’après elle, suit la méthode scientifique.
« La problème donc n’est pas d’arriver, mais de s’ouvrir un chemin. Autrement dit, s’il n’y a pas de chemin, eh bien, il faut en faire un, parce que sinon, comment ? » La fillette brandit un machete qui est sorti allez savoir d’où, mais c’est sûr que dans une des cahutes on doit être en train de le chercher.
« Alors la problème, comme qui dirait, a changé, et le plus premier, c’est le chemin. Parce que, s’il n’y a pas de chemin vers là où tu veux aller, ça sert à rien que tu en restes à cette préoccupation. Donc, qu’est-ce que nous allons faire s’il n’y a pas de chemin vers là où nous allons ? »
Esperanza répond avec satisfaction : « On attend qu’il arrête de pleuvoir pour ne pas se mouiller quand on fait le chemin. »
Defensa s’arrache les cheveux — et réduit à néant la coiffure qui a pris une demi-heure à ses mamans — et crie : « Non ! »
Esperanza hésite et risque : « Je sais : on raconte à Pedrito un mensonge qu’il y a des caramels là-bas où nous allons, mais qu’il n’y a pas de chemin et qu’il trouve quelqu’un qui lui fasse d’abord un chemin, et ensuite il s’empiffre de caramels. »
Defensa réagit : « Tu crois qu’on va demander de l’aide aux fichus hommes ? Jamaiment. Nous, on va le faire comme les femmes que nous sommes. »
« C’est juste, dit Esperanza, et si par hasard il y a des chocolats. »
Defensa continue : « Mais, et si nous nous perdons quand nous ouvrons le chemin ? »
Esperanza répond : « On crie pour appeler au secours ? On lance une fusée ou on souffle dans la conque pour qu’on entende au village et qu’on vienne nous secourir ? »
Defensa comprend qu’Esperanza prend les choses au pied de la lettre et que, de plus, elle est en train d’obtenir le consensus du reste du public. Le chat-chien, par exemple, se lèche à présent les babines en imaginant la marmite pleine de chocolats au pied de l’arc-en-ciel, et le cheval borgne soupçonne qu’il y a peut-être du maïs avec du sel et que la marmite déborde de bouteilles en plastique. Calamidad s’exerce à la chorégraphie qu’a conçue pour elle le SupGaleano, appelée « pas de chocolat », qui consiste à se lancer, en mode rhinocéros, sur la marmite.
Pour sa part, Elías Contreras, dès les premières questions, a sorti sa lime et affûte son machete à double tranchant.
Plus loin, un être indéfini, ressemblant extraordinairement à un scarabée, portant une pancarte où on lit « Appelez-moi Ismael », discute avec le Vieil Antonio des avantages de l’immobilité sur la terre ferme, et affirme : « Eh bien, oui, mon cher Queequog, il n’y a aucune baleine blanche pour approcher du port. » Le vieil indigène zapatiste, professeur involontaire de la génération qui s’est soulevée en armes en 1994, se roule une cigarette dans une feuille de maïs et écoute attentivement les arguments de la bestiole.
La fillette Defensa Zapatista sent que, à l’égal des sciences et des arts, elle se trouve dans la situation inconfortable où on est incompris : comme un pas de deux attendant l’embrassement pour les pirouettes et le soutien pour un porté1 ; comme un film prisonnier dans une boîte, espérant un regard qui vienne à son secours ; comme un port sans embarcation ; comme une cumbia en attente de hanches qui lui donnent vocation et destin ; comme un cigala concave sans convexe ; comme Luz Casal allant à la rencontre de la fleur promise ; comme Louis Lingg sans les bombes du punk ; comme Panchito Varona cherchant derrière un accord un avril volé ; comme un ska sans slam ; comme une glace aux noix sans un Sup qui lui fasse honneur.
Mais Defensa est défense, mais elle est aussi zapatiste, alors, rien de rien, résistance et rébellion, et du regard elle cherche le secours du Vieil Antonio.
« Mais les tempêtes ne respectent rien : en mer comme sur terre, dans le ciel comme sur le sol. Les entrailles mêmes de la terre se tordent, et humains, plantes et animaux souffrent. Peu importe leur couleur, leur taille, leur manière d’être », dit de sa voix éteinte le Vieil Antonio.
Tou·tes écoutent, dans un silence mêlé de respect et de terreur.
Le Vieil Antonio poursuit : « Les femmes et les hommes cherchent à s’abriter des vents, pluies et sols rompus et attendent que ça passe pour voir ce qui est resté et ce qui n’est plus là. Mais la terre fait plus, car elle se prépare pour après, pour ce qui suit. Et tout en se protégeant elle commence déjà à changer. La Mère Terre n’attend pas que se termine la tourmente pour savoir que faire, elle commence dès auparavant à construire. C’est pourquoi celleux qui en savent le plus disent que l’avenir n’arrive pas comme ça tout simplement en apparaissant d’un coup, mais qu’il est à l’affût dans les ombres et celui qui sait regarder le découvre dans les fissures de la nuit. C’est pourquoi les hommes et femmes de maïs, quand iels sèment, rêvent de la tortilla, de l’atole, du pozol, du tamal et du marquesote. Il n’y en a pas encore, mais iels savent qu’il y en aura et c’est ce qui commande leur travail. Iels voient leur ouvrage et en voient le fruit avant même que la graine ne touche le sol.
Les hommes et femmes de maïs, quand iels regardent ce monde et ses douleurs, voient aussi le monde qu’il faudra construire et font leur propre chemin. Iels ont trois regards : un pour ce qui est antérieur, un autre pour ce qui est maintenant et un autre encore pour ce qui suit. Ainsi iels savent qu’iels sèment un trésor : le regard. »
Defensa approuve enthousiasmée. Elle comprend que le Vieil Antonio comprend l’argument qu’elle n’arrive pas à exposer. Deux générations distantes dans les calendriers et les géographies jettent un pont qui va et qui vient… comme les chemins.
« Exact ! » crie presque la petite fille et elle regarde l’ancien avec affection.
Et elle poursuit : « Si nous savons où nous allons, cela veut dire que nous savons où nous ne voulons pas aller. Alors, à chaque pas, nous nous éloignons de certains endroits et nous approchons d’un autre endroit. Nous ne sommes pas encore arrivés, mais le chemin que nous faisons nous marque cette destination. Si nous voulons manger des tamales, nous n’allons pas semer des courges. »
L’auditoire dans son ensemble fait une compréhensible grimace de dégoût en imaginant un horrible potage de courges.
« Nous supportons la tempête avec ce que nous savons, mais nous préparons déjà ce qui suit. Et nous le préparons dès maintenant. Pour ça il faut porter la parole loin. Peu importe si celui qui la dit ne va plus être là, ce qui importe c’est que la graine parvienne à la bonne terre et qu’elle se développe là où il y en a déjà d’autres. C’est-à-dire apporter un soutien. C’est là notre mission : être graine qui cherche d’autres graines », déclare Defensa Zapatista et, s’adressant à Esperanza, elle demande :
« Tu as compris ? »
Esperanza se met sur pied et, avec toute la solennité de ses neuf ans, répond avec sérieux :
« Oui, j’ai bien compris que dans les faits nous allons mourir misérablement. »
Et elle ajoute presque aussitôt : « Mais on va faire en sorte que ça en vaille la peine. »
Tou·tes applaudissent.
Pour renforcer le « que ça en vaille la peine » d’Esperanza, le Vieil Antonio sort de sa besace un sac de ces chocolats qu’on appelle des « besitos ».
Le chat-chien s’en adjuge une bonne quantité d’un coup de patte et le cheval borgne préfère en ruminer sa bouteille de plastique.
Elías Contreras, commission d’enquête de l’EZLN, répète à mi-voix : « On va faire en sorte que ça en vaille la peine », et il envoie le cœur et la pensée au frère Samir Flores et à celleux qui affrontent avec leur seule dignité le bruyant voleur de l’eau et de la vie qui se cache derrière les armes du contremaître, celui qui dissimule dans son verbiage l’obéissance aveugle qu’il doit au Donneur d’ordres : d’abord l’argent, ensuite l’argent, enfin l’argent. Jamais la justice ni la liberté, jamais la vie.
La petite bestiole commence à raconter comment une tablette de chocolat l’a sauvé de la mort dans la steppe sibérienne alors qu’il se rendait de la terre des Samis2 — où il entonna le joik3 — au territoire des Selkoupes4 pour rendre honneur au Cèdre, l’arbre de la vie. « Je suis allé apprendre, c’est à ça que servent les voyages. Parce qu’il y a des résistances et des rébellions éloignées dans les calendriers et les géographies qui n’en sont pas moins importantes et héroïques », dit-il en libérant avec ses multiples petites pattes le chocolat de sa prison de brillant papier d’argent, en applaudissant et en engloutissant un morceau tout en même temps.
Pour sa part, Calamidad a bien compris une chose, qu’il faut penser à ce qui suit et, les menottes barbouillées de chocolat, elle déclare avec enthousiasme : « Allons jouer au pop-corn ! »
Depuis le Centre d’entraînement maritimo-terrestre zapatiste.
Le SupGaleano animant l’atelier « Le Gribouillis internationaliste ».
Mexique,
Décembre 2020.
Carnet de notes du Chat-Chien
Le trésor de ce qui est autre.
Quand il a terminé, il m’a regardé lentement de son unique œil et m’a dit : “Je vous attendais, Don Durito. Sachez que je suis le dernier des véritables pirates vivant au monde. Et je dis ‘véritables’ parce qu’aujourd’hui il y a une infinité de ‘pirates’ qui volent, tuent, détruisent et saccagent depuis les centres financiers et les grands palais gouvernementaux sans toucher d’autre eau que celle de la baignoire. Voici votre mission (il me remet une liasse de vieux parchemins). Trouvez le trésor et mettez-le en lieu sûr. Maintenant, excusez-moi, mais je dois mourir.” Et ce disant, il a laissé tomber sa tête sur la table. Oui, il était mort. Le perroquet a pris son vol et est sorti par une fenêtre en disant : “Place à l’exilé de Mytilène, place au fils bâtard de Lesbos, place à la fierté de la mer Égée. Ouvrez vos neuf portes, redoutable enfer, car c’est là que va reposer le grand Barberousse. Il a trouvé qui suivra ses pas et il dort maintenant, celui qui a fait de l’océan une larme. L’orgueil des pirates véritables naviguera dorénavant sous Pavillon Noir.”
Sous la fenêtre s’étendait le port suédois de Göteborg et au loin pleurait une nyckelharpa…
Don Durito de la Lacandona, octobre 1999.
Section : Trois délires, deux groupes et un mutin.
Note : Cette troisième partie est composée de six vidéos, que j’ai décrites rapidement en italique, et visibles sur le site Enlace Zapatista ou sur la chaîne Enlace Zapatista sur Vimeo)
Si nous suivons la route de l’amiral Maxo, je crois qu’on arrivera plus vite en traversant à pied le détroit de Béring.
< Première vidéo, nommée Balsa, qui montre la fabrication d’un radeau de troncs liés par des lianes. Une fois le radeau à l’eau, un compañero (l’amiral Maxo ?) explique le trajet que devra emprunter l’embarcation pour arriver à l’océan, puis à l’Europe. On a droit à une musique épique de pirates en fond sonore, comme sur les vidéos suivantes. Il y a des sous-titres en espagnol et en anglais. >
On a les ovaires de ne pas s’arrêter
< La deuxième, Cayuco, met en scène deux compañeros qui livrent une pirogue creusée dans un tronc d’arbre à deux compañeras, leur assurant que l’arbre dans lequel elle a été creusé est fait d’un bois qui ne coule pas. Il y a des sous-titres en espagnol et en anglais. >
Le moteur est là, il ne manque que le bateau
< Cette vidéo nommée Lancha (le navire) nous montre un compañero retapant un moteur, destiné à équiper le navire zapatiste lors de sa traversée, à la rencontre des luttes et de celleux qui les font en Europe. Il y a des sous-titres en espagnol et en anglais. >
L’équipage – I
< La quatrième vidéo, Milicia, montre une colonne de miliciennes, armées de deux bâtons chacune, portant des masques pour se protéger du Covid 19 et en habits civils, faire des exercices de marche. >
L’équipage – II
< La cinquième vidéo, intitulée Reuniòn, montre une salle avec des chaises espacées de deux mètres les unes des autres, où prennent place d’abord des femmes, dans la partie avant de la pièce, puis quelques hommes derrière. Les miliciennes de la vidéo d’avant arrivent et s’installent, puis après une ellipse les personnes quittent la salle. >
On n’a pas encore de bateau, mais il y en a déjà pour mener la mutinerie à bord !
< La star de la dernière vidéo, Loro, est un perroquet vert apprivoisé que l’on voit manger et parler, posé sur le bras d’une personne en noir. Il finit par lui mordiller l’oreille >
Cette traduction est une version dé·genrée de celle de Joani Hocquenghem, publiée sur La voie du Jaguar et Enlace Zapatista. Je me suis permis d’ajouter les descriptions des vidéos.
Deuxième partie : la cantina
 La brochure page à page en pdf
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte sur le site La voie du Jaguar
Texte de la brochure :
Date ? Aujourd’hui.
Lieu ? N’importe où dans le monde.
Vous ne savez pas bien pourquoi, mais vous marchez en tenant par main une petite fille. Vous êtes sur le point de lui demander vers où vous vous dirigez, quand vous passez devant une grande cantina. Un grand panneau lumineux, comme la marquise d’un cinéma, déclare : « L’HISTOIRE EN MAJUSCULES. Cantina-bar », et plus bas : « Les femmes, enfants, indigènes, chômeur·euses, autres, personnes âgées, migrant·es et autres gens jetables ne sont pas admis·es. » Une main blanche a ajouté : « In this place, Black Lives does not matter. » Et une autre main masculine a ajouté : « Les femmes peuvent entrer si elles se comportent comme des hommes. » À côté de l’établissement sont entassés les corps de femmes de tous âges et, à en juger par leurs vêtements en lambeaux, de toutes classes sociales. Vous vous arrêtez et, résignée, la petite fille aussi. Vous regardez par la porte et vous voyez un fouillis d’hommes et de femmes aux manières masculines. Sur le bar, ou comptoir, un type brandit une batte de base-ball et en agite la menace de droite et de gauche. La foule est clairement divisée : d’un côté celleux qui applaudissent et de l’autre celleux qui huent. Tou·tes sont comme enivré·es : le regard furieux, la bave coulant sur le menton, le visage rouge.
Quelqu’un, qui doit être le videur ou quelque chose dans ce genre, s’approche et vous demande :
« Vous voulez entrer ? Vous pouvez choisir le camp qui vous plaît. Vous voulez applaudir ou bien critiquer ? Quel que soit votre choix, nous garantissons que vous aurez beaucoup de followers, de likes, de pouces bleus et encore plus d’applaudissements. Vous serez célèbre si vous imaginez quelque chose d’ingénieux, soit pour, soit contre. Et même si vous n’êtes pas très intelligent·e, il vous suffit de faire du bruit. Peu importe que ce que vous criez soit vrai ou faux, tant que vous criez fort. »
Vous soupesez la proposition. Elle semble tentante, surtout que vous, il n’y a pas un chat pour vous suivre.
« C’est dangereux ? » risquez-vous timidement.
Le videur vous rassure : « Pas du tout ; ici règne l’impunité. Voyez qui est maintenant à la batte. Il dit n’importe quoi de stupide et les un·es l’applaudissent et les autres le critiquent avec d’autres stupidités. Quand le tour de cette personne sera passé, une autre montera à sa place. Je vous l’ai dit, il n’y a pas besoin d’être intelligent·e. Qui plus est, l’intelligence, ici, ça gêne. Décidez-vous. Comme ça vous oubliez les maladies, les catastrophes, les misères, les mensonges du gouvernement, l’avenir. Ici, la réalité n’a pas vraiment d’importance. Ce qui compte, c’est la mode du jour. »
Vous : « Et pour quoi se disputent-iels ? »
« Ah, pour tout et n’importe quoi. Les deux camps lancent des frivolités et des absurdités. Comme qui dirait que la créativité n’est pas leur fort. C’est ainsi. », répond le gardien en jetant un regard craintif vers le haut du bâtiment.
La petite fille suit la direction de son regard et, montrant le haut du bâtiment où l’on peut voir un étage tout entier en verre miroir, elle demande :
« Et celleux qui sont là-haut, iels sont pour ou contre ? »
« Ah, non », répond l’homme et il ajoute à mi-voix : « Ce sont les propriétaires de la cantina. Iels n’ont pas besoin de prendre parti sur quoi que ce soit, on fait simplement ce qu’iels ordonnent »
Dehors, plus loin sur la route, on voit un groupe de personnes qui, vous le supposez, n’avaient pas eu envie d’entrer dans la cantina et avaient passé leur chemin. Un autre groupe sort de l’établissement contrarié en marmonant : « impossible de réfléchir là-dedans » et « au lieu de “L’Histoire en majuscules”, ça devrait s’appeler “L’Histoire en mascu-qui-hurle” ». Iels rient et s’éloignent.
La fillette vous regarde. Vous hésitez…
Elle dit : « Tu peux rester ou passer outre. Seulement, sois responsable de ta décision. La liberté n’est pas seulement pouvoir décider ce qu’on fait et le faire. C’est aussi assumer la responsabilité de ce qui se fait et de la décision prise. »
Sans vous décider encore, vous demandez à la petite fille : « Et toi, où tu vas ? »
« À mon village », dit l’enfant, et elle tend ses petites mains vers l’horizon comme si elle disait « Au monde ».
Depuis montagnes du sud-est du Mexique.
Le SupGaleano.
C’est le Mexique,
c’est 2020,
c’est décembre,
c’est le petit matin,
il fait froid et la pleine lune regarde, etonnée,
comment les montagnes se dressent,
remontent un peu leurs jupons,
et doucement,
très doucement,
se mettent en marche.
Carnet de notes du Chat-Chien
Esperanza raonte à Defensa un rêve qu’elle a fait.
« Alors je suis endormie et je rêve. Bien sûr, je sais que je rêve parce que je suis en train de dormir. Donc, alors je vois que je suis très loin. Qu’il y a des hommes et des femmes et d’autres très autres. C’est-à-dire que je ne les connais pas. Qu’iels parlent une langue que je ne comprends pas. Et iels ont beaucoup de couleurs et des façons très différentes. Iels font un grand tapage. Iels chantent et dansent, parlent, discutent, pleurent, rient. Et je ne connais rien de ce que je vois. Il y a des bâtiments, grands et petits. Il y a des arbres et des plantes comme ceux d’ici, mais différents. Une nourriture très autre. Donc tout ça très étrange. Mais le plus étrange, c’est que, je ne sais pas pourquoi ni comment, mais je sais que je suis chez moi. »
Esperanza se tait. Defensa Zapatista finit de prendre des notes dans son cahier, la regarde et au bout de quelques secondes, lui demande :
« Tu sais nager ? »
J’en témoigne.
Miaouaf.
Cette traduction est un collage dé·genré de celle de Joani Hocquenghem sur La voie du Jaguar et de celle, anonyme, publiée sur le site Enlace Zapatista.
Première partie : Une déclaration… pour la vie
La brochure page à page en pdf
La brochure format livret en pdf
Le texte sur le site Enlace Zapatista
Le texte de la brochure :
1er janvier 2021
Aux peuples du monde,
Aux personnes qui luttent sur les cinq continents,
Adelphes & compañer@s,
Durant ces derniers mois, nous avons pris contact entre nous de différentes manières. Nous sommes des femmes, des lesbiennes, des gays, des bisexuel·les, des transgenres, des travesti·es, des transsexuel·les, des personnes intersexes, des queers et d’autres encore, hommes, groupes, collectifs, associations, organisations, mouvements sociaux, peuples originaires, associations de quartier, communautés et un long etcetera qui nous donne une identité.
Nos différences et les distances entre nous viennent des terres, des cieux, des montagnes, des vallées, des steppes, des déserts, des océans, des lacs, des rivières, des sources, des lagunes, des races, des cultures, des langues, des histoires, des âges, des géographies, des identités sexuelles ou pas, des racines, des frontières, des formes d’organisation, des classes sociales, des capacités financières, du prestige social, de la popularité, des followers, des likes, des monnaies, des niveaux de scolarité, des manières d’être, des préoccupations, des qualités, des défauts, des pours, des contres, des mais, des cependant, des rivalités, des inimitiés, des conceptions, des argumentations, des contre-argumentations, des débats, des différends, des dénonciations, des accusations, des mépris, des phobies, des philies, des éloges, des rejets, des abus, des applaudissements, des divinités, des démons, des dogmes, des hérésies, des goûts, des dégoûts, des manières d’être, et un long et cetera qui nous rend différent·es et bien des fois nous oppose.
Il n’y a que très peu de choses qui nous unissent :
★ Faire nôtres les douleurs de la terre : la violence contre les femmes, la persécution et le mépris contre les différent·es dans leur identité affective, émotionnelle, sexuelle ; l’anéantissement de l’enfance ; le génocide contre les peuples originaires ; le racisme ; le militarisme ; l’exploitation ; la spoliation ; la destruction de la nature.
★ Comprendre que le responsable de ces douleurs est un système. Le bourreau est un système exploiteur, patriarcal, pyramidal, raciste, voleur et criminel : le capitalisme.
★ Savoir qu’il n’est pas possible de réformer ce système, ni de l’éduquer, de l’atténuer, d’en limer les aspérités, de le domestiquer, de l’humaniser.
★ S’être engagé à lutter, partout et à toute heure – chacun·e là où on se trouve – contre ce système jusqu’à le détruire complètement. La survie de l’humanité dépend de la destruction du capitalisme. Nous ne nous rendons pas, nous ne nous vendons pas, nous ne titubons pas.
★ Avoir la certitude que la lutte pour l’humanité est mondiale. De même que la destruction en cours ne reconnaît pas de frontières, de nationalités, de drapeaux, de langues, de cultures, de races, la lutte pour l’humanité est en tous lieux, tout le temps.
★ Avoir la conviction que nombreux sont les mondes qui vivent et qui luttent dans le monde. Et que toute prétention à l’homogénéité et à l’hégémonie attente à l’essence de l’être humain : la liberté. L’égalité de l’humanité se trouve dans le respect de la différence. C’est dans sa diversité que se trouve sa ressemblance.
★ Comprendre que ce n’est pas la prétention d’imposer notre regard, nos pas, nos compagnies, nos chemins et nos destins qui nous permettra d’avancer, mais la capacité à écouter et à regarder l’autre qui, distinct et différent, partage la même vocation de liberté et de justice.
De par ce qui nous unit, et sans abandonner nos convictions ni cesser d’être ce que nous sommes, nous nous sommes mis d’accord pour :
Premièrement. Réaliser des rencontres, des dialogues, des échanges d’idées, d’expériences, d’analyses et d’évaluations entre personnes qui sommes engagées, à partir de différentes conceptions et sur différents terrains, dans la lutte pour la vie. Après, chacun·e continuera son chemin, ou pas. Regarder et écouter l’autre nous y aidera peut-être, ou pas. Mais connaître ce qui est différent, c’est aussi une partie de notre lutte et de notre effort, de notre humanité.
Deuxièmement. Que ces rencontres et ces activités se réalisent sur les cinq continents. Qu’en ce qui concerne le continent européen, elles se concrétisent durant les mois de juillet, août, septembre et octobre 2021, avec la participation directe d’une délégation mexicaine formée par le Congrès National Indigène – Conseil Indigène de Gouvernement, le Front des Villages en Défense de l’Eau et de la Terre des Etats de Morelos, Puebla et Tlaxcala, et par l’Armée Zapatiste de Libération Nationale. Et que nous aiderons selon nos possibilités à ce qu’elles se réalisent, à des dates postérieures encore à préciser, en Asie, en Afrique, en Océanie et en Amérique.
Troisièmement. Inviter les personnes qui partagent les mêmes préoccupations et des luttes similaires, toutes les personnes honnêtes et tous les en-bas qui se rebellent et résistent dans les nombreux recoins du monde, à rejoindre, à contribuer, à soutenir et à participer à ces rencontres et activités ; et à signer et à s’approprier cette déclaration POUR LA VIE.
Depuis l’un des ponts de dignité qui unissent les cinq continents.
Nous tou·te·s.
Planète Terre.
1er janvier 2021.
Cette traduction est une version dé·genrée de celle, anonyme, publiée sur le site Enlace Zapatista.
Bravo d’être arrivé·e là ! 🙂 J’espère que la lecture t’a plu, n’hésite pas à me dire si j’ai laissé des coquilles dans le texte ou les fichiers pdf !