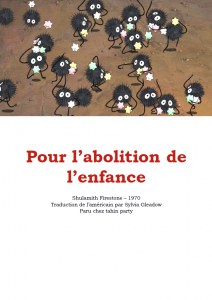 La page du bouquin chez Tahin Party (avec le pdf en bas de page, avec une super intro)
La page du bouquin chez Tahin Party (avec le pdf en bas de page, avec une super intro)
La brochure en pdf page par page : Pour l’abolition de l’enfance
La brochure en pdf format livret : Pour l’abolition de l’enfance (livret)
Il s’agit d’un chapitre du livre La dialectique du sexe. Il a été publié avec une super introduction (qui parle des mouvements d’enfants et de jeunes), d’autres bouts de chapitres qui permettent de comprendre notamment le complexe d’Œdipe / Electre, et une super biblio chez Tahin party mais c’était un peu long pour le mettre en brochure. Déso.
Tarage
*
À Nechemia, qui sera sortie de l’enfance
avant que cette institution n’ait cessé d’être.
Le langage associe toujours les femmes et les enfants (« les femmes et les enfants d’abord ! »). Chacun connaît les liens particuliers qui les unissent. Je prétends cependant que la nature de ces liens n’est rien de plus que l’expérience commune de l’oppression. Et de plus, qu’ils s’attachent et se renforcent mutuellement, de manière si complexe qu’il nous sera impossible de parler de la libération des femmes sans envisager aussi celle des enfants, et inversement. La cause essentielle de l’asservissement de la femme tient à ce qu’elle a pour rôle de porter et d’élever les enfants. Et les enfants eux-mêmes sont définis en fonction de ce rôle, qui façonne ainsi leur psychologie ; or la manière dont ils deviennent adultes, et dont ils apprennent à nouer des relations sociales, est déterminante pour le monde qu’ils construiront.
*
J’ai essayé de montrer comment la hiérarchie du pouvoir dans la famille biologique, et la contrainte sexuelle nécessaire pour la maintenir – particulièrement intense dans la cellule familiale patriarcale – sont destructrices et nuisibles pour la psyché individuelle. Avant de poursuivre en examinant comment et pourquoi elles ont créé un culte de l’enfance, je voudrais étudier le développement de cette cellule familiale patriarcale.
Dans toutes les sociétés, il a existé jusqu’à nos jours une forme de famille biologique, où l’oppression des femmes et des enfants s’est toujours exercée à des degrés divers. Engels, Reich et d’autres citent l’exemple des matriarcats primitifs du passé pour tenter de montrer comment l’autoritarisme, l’exploitation et la répression sexuelle naquirent avec la monogamie. Mais il est trop facile de trouver dans le passé une société idéale. Simone de Beauvoir, dans Le deuxième sexe, est plus honnête lorsqu’elle écrit :
« Les peuples qui sont demeurés sous la coupe de la déesse-mère, ceux où s’est perpétuée la filiation utérine se sont aussi arrêtés à un stade de civilisation primitive. […] La dévaluation de la femme représente une étape nécessaire dans l’histoire de l’humanité : car c’est non de sa valeur positive mais de la faiblesse de l’homme qu’elle tirait son prestige ; en elle s’incarnaient les inquiétants mystères naturels : l’homme échappe à son emprise quand il se libère de la nature. […] Ainsi le triomphe du patriarcat ne fut ni un hasard ni le résultat d’une révolution violente. Dès l’origine de l’humanité, leur privilège biologique a permis aux mâles de s’affirmer seuls comme sujets souverains ; ils n’ont jamais abdiqué ce privilège ; ils ont aliéné en partie leur existence dans la Nature et dans la Femme ; mais ils l’ont ensuite reconquise…»[1]
Elle ajoute:
« Peut-être cependant si le travail producteur était demeuré à la mesure de ses forces, la femme aurait réalisé avec l’homme la conquête de la nature […] à travers les individus mâles et femelles […] c’est parce qu’elle ne participait pas à sa manière de travailler et de penser, parce qu’elle demeurait asservie aux mystères de la vie, que le mâle n’a pas reconnu en elle un semblable…»[2]
C’est donc le rôle biologique reproducteur de la femme qui est la cause de l’asservissement auquel, dès l’origine, elle a été soumise, et non quelque soudaine révolution patriarcale que Freud lui-même était incapable d’expliquer. Le matriarcat est un stade de l’évolution vers le patriarcat, vers la pleine réalisation de l’homme par lui-même : après avoir adoré la nature dans les femmes, il la domine. S’il est vrai que le sort des femmes a beaucoup empiré sous le patriarcat, leur vie n’avait cependant jamais été facile ; et on peut aisément prouver, en dépit de tout désir nostalgique, que le matriarcat n’apportait pas de solution à l’immémorial asservissement féminin. Il n’était rien de plus qu’une manière différente de déterminer la filiation et la succession, et si les femmes en retiraient plus d’avantages que du patriarcat qui allait suivre, le matriarcat ne leur accordait toutefois pas l’égalité sociale. Être adorée n’est pas synonyme de liberté[3], car cette adoration naît dans le cerveau de quelqu’un d’autre, et ce quelqu’un, c’est l’homme. Ainsi, à tous les stades et dans tous les types de civilisation de l’histoire, la femme a été opprimée en raison de ses fonctions biologiques.
Mais si le passé n’offre pas de véritable modèle, il peut être utile en nous aidant à comprendre la relativité de cette oppression : bien qu’elle soit une condition humaine fondamentale, elle est apparue à des degrés divers et sous différentes formes.
La famille patriarcale n’est que la plus récente d’une série de structures sociales « primaires », qui toutes définissaient la femme comme un être d’une espèce différente, en raison du fait qu’elle seule avait la possibilité de porter des enfants. Ce sont les Romains qui les premiers ont utilisé le mot de famille pour désigner une unité sociale dont le chef régnait sur femme, enfants et esclaves. Sous la loi romaine, il était investi du droit de vie et de mort sur eux tous ; famulus signifie esclave à l’intérieur d’une maison, et familia, l’ensemble des esclaves appartenant à un homme. Mais si le mot fut créé par les Romains, ils n’avaient pas été les premiers à développer cette institution. Lisez l’Ancien Testament ; et par exemple, la description de la suite de la famille de Jacob lorsqu’après une longue séparation il se met en route pour rencontrer son jumeau Ésaü. Cette maisonnée patriarcale primitive n’est que l’une des nombreuses variations que la famille patriarcale a connues dans beaucoup de civilisations différentes, jusqu’à nos jours.
Afin cependant de montrer la nature relative de l’asservissement des enfants, il nous suffira, plutôt que de comparer les différentes formes de la famille patriarcale à travers l’histoire, d’examiner le développement de son type le plus récent, la cellule familiale patriarcale. Car sa très brève histoire, qui remonte principalement au XIVe siècle, est révélatrice : l’élaboration des valeurs familiales qui nous sont les plus chères dépend de certaines conditions culturelles, et ne repose nullement sur des fondations immuables. Examinons l’évolution de la cellule familiale – et du concept qu’elle a créé: l’enfance – du Moyen Âge jusqu’à nos jours, en fondant notre analyse sur l’ouvrage de Philippe Aries : L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime.
La cellule familiale moderne n’est qu’un développement récent. Aries indique que la famille telle que nous la connaissons n’existait pas au Moyen Âge, et ne s’est élaborée que peu à peu à partir du XIVe siècle. Jusqu’alors, le mot « famille » signifiait essentiellement la lignée ; l’ascendance par le sang importait davantage que l’unité conjugale. Aux yeux de la loi, et en particulier lors des transferts de propriété, les biens appartenaient en communauté au mari et à la femme, et les enfants étaient codétenteurs de l’héritage. Ce n’est que vers la fin du Moyen Âge, avec l’accroissement de l’autorité paternelle dans la famille bourgeoise, que la communauté du couple conjugal fut abolie, et que l’héritage commun des fils fut abandonné au profit de l’aîné. Aries montre comment l’iconographie reflète les valeurs qui avaient cours dans la société du Moyen Âge : on représentait généralement soit une personne seule, soit au contraire de nombreux convives festoyant dans des lieux publics ; les scènes d’intérieur manquent, car on vivait peu « chez soi ». À cette époque, personne ne se retirait dans un « groupe primaire » privé. Le groupe familial se composait de très nombreux individus, qui y pénétraient et en repartaient constamment. Sur les domaines des nobles, il y avait des foules entières de serviteurs, de vassaux, de musiciens, de gens de toutes classes, et aussi bon nombre d’animaux, selon l’ancienne tradition de la maisonnée patriarcale. Même si l’individu quittait ces échanges sociaux continus pour choisir la vie spirituelle ou intellectuelle, il participait là aussi à une communauté.
Cette famille médiévale – l’honneur du lignage chez les classes supérieures ; pour les autres, rien de plus que le couple conjugal vivant parmi la communauté – devint graduellement la cellule réduite que nous connaissons. Aries décrit ainsi cette transformation :
« C’était comme si un corps polymorphe et rigide avait été démembré et remplacé par une foule de petites sociétés, les familles, et par quelques groupes de masse, les classes. »[4]
Une telle transformation amena de profonds changements dans la civilisation, tout en affectant la structure psychique même de l’individu. On envisageait maintenant de manière différente le cycle vital individuel, et c’est ainsi qu’apparut l’idée d’« adolescence », notion qui n’avait jamais existé auparavant. Parmi ces nouvelles conceptions des étapes de la vie, la plus importante était l’enfance.
1. Le mythe de l’enfance
Au Moyen Âge, l’enfance n’existait pas. On se faisait alors des enfants une idée profondément différente de la nôtre. Non seulement on ne cherchait pas à se placer de leur point de vue mais, littéralement, on n’avait pas même conscience que les enfants puissent être distincts des adultes. Les petits garçons et les petites filles de l’iconographie médiévale sont des adultes en miniature, et ils reflètent une réalité sociale tout à fait différente de la nôtre. Les enfants d’alors étaient de véritables petits adultes, appartenant à la classe et au nom qui les avaient vus naître, destinés à accéder à une position sociale nettement déterminée. Un enfant se considérait lui-même déjà comme l’adulte qu’il allait devenir, franchissant les degrés de son apprentissage ; il était déjà son moi futur et puissant, mais avait conscience d’être au stade de « quand j’étais petit ». Il entrait presque immédiatement dans les différentes étapes de sa vie d’adulte.
On distinguait si peu les enfants des adultes qu’aucun vocabulaire particulier n’existait pour les décrire : ils partageaient les termes de la subordination féodale ; ce n’est que plus tard, quand l’enfance commença à être considérée comme un état différent, que ce vocabulaire commun se scinda. Il s’agissait d’ailleurs d’une communauté fondée sur la réalité : les enfants ne différaient des adultes que par leur dépendance économique. On les utilisait comme une classe de domestiques transitoire, à ceci près que, comme tous les adultes commençaient dans cette classe, elle n’était pas considérée comme inférieure. Tous les enfants étaient littéralement des serviteurs : c’était leur apprentissage de la vie adulte. En France d’ailleurs, on a longtemps considéré qu’il n’était pas dégradant de servir à table, car c’était un art que pratiquait toute la jeune aristocratie. L’intimité traditionnelle des enfants et des serviteurs se poursuivit jusqu’au vingtième siècle : lorsque les classes s’isolèrent de plus en plus les unes des autres, cette intimité fut considérée comme une cause de grande corruption morale pour les enfants des classes supérieure et moyenne.
L’enfant n’était donc qu’un membre parmi d’autres au sein de la grande maisonnée patriarcale, et sa présence n’était pas même essentielle à la vie familiale. C’était toujours une personne étrangère à la famille qui s’occupait de lui lorsqu’il était tout petit, puis on l’envoyait faire son apprentissage dans une autre maison dès l’âge de sept ans, jusqu’à quatorze ou dix-huit ans. Cet apprentissage consistait souvent, tout au moins en partie, en services domestiques. L’enfant n’était donc jamais très dépendant de ses parents, qui n’avaient à son égard que la responsabilité de lui assurer un minimum de bien-être. Eux-mêmes n’avaient pas « besoin » de leurs enfants – il est certain que les enfants ne suscitaient aucune adoration. D’ailleurs, le taux élevé de la mortalité infantile n’aurait pu que décourager ce sentiment, et de plus, les parents formaient à la vie adulte les enfants des autres. Enfin, les maisonnées étaient si grandes, pleines de nombreux serviteurs véritables aussi bien que d’une constante troupe de visiteurs, d’amis et de clients, que la dépendance d’un enfant, ou même simplement ses contacts avec l’un de ses parents en particulier, étaient limités ; si une relation existait entre eux, elle était plutôt de type avunculaire[5].
La transmission de l’expérience d’une génération à l’autre était assurée par la participation quotidienne des enfants à la vie des adultes – aucune ségrégation ne les isolait dans des appartements, des écoles ou des activités spéciales. Puisque le but recherché était de préparer l’enfant à la vie adulte le plus rapidement possible, on pensait, tout à fait raisonnablement, qu’une telle ségrégation ne pouvait que retarder son développement. À tous égards, l’enfant était intégré dès que possible à l’ensemble de la communauté : il n’y avait ni jouets, ni jeux, ni vêtements, ni classes conçus spécialement pour les enfants. Les jeux réunissaient des membres de tous les groupes d’âge. Les enfants participaient aux fêtes de la communauté adulte. Les écoles (seulement pour les métiers spécialisés) dispensaient leur enseignement à ceux qui le désiraient, quel que soit leur âge : l’apprentissage était ouvert aux enfants comme aux adultes.
Après le XIVe siècle, avec le développement de la bourgeoisie et de la science expérimentale, cette situation commença à évoluer lentement. L’idée de l’enfance apparut comme un complément à la famille moderne. Un vocabulaire destiné à décrire l’enfance et les enfants fut créé (par exemple, « bébé ») et un autre vocabulaire fut spécialement destiné à s’adresser à eux : l’usage d’un langage enfantin remonte au XVIIe siècle et s’est répandu jusqu’à devenir un art et une manière de vivre. Il y a toutes sortes de raffinements modernes à ce langage : certaines personnes l’emploient à tout moment, et plus particulièrement certains hommes avec leurs flirts, qu’ils traitent comme de grands enfants. Les jouets ne firent leur apparition qu’à partir de 1600, et même alors, on ne les utilisait que pour les enfants de moins de trois ou quatre ans. Les premiers jouets n’étaient que des répliques, à l’échelle enfantine, d’objets d’adultes : le cheval de bois remplaçait le cheval véritable que l’enfant était trop petit pour enfourcher. Mais à la fin du XVIIe siècle les objets spécialement créés pour les enfants s’étaient répandus. C’est de cette époque également que datent les jeux réservés aux enfants (en fait il s’agissait d’une simple division : certains jeux partagés jusqu’ici par les enfants et les adultes furent abandonnés aux enfants et aux classes inférieures de la société, tandis que d’autres furent, à partir de cette époque, repris par les adultes de manière exclusive, et devinrent les « jeux de société » des classes supérieures).
Ainsi, au XVIIe siècle, la mode était à l’enfance. Aries montre comment l’iconographie reflétait elle aussi cette transformation, comment par exemple, les représentations glorifiées de la relation entre mère et enfant (l’Enfant Jésus et Marie) étaient de plus en plus nombreuses, et plus tard, aux XVe et XVIe siècles, les tableaux d’intérieur et les scènes familiales, et même les portraits d’enfants, entourés de tous les ornements de l’enfance. Rousseau, parmi d’autres, élabora une idéologie de l’enfance. On parlait beaucoup de la pureté des enfants et de leur « innocence ». On s’inquiétait de leur éviter tout contact possible avec le mal. Le « respect » des enfants comme des femmes, inconnu avant le XVIe siècle, c’est-à-dire tant qu’ils faisaient encore partie de la société, devenait nécessaire à présent qu’ils formaient un groupe asservi et nettement délimité. Leur isolement et leur ségrégation avaient commencé. La nouvelle famille bourgeoise, centrée sur les enfants, exigeait une surveillance constante. L’indépendance antérieure était abolie.
L’histoire du costume de l’enfant démontre l’importance de ces transformations. Le costume était un moyen d’indiquer le rang social et la fortune – ce qu’il est toujours, surtout pour les femmes. De nos jours encore, et surtout en Europe, toute incorrection dans la manière de s’habiller soulève la consternation car c’est une faute que de ne pas « garder son rang » ; autrefois, lorsque les vêtements étaient chers et que l’on ne connaissait pas la production de masse, cette fonction de l’habillement était encore plus importante. Comme la manière de se vêtir indique clairement les disparités de sexe et de classe, l’histoire de la mode enfantine nous renseigne utilement sur la vie des enfants.
Les premiers costumes conçus pour les enfants apparurent à la fin du XVIe siècle, date importante pour la formation de l’idée d’enfance. L’habillement des enfants fut tout d’abord modelé sur celui que portaient les adultes autrefois, comme c’était le cas pour les classes inférieures qui portaient les anciens vêtements de l’aristocratie. Cet archaïsme symbolisait l’exclusion grandissante des enfants, et du prolétariat, de la vie publique contemporaine. Avant la Révolution Française, pour distinguer davantage encore la classe inférieure, on vit apparaître des pantalons semblables à ceux que portaient les marins, et cette coutume s’étendit également aux enfants mâles de la classe supérieure. Nous voyons ainsi clairement que ces enfants formaient une classe inférieure au sein même de la classe supérieure. Cette différenciation des fonctions du costume afin d’intensifier la ségrégation et de faire nettement apparaître les distinctions de classes est mise en lumière par une coutume des XVIIe et XVIIIe siècles, qui ne peut s’expliquer autrement : les enfants, garçons ou filles, portaient deux larges rubans attachés au vêtement sous chaque épaule et flottant par-derrière. Ces rubans n’avaient apparemment d’autre fonction que de désigner l’enfance par une caractéristique vestimentaire.
Le costume de l’enfant mâle révèle particulièrement les rapports du sexe et de l’enfance avec la classe sociale. D’une manière générale, un garçon traversait trois phases : il portait, après l’époque des langes, des vêtements féminins ; vers l’âge de cinq ans, sa robe comportait certains éléments du costume masculin de l’adulte, par exemple le col ; en grandissant, il pouvait enfin arborer les insignes militaires au grand complet. Le costume porté par le jeune garçon sous Louis XVI était à la fois archaïque (col Renaissance), de rang inférieur (pantalons de marin), et de style militaire (jaquette et boutons). L’habillement devint une des formes d’initiation à l’âge d’homme, l’enfant réclamant, pour employer les termes d’aujourd’hui, des « pantalons longs ». Ces stades d’initiation à l’âge d’homme, tels qu’ils apparaissent dans l’histoire de la mode enfantine, correspondent parfaitement au complexe d’Œdipe tel que je l’ai présenté au chapitre précédent[6]. Les petits garçons commencent leur vie dans la classe, inférieure, des femmes. Habillés comme des femmes, ils ne se distinguent pas des petites filles ; comme elles d’ailleurs ils s’identifient à cette époque à leur mère, à la femme ; et comme elles ils jouent à la poupée. Lorsque l’enfant atteint l’âge de cinq ans environ, on tente de le détourner de sa mère et de l’encourager graduellement à imiter son père (col masculin) : c’est la période transitoire du complexe d’Œdipe. Enfin l’enfant reçoit la récompense de sa rupture avec la femme et de son transfert d’identification à l’homme : c’est le costume d’adulte, les insignes militaires étant la promesse que les pleins pouvoirs du mâle lui seront acquis à l’âge d’homme.
Et qu’en était-il de l’habillement des filles ? Il faut noter ici un fait étonnant : l’enfance ne concernait pas les femmes. L’enfant de sexe féminin passait directement des langes à des vêtements semblables à ceux d’une femme adulte. Elle n’allait pas à l’école, institution qui, comme nous le verrons, structurait l’enfance. À l’âge de neuf ou dix ans, elle se comportait, littéralement, comme une « vraie petite femme » ; ses activités ne différaient pas de celles des femmes adultes. Dès qu’elle était pubère, et parfois dès l’âge de dix à douze ans, elle était mariée à un homme beaucoup plus âgé.
L’idée de l’enfance reposait donc sur un système de classes : les filles tout comme les garçons de la classe inférieure, n’avaient pas à être distingués par des vêtements particuliers, puisque leur rôle à l’âge adulte serait de servir les hommes de la classe supérieure ; l’initiation à la liberté n’était pas nécessaire. Les filles n’avaient aucune raison de connaître des changements vestimentaires puisqu’en grandissant elles n’avaient rien de plus à attendre : à l’âge adulte, les femmes demeuraient, par rapport aux hommes, une classe inférieure. Les enfants de la classe laborieuse étaient, et restent encore, libres des contraintes vestimentaires car leurs modèles adultes étaient également des « enfants » par rapport à la classe dirigeante. Par contre, les garçons des classes moyenne et supérieure partageaient temporairement le statut des femmes et des travailleurs, et s’élevaient ensuite graduellement et quittaient les rangs subalternes. Les femmes et les garçons de la classe inférieure y restaient. Ce n’est pas non plus une coïncidence si la féminisation des habits que portaient les petits garçons fut abolie à l’époque même où les féministes menaient campagne pour la suppression des vêtements féminins contraignants. Ces deux styles d’habillement étaient intégralement liés à la sujétion de classe et à l’infériorité du rôle féminin. Le petit Lord Fauntleroy porta d’abord le jupon. (Mon propre père se souvient encore du jour où il porta son premier pantalon, et même aujourd’hui dans certains pays européens, ces coutumes d’initiation par le vêtement se pratiquent encore.)
Nous pouvons voir également que le système de classe d’où émergea le concept d’enfance donna également naissance à un certain type d’éducation. Si l’enfance n’était alors qu’une idée abstraite, l’école moderne fut l’institution qui en fit une réalité (dans notre société, les conceptions nouvelles sur le cycle de la vie s’organisent autour d’institutions : par exemple l’idée de l’adolescence, concept du XIXe siècle, devait faciliter la conscription pour le service militaire). L’éducation moderne par l’école était en fait l’application pratique du nouveau concept de l’enfance. L’instruction était vue sous un nouvel angle : elle n’était plus réservée aux seuls hommes d’église et aux lettrés, mais fut largement répandue pour devenir l’instrument normal de l’initiation sociale, de l’évolution de l’enfance à l’âge d’homme. (Pendant des siècles, ceux qui ne devaient jamais acquérir le véritable statut d’adulte, c’est-à-dire les filles, et les garçons de la classe laborieuse, n’allèrent pas à l’école[7].)
En effet, contrairement à une opinion répandue, le développement de l’école moderne a peu de rapport avec l’érudition traditionnelle du Moyen Âge ou la culture des arts libéraux et des humanités pendant la Renaissance (on sait d’ailleurs que les humanistes de la Renaissance comptaient dans leurs rangs de nombreux enfants précoces et des femmes lettrées ; ils insistaient sur le développement de l’individu, quel que soit son âge ou son sexe). Selon Aries, l’histoire littéraire exagère l’importance du rôle joué par la tradition humaniste dans la structure de nos écoles. Les architectes et innovateurs véritables furent les moralistes et pédagogues du XVIIe siècle, les Jésuites, les Oratoriens et les Jansénistes. Ces hommes furent à l’origine du concept de l’enfance, comme de son institutionnalisation sous la forme de l’idée moderne d’instruction. Ce sont eux qui les premiers épousèrent la cause de la faiblesse et de l’« innocence » de l’enfance ; ils placèrent l’enfant sur un piédestal, exactement comme on l’avait fait pour la femme ; ils prônèrent la séparation des enfants du monde adulte. La « discipline » était le leitmotiv de l’instruction moderne, bien plus d’ailleurs que la transmission de la connaissance ou d’informations. Pour eux en effet la discipline était un instrument de perfectionnement moral et spirituel ; ils l’adoptaient pour sa valeur intrinsèque, morale et ascétique, plus que pour son efficacité à diriger le travail en commun de groupes nombreux. La répression elle-même était donc adoptée comme une valeur spirituelle.
Ainsi, la fonction de l’école devint « d’élever les enfants », et s’accomplissait grâce à une « psychologie de l’enfant » disciplinaire. Aries cite le « Règlement pour les enfants » de Port-Royal, recueil précurseur de nos manuels de formation des maîtres:
« Il faut veiller parfaitement les enfants, ne les laissant jamais seuls en quelque lieu que ce soit, saines ni malades. […] il faut que cette garde continuelle soit faite avec douceur et une certaine confiance qui leur fasse plutôt croire qu’on les aime, et que ce n’est que pour les accompagner qu’on est avec elles. »[8]
Ce passage écrit en 1612 montre déjà le ton affecté caractéristique de la psychologie moderne de l’enfant, et illustre également la distance particulière – volontaire à cette époque, mais aujourd’hui devenue pratiquement inconsciente – qui séparait les adultes des enfants.
Ce nouvel enseignement parvint à séparer les enfants du monde adulte pendant des périodes de temps de plus en plus longues. Mais une telle ségrégation et le sévère processus d’initiation exigé pour effectuer cette transition indiquaient un manque de respect croissant, une sous-estimation systématique des capacités de l’enfant.
La précocité si répandue au Moyen Âge et dans les temps qui suivirent est tombée, à notre époque, à près de zéro[9]. Aujourd’hui, par exemple, les exploits de Mozart enfant, dans le domaine de la composition, apparaissent difficilement croyables. Mais de son temps, ce n’était pas si exceptionnel. Beaucoup d’enfants alors jouaient et composaient de la musique, et participaient à de nombreuses autres activités d’adultes. Nos leçons de piano d’aujourd’hui ne sauraient leur être comparées. En réalité, elles ne sont qu’une manifestation de la sujétion à laquelle est contraint l’enfant livré aux caprices des adultes (de la même manière, les « talents féminins » traditionnels, comme la broderie, n’étaient qu’une activité superficielle). Et il est significatif que ces « talents » soient plus souvent cultivés chez les filles que chez les garçons ; lorsque des garçons étudient le piano, c’est le plus souvent parce qu’ils sont exceptionnellement doués ou que leurs parents sont musiciens.
Aries cite le Journal sur l’enfance et la jeunesse de Louis XIII, d’Heroard ; il s’agit du compte-rendu détaillé des années d’enfance du dauphin, écrit par son médecin, qui indique que le dauphin jouait du violon et chantait tout le temps, à l’âge de dix-sept mois. Mais le dauphin n’était pas un génie, et prouva ultérieurement qu’il n’était pas plus intelligent que la plupart des aristocrates de l’époque. Cependant, il ne jouait pas que du violon : le récit de l’enfance du dauphin, né en 1601 – et doué seulement d’une intelligence moyenne – nous montre que nous sous-estimons les possibilités des enfants. Nous y apprenons qu’à l’âge où il jouait du violon, il jouait aussi au mail, qui était pour les adultes d’alors l’équivalent du golf, et à la paume ; il parlait ; il s’amusait également à des jeux de stratégie militaire. À trois et quatre ans respectivement, il commença à lire et à écrire. À quatre et cinq ans, bien qu’il jouât encore à la poupée (!), il tirait à l’arc, jouait aux cartes et aux échecs (à six ans) avec les adultes, et à beaucoup d’autres jeux de grande personne. À tout âge, dès qu’il fut capable de marcher, il participait à toutes les activités des adultes telles qu’elles étaient, dansant, jouant la comédie, et à toutes leurs distractions. À l’âge de sept ans le dauphin commença à porter des vêtements masculins semblables à ceux des adultes, ses poupées lui furent retirées, et des précepteurs commencèrent à diriger son éducation; il se mit à chasser, à faire de l’équitation, à tirer au fusil et à jouer à des jeux d’argent. Mais Aries remarque :
« N’en exagérons pas l’importance [de cet âge de sept ans qui marquait une étape]. S’il ne joue plus, ou ne devrait plus jouer, à la poupée, le jeune dauphin continue la même vie. […] Un peu plus de poupées et de jeux d’Allemagne, avant sept ans, plus de chasse, de cheval, d’armes, peut-être plus de comédie, après sept ans : le changement se fait insensiblement dans cette longue suite de divertissements que l’enfant emprunte aux adultes, ou partage avec eux.»[10]
Il ressort très clairement de cette description, me semble-t-il, que la vie des enfants, avant l’apparition de la cellule familiale et de l’instruction scolaire moderne, se distinguait aussi peu que possible de la vie des adultes. La formation de l’enfant était faite par les adultes qui l’entouraient, et dès qu’il le pouvait, il entrait dans leur société. Une discrimination sexuelle des fonctions sociales avait lieu vers sept ans – compte tenu du patriarcat qui régnait à cette époque, il fallait bien que cette discrimination se fasse, mais elle n’était pas encore compliquée par le rang inférieur des enfants eux-mêmes. La distinction ne faisait que séparer les femmes des hommes, et non les enfants des adultes. Un siècle plus tard, la situation commencerait à changer, la sujétion des femmes et celle des enfants étant de plus en plus complexes et interdépendantes.
En résumé, l’apparition de la cellule familiale centrée sur l’enfant rendit nécessaire une institution qui puisse structurer l’« enfance » de telle sorte qu’elle garde les enfants le plus longtemps possible sous la dépendance des parents. Les écoles se multiplièrent, remplaçant l’étude et l’apprentissage par une éducation théorique, dont la fonction était de « discipliner » plutôt que d’enseigner la connaissance pour elle-même. Il n’est donc pas étonnant que l’instruction scolaire moderne retarde le développement de l’enfant au lieu de l’accélérer. Si l’on séquestre les enfants loin du monde adulte – les adultes ne sont après tout que de grands enfants qui ont l’expérience du monde – et si on les rassemble dans la proportion artificielle de un adulte pour vingt enfants et plus, comment le résultat final pourrait-il être autre chose qu’une égalisation de l’ensemble de ces enfants à un niveau moyen (médiocre) d’intelligence ? Et comme si cela ne devait pas suffire, une distinction selon les âges fut instaurée après le XVIIIe siècle, avec un cloisonnement rigide des « classes ». Il n’était même plus possible aux enfants de se guider sur leurs aînés un peu plus âgés et plus expérimentés. La plus grande partie de leurs heures de veille était confinée à l’intérieur d’un groupe soigneusement limité à leurs contemporains[11], et on leur donnait à absorber un « programme ». Une aussi rigide gradation des classes augmentait les étapes qu’il fallait franchir pour devenir adulte, et il était ainsi plus difficile à un enfant de trouver son propre rythme. La motivation qui le poussait à l’étude devenait extérieure, c’était une recherche de l’approbation, qui tuait à coup sûr toute originalité. Les enfants, autrefois considérés simplement comme des êtres jeunes (de la même manière que dans un jeune chiot qui grandit, on voit le futur chien), formaient maintenant une société bien distincte de celle des adultes, avec sa propre classification interne encourageant la compétition : « Le type le plus formidable du quartier », « le garçon le plus fort de l’école », etc. Les enfants pensaient obligatoirement en termes de hiérarchie dont l’expression suprême est : « Quand je serai grand… » L’école reflétait en cela le monde extérieur où, selon les âges et les classes sociales, s’instaurait une ségrégation de plus en plus marquée.
*
En conclusion : le développement de la famille moderne signifiait la désagrégation d’une grande société intégrée en petites unités centrées sur elles-mêmes. L’enfant, à l’intérieur de la cellule conjugale, devenait maintenant important ; s’il en était le résultat, il était aussi la cause de sa continuité. Il devint souhaitable de garder les enfants à la maison le plus longtemps possible afin de les lier psychologiquement, financièrement et émotionnellement à l’unité familiale jusqu’à ce qu’ils soient prêts à en créer une nouvelle. C’est dans ce dessein que fut créé l’Âge de l’Enfance. (On lui attribua plus tard des prolongements, comme l’adolescence, et aux États-Unis on distingue au XXe siècle les teenagers, les étudiants et les « jeunes adultes ».) L’idée d’enfance impliquait qu’il s’agissait d’une espèce différente de celle des adultes, non seulement en âge, mais de par sa nature même. Une idéologie fut élaborée à l’appui de cette théorie, et des traités fantaisistes furent écrits sur l’innocence des enfants, « petits anges, si proches de Dieu ». On crut alors que les enfants étaient asexués et les jeux sexuels d’enfants une aberration – ce qui était en contradiction évidente avec les coutumes de l’époque précédente, où les enfants étaient, dès leur plus jeune âge, en contact avec les réalités de la vie[12]. Reconnaître la sexualité des enfants aurait en effet hâté leur arrivée à l’âge adulte, qui devait être retardée à tout prix : des vêtements particuliers exagérèrent bientôt les différences physiques distinguant les enfants des adultes ou même d’autres enfants plus âgés ; ils ne partagèrent plus les jeux des grandes personnes ni leurs réunions (les enfants d’aujourd’hui n’assistent généralement pas aux réceptions), mais on leur donna des jeux et des objets conçus pour leur usage propre (jouets) ; l’art de conter, qui était autrefois un divertissement social, fut relégué à la distraction des enfants, conduisant ainsi à la littérature enfantine spécialisée de notre époque ; les adultes s’adressèrent aux enfants dans un langage particulier, et veillèrent à ne pas parler de choses sérieuses en leur présence (« pas devant les enfants ») ; la sujétion aux adultes fit des « bonnes manières » une institution à l’intérieur de la maison (« les enfants doivent être vus et non pas entendus »). Mais rien de tout cela ne serait parvenu à faire réellement des enfants une classe sociale asservie si une institution n’avait été créée précisément à cette fin : l’école moderne.
L’idéologie de l’école était l’idéologie de l’enfance. Elle était fondée sur le principe que les enfants avaient besoin de « discipline », qu’ils étaient des créatures particulières qu’il fallait traiter de façon spéciale (psychologie de l’enfant, éducation, etc.), ce qui devait être plus commode si on les mettait avec leurs semblables dans un espace distinct, à l’intérieur de groupes constitués d’enfants d’âges aussi proches que possible. L’école était l’institution qui donnait à l’enfance une structure en isolant les enfants du reste de la société par une sorte de ségrégation, retardant ainsi leur maturité et les empêchant également d’acquérir les connaissances spécialisées qui pourraient les rendre utiles à la société. En conséquence, ils restaient économiquement dépendants de leurs parents de plus en plus longtemps ; les liens familiaux n’étaient donc pas brisés. J’ai signalé qu’il existe un lien marqué entre la hiérarchie familiale et les classes sociales. Engels[13] a observé qu’à l’intérieur de la famille le mari est le bourgeois, et la femme et les enfants le prolétariat. On a noté des similitudes entre les enfants et les groupes sociaux asservis des classes laborieuses ou autres; on a également fait des études qui montrent que leur psychologie est la même. Nous avons vu comment l’évolution des vêtements prolétaires était parallèle à celle du costume enfantin, et comment les jeux abandonnés par les adultes des classes supérieures devenaient ceux des enfants et des « manants » ; ceux-ci, disait-on, aimaient « travailler de leurs mains », la cérébralité des abstractions auxquelles se livraient les adultes de sexe masculin étant bien au-dessus d’eux. On les considérait comme heureux, sans soucis et doués d’un bon naturel, « plus en contact avec la réalité » ; on leur rappelait la chance qu’ils avaient de se voir épargnés les ennuis de l’âge adulte et responsable – mais ils les désiraient. Leurs relations avec la classe dominante étaient, pour les uns comme pour les autres, teintées de crainte, de méfiance et de sournoiserie, superficiellement revêtues de charme.
Le mythe de l’enfance trouve un parallèle plus étroit encore dans le mythe de la féminité. Les femmes et les enfants étaient considérés comme asexués et par conséquent « plus purs » que les hommes. Leur statut inférieur était mal dissimulé sous un « respect » étudié. On ne parlait pas de choses sérieuses, on ne disait pas non plus de gros mots, devant des femmes ou des enfants ; on ne les rabaissait pas ouvertement, mais à leur insu (quant aux jurons, ils obéissent à une double convention : un homme a le droit de blasphémer le monde parce que le pouvoir de condamner lui appartient – mais la même malédiction dans la bouche d’une femme ou d’un mineur, c’est-à-dire d’un « homme » incomplet à qui le monde n’appartient pas encore, devient une inconvenance ou pis encore). Femmes et enfants étaient désignés par des vêtements ridicules et encombrants, et se voyaient octroyer des besognes spéciales (respectivement entretien de la maison et devoirs à la maison) ; ils étaient considérés comme mentalement déficients (« Que peut-on bien attendre d’une femme ? » « Il est trop petit pour comprendre. »). Tous les échanges avec le monde extérieur devenaient pour un enfant l’occasion de faire le beau. Il apprenait à se servir d’enfantillages pour obtenir indirectement ce qu’il voulait (« Il fait encore une colère ! »), exactement comme une femme apprenait à se servir de sa féminité (« La voilà qui pleure à nouveau ! »). Chaque fois que l’enfant pénétrait dans le monde adulte, il avait l’impression de partir pour une terrible expédition à laquelle il fallait survivre. C’est ce que confirme d’ailleurs la différence de comportement des enfants, lorsqu’ils se trouvent avec leurs semblables ou bien lorsque, en compagnie d’adultes, ils se montrent guindés ou timides – tout à fait comme les femmes qui agissent de manière différente selon qu’elles sont entre elles ou bien avec des hommes. Dans chaque cas, l’éducation reçue a volontairement souligné une différence physique en créant des vêtements, des règles de savoir-vivre, une manière d’être et des activités propres, jusqu’à ce que cette accentuation artificielle commence à paraître naturelle et même instinctive ; ce processus d’exagération permet de former facilement des clichés : l’individu semble être une espèce différente d’animal humain, avec un code de lois et de conduites particulier (« Je ne comprendrai jamais les femmes ! » ou : « Vous ne connaissez rien à la psychologie des enfants ! »).
L’argot contemporain reflète ce côté animal : les enfants sont des « lapins », des « chatons », des « canards », on appelle les femmes des « souris », des « poules », des « oies », des « juments ». Une terminologie similaire n’est utilisée pour les hommes que dans un sens injurieux, ou bien encore, de manière plus générale, elle s’applique aux hommes d’une classe asservie. On l’utilise beaucoup plus rarement, et souvent avec une nuance sexuelle.
L’asservissement des femmes et des enfants est beaucoup plus difficile à combattre du fait qu’il s’enrobe de mots tels que « charmant » et « adorable » Un enfant peut-il répondre à la tante stupide qui se précipite sur lui pour le cajoler ? Une femme peut-elle se permettre de froncer les sourcils lorsqu’un passant inconnu prend la liberté de l’importuner ? Lorsqu’il lui lance : « Salut mignonne, ça va ? », si elle lui répondait : « Ça irait mieux si je ne te connaissais pas », il grommellerait : « Qu’est-ce qu’elle a, cette pute ? » Très souvent la véritable nature de ces remarques apparemment aimables se révèle lorsque la femme ou l’enfant ne sourient pas comme il se doit : « Vieille pouffe ! C’est toujours pas moi qui te baiserai, même si tu souris avec ta chatte »… « Sale petit morveux ! Si j’étais ton père je te mettrais une raclée dont tu te souviendrais ! » Leur violence est étonnante. Ces hommes en veulent à la femme ou à l’enfant de n’avoir pas été « aimables ». Comme cela les rend mal à l’aise de savoir que la femme, l’enfant, le Noir ou l’ouvrier ronchonnent, les groupes asservis doivent paraître aimer leur servitude, sourire et minauder même s’ils se sentent profondément malheureux. Le sourire de la femme ou de l’enfant indique l’acceptation par la victime de sa propre condition.
Pour ma part, j’ai dû me contraindre à abandonner ce sourire factice, plaqué sur toute teenage girl comme un tic nerveux. Et cela signifiait que je souriais rarement, car en réalité, pour ce qui était du véritable sourire, peu de raisons m’y poussaient. La démonstration dont je rêvais pour le mouvement de libération des femmes était un boycott du sourire : dès sa déclaration, toutes les femmes cesseraient immédiatement de sourire pour plaire aux autres, et ne le feraient par conséquent que lorsque quelque chose leur plairait. De la même manière, la libération des enfants exigerait qu’on ne leur impose plus de câlins dont ils n’ont pas envie (bien entendu, cela impliquerait une société où les câlins ne seraient plus désapprouvés ; à l’heure actuelle, la seule marque d’affection que reçoit un enfant est souvent une démonstration artificielle – mais peut-être préfère-t-il cela à l’absence totale de tout geste affectueux). Beaucoup d’hommes ne peuvent comprendre que leurs familiarités ne sont pas un privilège. Leur arrive-t-il seulement de penser que l’être véritable caché sous cette apparence d’animal-enfant ou d’animal-femme puisse ne pas aimer recevoir une caresse ou même une simple remarque de leur part ? Imaginez la consternation d’un homme qui, dans la rue, verrait un étranger venir sur lui, lui tapoter la joue en gargouillant et en marmonnant des enfantillages, sans égard à sa profession ou à sa « virilité ».
En résumé, si les membres de la classe laborieuse et si les groupes minoritaires « se conduisent comme des enfants », c’est bien parce que, inversement, les enfants de tous les milieux sont de classe inférieure, exactement comme les femmes l’ont toujours été. La naissance de la cellule familiale moderne, avec son émanation: « l’enfance », a resserré le nœud coulant autour de ce groupe qui était déjà économiquement dépendant. Elle étendait et renforçait ce qui n’avait été qu’une dépendance temporaire en faisant appel aux moyens habituels : élaboration d’une idéologie particulière, d’un style de vie distinct, de manières, de langage, de costumes spéciaux, particuliers, etc. Et le renforcement et l’exagération de la dépendance de l’enfant ont enchaîné la femme à la maternité autant qu’il était possible. Femmes et enfants se trouvaient donc maintenant embarqués dans le même bateau. Les contraintes exercées sur eux se renforçaient mutuellement. À la mystique qui chantait la gloire de donner la vie, la grandeur de la créativité féminine « naturelle », s’ajoutait maintenant une mystique nouvelle, célébrant le culte de l’enfance elle-même et la « créativité » de l’éducation. (« Mais chérie, que pourrait-il y avoir de plus créatif que d’élever un enfant ? ») Nous avons aujourd’hui oublié ce qu’avait prouvé l’histoire: « élever » un enfant équivaut à retarder son développement. Le meilleur moyen d’élever un enfant, c’est de NE PAS INTERVENIR.
2. Notre époque : l’exaltation du mythe
Nous avons vu comment le confinement de plus en plus marqué de la vie familiale a causé l’accroissement de la soumission de ses membres dépendants, femmes et enfants. Les mythes associés de la féminité et de l’enfance furent les instruments de cette sujétion. Pendant l’ère victorienne, ils atteignirent à une grandeur épique, provoquant finalement la révolte des femmes – dont l’enfance subit superficiellement le contrecoup. Cette révolte fut brisée avant d’avoir pu abattre ces mythes, qui semblèrent disparaître, mais revinrent ensuite d’une façon plus insidieuse, compliquée par la société de consommation. En réalité, rien n’était changé. La tentative post-victorienne d’émancipation des femmes fut subtilement sabotée ; le sort des enfants, qui en était le corollaire, se régla de la même manière.
La pseudo-émancipation des enfants est le parallèle exact de la pseudo-émancipation des femmes : bien que nous ayons aboli tous les signes extérieurs de soumission – vêtements particuliers et gênants, canne du maître d’école – il ne fait aucun doute que, dans le style propre du XXe siècle, le mythe de l’enfance est prospère et atteint une dimension énorme : des industries entières sont fondées sur la production de jouets spécialisés, de jeux, d’aliments infantiles, de « petits déjeuners », de livres, de bandes dessinées, de bonbons particulièrement attrayants, etc. Des spécialistes de l’analyse de marché étudient la psychologie des enfants afin d’élaborer des produits qui leur plairont selon leur âge. Il existe une industrie de l’édition, du film et de la télévision conçue pour eux, avec sa propre littérature, ses programmes, ses émissions patronnées par la publicité, il y a même des comités de censure qui décident des produits culturels propres à leur consommation. Une prolifération sans fin de livres et de revues instruit les profanes dans l’art d’élever les enfants (Dr Spock, Parents’ Magazine). On trouve des spécialistes en psychologie de l’enfant, en méthodes d’éducation, en pédiatrie, et dans toutes les branches particulières qui se sont développées récemment pour étudier cet animal particulier. L’éducation obligatoire est florissante et suffisamment répandue pour former un filet serré de socialisation (lavage de cerveau) dont même les plus riches ne peuvent plus s’échapper tout à fait. Elle est bien loin, l’époque de Huckleberry Finn : aujourd’hui le tire-au-flanc et le dropout[14] doivent se donner beaucoup de mal s’ils veulent passer à travers l’essaim de spécialistes qui les étudient, de programmes gouvernementaux et d’assistantes sociales qui sont à leurs trousses.
Examinons de plus près cette forme moderne de caricature de l’enfant : il est aussi blond, dodu, et souriant qu’une publicité Kodak. Comme c’est le cas pour les femmes, exploitées en tant que consommatrices, il existe beaucoup d’industries prêtes à profiter de la vulnérabilité physique des enfants (par exemple, aux États-Unis l’aspirine Saint-Joseph pour les enfants) ; mais le mot-clef pour la compréhension de l’enfance moderne est, plus encore que la santé, le bonheur. Nous ne sommes enfants qu’une seule fois, voilà tout. Les enfants doivent être la vivante incarnation du bonheur (les enfants boudeurs, troublés ou inquiets déplaisent d’emblée : ils font mentir le mythe). C’est le devoir des parents de donner à leur enfant une enfance dont il aura d’heureux souvenirs (balançoires, bassins gonflables, jouets, campings, réceptions d’anniversaires, etc.). C’est l’âge d’or dont l’enfant se souviendra lorsqu’il grandira pour devenir un robot comme son père. C’est pourquoi chaque père essaie de donner à son fils ce que lui-même avait ardemment désiré sans pouvoir l’obtenir, à l’âge qui aurait dû être pour lui la période la plus magnifique de son existence. Le culte de l’enfance, en tant qu’âge d’or, est si développé que toutes les autres phases de la vie n’ont de valeur que dans la mesure où elles ressemblent à l’enfance, dans une religion nationale de jeunesse. Les grandes personnes se rendent stupides par la manière envieuse dont elles s’excusent de leur âge (« Bien sûr, chéri, j’ai deux fois ton âge, mais… »). Suivant la croyance générale, un progrès a été fait puisqu’à notre époque on ne trouve plus ces formes d’exploitation traditionnelles, tel le travail des enfants en usine, pratiquées par les générations précédentes. Certains se plaignent même, avec envie, qu’on donne aux enfants trop d’importance, et qu’ils sont trop gâtés (« Quand j’avais ton âge… » est le parallèle de : « Le monde n’appartient plus qu’aux femmes … »).
L’un des plus importants bastions de ce mythe du bonheur est la ségrégation, poursuivie avec rigueur, qui sépare les enfants du reste de la société : l’exagération de leurs traits distinctifs en a presque fait, ce qui était voulu, une race différente. Nos parcs sont la parfaite image de notre société et de sa ségrégation des âges : terrain de jeux pour ces « tendres intouchables » que sont les mères et les jeunes enfants (on y trouve rarement quelqu’un d’autre, comme si un tabou l’interdisait), piscine ou terrain d’athlétisme pour les plus grands, talus ombreux pour les jeunes couples et les étudiants, et des bancs pour vieilles personnes. Toute la vie de l’individu est soumise à cette ségrégation. On a très peu de contacts avec les enfants une fois que ses propres enfants ont grandi. À l’intérieur de l’enfance d’ailleurs, il existe, nous l’avons vu, de rigides cloisonnements, si bien qu’un enfant se sentira gêné si on le voit en compagnie d’un enfant plus jeune que lui (« Pot de colle ! Pourquoi ne vas-tu pas jouer avec ceux de ton âge ? »). Il passe toute sa vie scolaire, qui à notre époque dure assez longtemps, avec des camarades plus jeunes ou plus âgés que lui d’un an ou deux au maximum. Dans les écoles, la gradation est de plus en plus sévère, et se marque par un système complexe de promotions et de sections ; depuis quelque temps on voit même souvent des sections dans les maternelles et les jardins d’enfants. Ainsi, lorsqu’un enfant a grandi et qu’il est en âge de se reproduire, il n’a absolument aucun contact avec les adultes – à l’exception de ceux du petit groupe auquel il appartient – et il n’a aucun contact non plus avec les enfants. En raison du culte de l’enfance, il se souvient à peine de la sienne, souvent tout à fait « bloquée » dans sa mémoire. Déjà, lorsqu’il était petit, il a peut-être tenté de se couler dans le moule créé par le mythe, croyant que tous les autres enfants étaient plus heureux que lui. Plus tard, devenu teenager, il s’est abandonné à une sorte de gaieté désespérée, cherchant à tout prix à « s’amuser », dans l’esprit de : « On n’est jeune qu’une seule fois » – alors qu’en réalité l’adolescence est une période horrible à traverser. (Mais la véritable jeunesse ne se préoccupe pas de l’âge – « Donner la jeunesse aux jeunes, c’est du gaspillage ». La véritable jeunesse s’exprime par une spontanéité réelle, exempte de cette conscience de soi. Faire de cette manière des réserves de bonheur, en prévision du temps où l’on n’en aura plus, est une idée que seule la vieillesse peut concevoir.) Dans une telle absence de contact avec la réalité de l’enfance, chaque jeune adulte est mûr pour entourer les enfants de la sentimentalisation qu’il méprisait probablement lui-même, lorsqu’il était petit. Il se forme donc un cercle vicieux : les jeunes adultes rêvent d’avoir eux-mêmes des enfants, pour tenter désespérément de combler le vide causé par leur séparation artificielle d’avec les jeunes ; pourtant, ce n’est que plus tard, lorsqu’ils se noient dans des problèmes de grossesse, de pouponnage et d’école, dans le favoritisme et les disputes, qu’ils sont forcés de voir, pendant quelques temps, que les enfants sont humains comme nous tous.
Parlons donc de l’enfance telle qu’elle est en réalité, et non telle qu’elle apparaît dans la tête des adultes. Il est évident que la prospérité débordante du mythe de l’enfance s’explique parce qu’il répond aux besoins non des enfants, mais des adultes. Dans une civilisation où les individus sont aliénés, il est difficile de mettre fin à une croyance qui affirme que chacun a, au moins une fois dans sa vie, une période heureuse, dépourvue de toutes corvées et de tous soucis. Puisque cette période merveilleuse n’est visiblement pas la vieillesse, c’est donc qu’on l’a déjà vécue. Voilà qui explique le brouillard de sentimentalité qui noie toute discussion à propos de l’enfance ou des enfants. Chacun voudrait voir en eux la réalisation de son propre rêve intérieur.
*
Ainsi, la ségrégation opère encore de toute sa force pour affermir la sujétion des enfants en tant que classe sociale. Comment, au XXe siècle, se concrétise cette sujétion ?
Dépendance économique et physique.
Notre civilisation actuelle accentue plutôt qu’elle ne compense l’inégalité physique naturelle – infériorité de taille et de force – entre les enfants et les adultes : la loi fait encore des enfants des « mineurs », sans droits civiques, propriété d’un couple de parents qui leur sont arbitrairement imposés (même s’ils ont de « bons » parents, il ne faut pas oublier qu’il y en a autant de « mauvais » que de « bons » et, très vraisemblablement, que les « mauvais » font plus d’enfants que les « bons »). Le nombre d’enfants martyrisés et assassinés montre que les enfants qui ne sont que malheureux ont de la chance. Leur sort pourrait être bien pire. Depuis quelques années seulement les médecins jugent bon de signaler les mauvais traitements, tant les enfants étaient autrefois à la merci de leurs parents. Mais les enfants orphelins sont dans une situation pire encore (de même que la situation d’une femme célibataire est pire que celle d’une femme mariée). Il n’y a d’autre abri pour eux que l’orphelinat, dépotoir de ceux dont on ne veut pas. Mais cette sujétion des enfants s’enracine surtout dans leur dépendance économique. Quiconque a observé un enfant enjôlant sa mère pour lui soutirer une pièce sait que leur dépendance économique leur fait honte. (Les cadeaux sous forme d’argent sont souvent ceux qu’ils préfèrent. Mieux vaut d’ailleurs, dans ce cas, remettre directement l’argent à l’enfant !) Bien qu’ils ne meurent pas de faim (mais ce ne serait pas non plus le cas si les enfants pouvaient travailler : les petits garçons noirs qui font briller les chaussures, mendient, et cultivent divers « rackets », et les petits garçons blancs qui vendent des journaux, sont enviés dans leur quartier), ils ont besoin d’une protection pour survivre, ce qui n’est pas une situation enviable. Cette dépendance extrême ne vaut pas la subsistance qu’elle procure.
C’est dans ce domaine que nous nous trouvons devant l’un des grands axes du mythe moderne : on nous dit que la sauvegarde de l’enfance représente un grand progrès – et l’on imagine immédiatement les pauvres petits décharnés de Dickens peinant dans un puits de mine. Nous avons montré cependant, au cours de la brève histoire de l’enfance évoquée dans ce chapitre, qu’à l’aube de la révolution industrielle les enfants des classes moyennes et supérieures ne travaillaient pas, mais qu’ils se trouvaient en sécurité dans quelque ennuyeux pensionnat, penchés sur l’étude d’Homère et de la grammaire latine. Il est vrai que les enfants de la classe inférieure n’étaient pas plus favorisés que leurs pères, et partageaient les tortures inhumaines auxquelles devaient se soumettre tous les membres de leur classe ; ainsi, à l’époque où régnait l’oisiveté d’Emma Bovary et du petit lord Fauntleroy, il existait aussi des femmes qui épuisaient leurs vies et leurs poumons dans les premières usines textiles, et des enfants qui vagabondaient et mendiaient. Ces différences de vie entre les enfants des diverses classes sociales se sont maintenues jusqu’à l’époque où les femmes ont obtenu le droit de vote, et même jusqu’à nos jours. Les enfants de la classe moyenne étaient une chose possédée et subissaient une distorsion de l’âme pire que celle qui est la nôtre aujourd’hui. Il en allait de même pour les femmes. Mais en contrepartie, elles bénéficiaient au moins d’une protection économique. Les enfants de la classe inférieure étaient exploités, non parce qu’ils étaient des enfants, mais d’une manière plus générale, parce qu’ils appartenaient à une classe d’exploités. Le mythe de l’enfance n’était pas dans leurs moyens. Là encore, nous voyons combien ce mythe était arbitraire, et qu’il avait été conçu tout exprès pour répondre aux besoins des structures familiales de la classe moyenne.
Certes, direz-vous, il aurait sûrement mieux valu pour les enfants de la classe laborieuse de vivre eux aussi à l’abri de ce mythe. Leur vie du moins aurait été épargnée. Ils auraient donc bien pu perdre leur vie spirituelle dans quelque pensionnat ou quelque bureau ? Une telle question est de pure rhétorique, et équivaut à se demander si les souffrances des Noirs d’Amérique sont authentiques sous prétexte que dans un autre pays ils seraient considérés comme riches. Souffrir, c’est toujours souffrir. Nous devrions plutôt penser en termes généraux : pourquoi les parents de ces enfants étaient-ils eux-mêmes exploités ; d’ailleurs, pourquoi faire travailler qui que ce soit dans une mine ? Ce qui devrait nous faire protester, ce n’est pas tant que les enfants soient exploités comme des adultes, mais bien plutôt que les adultes puissent être ainsi exploités. Ce dont il doit s’agir maintenant, ce n’est pas d’épargner aux enfants, pendant quelques années, les horreurs de la vie d’adulte, mais c’est d’éliminer ces horreurs. Dans une société sans exploitation, les enfants pourraient être comme les adultes et les adultes comme les enfants, sans aucune exploitation dans un sens ni dans l’autre. L’esclavage privilégié (protection) que subissent les femmes et les enfants n’est pas la liberté. Le pouvoir de se diriger soi-même est la base de toute liberté, et la dépendance est à l’origine de toute inégalité.
Répression sexuelle
Freud décrit les premières satisfactions de l’enfant : celles du nouveau-né au sein de sa mère, que sa vie durant, l’homme tentera de retrouver ; il montre comment, grâce à la protection des adultes, l’enfant bénéficie d’une plus grande liberté par rapport au « principe de réalité », comment il a la permission de jouer (activité exercée par plaisir, et non dans un but quelconque) ; comment la sexualité de l’enfant est une perversité polymorphe et comment elle est ultérieurement dirigée et réprimée de manière à le rendre capable uniquement d’un plaisir génital d’adulte. Freud a également montré que les origines de la névrose de l’adulte sont construites par le mécanisme même de l’enfance. Bien que l’enfant type puisse être capable de plaisir pur, cela ne signifie pas qu’il puisse s’y abandonner totalement. Il serait plus correct de dire que, bien que sa nature l’incline au plaisir, il perd cette inclination dans la mesure où il est socialisé (c’est-à-dire réprimé). Et ce processus commence dès la naissance.
Le « principe de réalité » n’est pas réservé aux seuls adultes. Il est introduit dans la vie de l’enfant, à son échelle, presque immédiatement. Car il suffit que ce principe de réalité existe pour que l’idée d’en épargner les désagréments à l’enfant soit une illusion. Dans le meilleur des cas, le processus répressif sera tardif ; mais plus souvent, la répression commencera dès que l’enfant en sera capable, et sur tous les plans. Ce n’est pas comme s’il existait une époque bénie où la « réalité » disparaîtrait. Car en fait, la répression commence dès la naissance – les biberons à heure fixe en sont un exemple extrême. D’après Robert Stoller[15], l’essentiel de la différenciation sexuelle se fait avant l’âge de dix-huit mois, et, comme nous l’avons vu[16], ce processus demande l’inhibition de l’élan sexuel vers la mère. Ainsi, dès le début, on ne permet pas à l’enfant d’exprimer librement sa perversité polymorphe. (Même aujourd’hui où l’on fait campagne pour faire reconnaître la masturbation comme normale, on empêche beaucoup de nourrissons de jouer avec leur propre corps quand ils sont au berceau.) Le plus tôt possible, on sèvre l’enfant et on lui inculque la propreté – expériences qui pour lui sont traumatisantes. Les contraintes augmentent. L’amour de la mère, qui dans l’idéal devrait être une plénitude parfaite (« inconditionnel ») [17] est accordé comme l’amour du père : pour mieux diriger l’enfant vers un comportement approuvé par la société. Et finalement on lui demande de s’identifier de manière active à son père. (Lorsqu’il n’y a pas de père, l’identification peut se faire un peu plus tard, lorsque l’enfant commence à aller à l’école.) À partir de là jusqu’à la puberté, l’enfant doit mener une vie dénuée de sexualité – à moins qu’elle ne soit secrète – sans même se reconnaître aucun besoin sexuel. La frustration produite par cette asexualité est au moins partiellement responsable de l’acrimonie et de l’agressivité extrêmes – ou au contraire de la docilité anémique – qui souvent rendent les enfants si pénibles à supporter.
Répression familiale
Il n’est pas nécessaire d’étudier dans les détails les subtiles pressions psychologiques de la vie familiale. Pensez à votre propre famille. Et si cela ne suffit pas, si vous êtes bien cette personne qui, seule parmi un million d’autres, est persuadée qu’elle a une « famille heureuse », lisez R. D. Laing, et surtout La politique de la famille[18] : Laing y révèle la dynamique interne de la famille et explique comment elle est invisible aux membres mêmes de la famille :
«Une chose est souvent claire pour l’étranger : il existe une résistance concertée de la famille à la découverte de ce qui se passe et il y a des stratagèmes compliqués mis en œuvre pour que chacun l’ignore. Nous en saurions plus long sur ce qui se passe si on ne nous en empêchait, et si on ne nous empêchait de nous rendre compte qu’on nous en empêche. Entre la vérité et le mensonge, il y a des images et des idées que nous tenons pour réelles et qui paralysent notre imagination et notre pensée […]. Puisque ce produit de l’imagination n’existe que dans la mesure où il existe déjà “dans” chacun des membres qui composent une famille, celui d’entre eux qui cesse d’y croire détruit la “famille” dans tous les autres. »
Voici maintenant, pris chez les enfants, quelques exemples qui parlent d’eux-mêmes. Nous citons le psychanalyste Theodor Reik :
« On m’a parlé d’un petit garçon qui jusqu’à près de quatre ans croyait que son nom était “Tais-toi”. »
« Un petit garçon assista à une dispute terrible entre ses parents, et entendit sa mère menacer son père de divorcer. Le jour suivant, lorsqu’il revint de l’école, il demanda à sa mère: “Es-tu déjà divorcée?” Plus tard, il se souvint d’avoir été déçu qu’elle ne le fut pas. »
« Un père, allant voir son fils de neuf ans qui se trouvait en colonie de vacances, lui demanda s’il ne s’ennuyait pas de la maison. L’enfant répondit non. Le père lui demanda alors si les autres petits garçons s’ennuyaient de leur maison. “Seulement quelques-uns, répondit-il, ceux qui ont des chiens chez eux.” »
Ce qui est amusant dans ces anecdotes, si du moins on peut employer ici cet adjectif, c’est la candeur des enfants, incapables de comprendre ou d’admettre l’horreur masochiste de tout cela.
Répression par l’éducation
C’est à l’école que l’on cimente la répression. Les quelques illusions de liberté qui pouvaient subsister sont maintenant rapidement effacées. Toute activité sexuelle comme toute manifestation physique d’expansivité est interdite. C’est la première fois que les jeux sont aussi lourdement contrôlés. Le bonheur de jouer, naturel chez les enfants, est maintenant soumis à cooptation, afin (en les réprimant) de mieux les intégrer à la société. (« C’est Larry qui a fait le plus joli dessin. Comme il est gentil ! Ta maman sera fière de toi ! ») Il est vrai que dans quelques écoles libérales, de bons professeurs essaient, à tous les degrés, de trouver des sujets et des activités qui intéressent réellement les enfants. (La classe est plus facile à tenir de cette manière.) Mais comme nous l’avons vu, la structure répressive et ségrégationniste des classes elles-mêmes suffit pour que tout attrait naturel pour l’étude serve finalement l’intérêt essentiellement disciplinaire de l’école. De jeunes professeurs, épris de leur travail et pleins d’idéal lorsqu’ils étaient entrés dans le système, s’élèvent brusquement contre lui ; et désespérés, beaucoup d’entre eux abandonnent. S’ils avaient oublié à quel point l’école avait été pour eux une prison, voilà qu’ils la retrouvent inchangée. Bientôt, ils se voient forcés d’admettre que, s’il existe des prisons libérales et d’autres qui le sont moins, par définition ce sont toutes des prisons. L’enfant est obligé d’en passer par là ; mais les faits démontrent que de lui-même, il ne choisirait jamais d’y aller (« L’école est finie, l’école est finie, les cahiers au feu, la maîtresse au milieu ! »). Des éducateurs éclairés ont conçu des systèmes entiers d’activités dirigées, ayant en elles-mêmes suffisamment d’intérêt pour séduire les enfants et leur faire accepter l’école. Mais ces systèmes ne pourront jamais être pleinement satisfaisants : une école qui n’existerait que pour répondre à la curiosité des enfants selon leurs propres goûts et qui serait dirigée comme ils l’entendent, serait une contradiction en soi. Comme nous l’avons vu, la raison d’être de l’école moderne est l’exercice de la répression.
L’enfant passe la plus grande partie de ses heures d’activités au sein de ces structures coercitives, ou chez lui, à faire les devoirs qu’elles imposent. Le peu de temps qu’il lui reste est souvent absorbé par les occupations et les obligations familiales. Il est contraint d’assister à des discussions sans fin ou, dans certains milieux « libéraux », à des « conseils de famille ». Il doit être aimable avec les cousins, se rendre au service religieux (que d’heures de prières subies à contrecœur !). S’il a encore quelques instants, du moins dans nos classes moyennes modernes, on le « supervise » en bloquant le développement de ses initiatives et de sa créativité : on lui choisit ses jouets, ses terrains de jeux (terrains de sport, parcs, campings) ; souvent on limite le choix de ses amis à des enfants de la même classe sociale, et dans les faubourgs, à ses camarades d’école et aux enfants des amis de ses parents ; il fait partie de groupes assez nombreux pour qu’il ne sache plus où donner de la tête (boy-scouts, cub-scouts, girl-scouts, brownies, camps, clubs divers qui se réunissent ou font du sport après la classe) ; on lui choisit sa culture, on ne lui permet souvent de regarder que les programmes télévisés débiles pour enfants, et on lui interdit tous les (bons) films pour adultes ; ses lectures sont souvent choisies dans de vieilles listes de lectures enfantines (Hommes et femmes célèbres d’Amérique, Les Annales de Babe Ruth, Lassie, Nancy Drew).
Les seuls enfants qui ont la moindre chance d’échapper à ce cauchemar supervisé – mais de moins en moins – sont ceux des ghettos et de la classe laborieuse où survit encore la conception médiévale d’une communauté ouverte qui vit dans la rue. C’est qu’au cours de l’histoire, beaucoup des processus de l’enfance ont mis longtemps à descendre jusqu’à la classe inférieure, et ils ne s’y sont jamais vraiment maintenus. Les enfants des classes laborieuses viennent généralement de familles nombreuses et composées de personnes d’âges divers. Mais même quand ce n’est pas le cas, ils ont souvent des demi-frères et sœurs, des cousins, nièces, neveux et tantes, dans un milieu familial changeant constamment. On ne se préoccupe guère des enfants individuellement, on les supervise encore moins : ils peuvent souvent vagabonder loin de la maison ou jouer dans la rue jusqu’à des heures très avancées. Et si par hasard leur famille est de nombre limité, il se trouve dans la rue des centaines de gosses, dont beaucoup ont formé leurs propres groupes sociaux (gangs[19]). Ils ne reçoivent pas souvent de jouets, ce qui signifie qu’ils s’en créent eux-mêmes. (J’ai vu des gosses de ghettos fabriquer d’astucieux toboggans avec du carton et les dresser contre les perrons de vieilles maisons où les marches manquaient ; j’en ai vu d’autres se faire des chariots et des poulies avec de vieilles jantes, de la ficelle et des boîtes. Aucun enfant de classe moyenne ne fait cela. Il n’en a pas besoin. Mais aussi perd-il vite son ingéniosité.) Ils partent en exploration fort loin de leur propre quartier, et, bien plus que leurs contemporains des classes moyennes, ils traitent d’égal à égal avec les adultes qu’ils rencontrent. À l’école, ils se montrent indisciplinés et sauvages, comme d’ailleurs ils doivent l’être – car cet établissement n’inspire aucune confiance à un être libre, même si sa liberté n’est que partielle. La classe laborieuse conserve une certaine irrévérence pour l’école qui, après tout, est un phénomène appartenant par son origine à la classe moyenne.
Sur le plan sexuel également, les gosses de ghetto sont plus libres. Un garçon me raconta qu’il ne pouvait se souvenir d’aucune époque de son enfance où il n’ait eu, de manière tout à fait naturelle, des rapports sexuels avec les autres gosses ; c’est ce que tout le monde faisait. Les professeurs, dans les écoles des ghettos, savent qu’il est impossible de réduire la sexualité enfantine : c’est une chose courante, dont les enfants sont friands, et de loin supérieure à un cours sur la grande démocratie américaine ou sur l’apport civilisateur des Hébreux qui imaginèrent un dieu unique (pourquoi d’ailleurs en imaginer un ?), ou encore sur le café et le caoutchouc, principales exportations du Brésil. Ils font donc cela dans les escaliers. Et manquent l’école le jour suivant. Si, dans l’Amérique moderne, une enfance libre existe à quelque degré, c’est dans les classes inférieures, où la pénétration du mythe est la plus réduite.
Pourquoi donc ces enfants tournent-ils plus mal que ceux des classes moyennes ? La réponse à cette question est peut-être évidente. Mais je citerai l’expérience personnelle que j’ai acquise en vivant et en enseignant dans les ghettos : jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge adulte – et là encore, la chose est discutable – ces gosses ne font preuve d’aucune infériorité intellectuelle. Les enfants des classes laborieuses sont parmi les plus brillants, les plus culottés et les plus originaux que l’on connaisse. Ils le sont parce qu’on les laisse tranquilles. (S’ils ne réussissent pas bien les tests, c’est qu’il faudrait peut-être réexaminer ces tests, mais pas les enfants.) Plus tard, lorsqu’ils se heurteront à un « principe de réalité » différent de celui de la classe moyenne, ils seront saignés et assommés ; ils ne sortiront jamais de leur sujétion économique. Ainsi, c’est l’asservissement quotidien qui produit ces adultes apathiques et dénués d’imagination, c’est la restriction constante de leur liberté personnelle – mais ce n’est pas leur enfance sauvage.
La liberté des enfants des ghettos n’est cependant que relative. Ils sont encore dépendants, et en tant que classe économique, ils sont asservis. Les enfants ont de bonnes raisons pour vouloir tous grandir : alors, ils pourront au moins quitter la maison, et trouver la possibilité de faire ce qu’ils voudront. (Il y a quelque ironie dans le fait que les enfants s’imaginent que leurs parents sont libres de faire ce qu’ils veulent ; les parents pensent au contraire que leurs enfants ont bien de la chance. « Quand je serai grand » est le parallèle de « Si je pouvais seulement redevenir enfant… ») Ils rêvent d’amour et de sexe, car ils traversent la période la plus aride de leur existence. Souvent, lorsqu’ils voient les souffrances de leurs parents, ils décident que, lorsque eux seront grands, cela ne leur arrivera pas. Ils bâtissent des rêves splendides de mariages parfaits, ou bien ne veulent pas de mariage du tout (les enfants les plus astucieux se rendent compte que le mal tient à l’institution et non à leurs parents) ; ils voudraient pouvoir dépenser l’argent sans compter, avoir beaucoup d’amour, être très admirés. Ils veulent paraître plus âgés qu’ils ne le sont, et se sentent insultés si on leur dit qu’ils paraissent plus jeunes. Ils tentent avec acharnement de déguiser leur ignorance, qui est l’infirmité physique de tous les enfants. Voici un exemple, tiré de Reik (Sex in Man and Woman), des petites cruautés auxquelles ils sont constamment soumis:
« Je m’étais amusé aux dépens d’un petit garçon de quatre ans, à qui j’avais dit qu’un certain arbre, dans le jardin de ses parents, portait des tablettes de chewing-gum. J’avais acheté du chewing-gum et suspendu les tablettes avec des ficelles à la branche la plus basse. L’enfant y grimpa et les cueillit. Il ne douta pas qu’elle poussaient sur l’arbre, et ne réfléchit pas qu’elles étaient dans un emballage de papier. Il accepta volontiers mes explications lorsque je lui racontai que les tablettes, selon l’époque à laquelle elles fleurissaient, avaient différents parfums. L’année suivante, lorsque je lui rappelai l’histoire de l’arbre à chewing-gum, il eut grand honte de sa crédulité passée, et me dit: “Ne me parlez pas de cela.” »
Certains enfants, pour se défendre contre les constantes railleries que leur vaut leur naïveté – lorsqu’ils voient que leur douloureuse ignorance passe pour « charmante » – essaient de miser sur elle, comme le font d’ailleurs souvent les femmes. Ils parlent des choses en les retirant volontairement de leur contexte, mais, dans ce cas, ils obtiennent rarement un résultat, et cela les rend perplexes. Ils ne se rendent pas compte que c’est l’ignorance elle-même que l’on trouve drôle, et non ses manifestations spécifiques. En effet, la plupart des enfants ne comprennent pas l’ordre arbitraire du monde des adultes, qu’on leur explique mal, même lorsque ses raisons sont valables. Dans la plupart des cas, sur la base des informations dont il dispose, un enfant tire des conclusions parfaitement logiques. De même, si un adulte arrivant sur une autre planète y trouvait des gens faisant du feu sur leurs toits, il pourrait bâtir une explication, mais ses conclusions, appuyées sur un passé différent du leur, leur paraîtraient probablement très amusantes. Toute personne qui voyage pour la première fois dans un pays dont elle ne connaît ni le peuple ni la langue fait l’expérience de l’enfance.
*
Les enfants ne sont donc pas plus libres que les adultes. Ils sont pleins d’imaginations et de désirs qui sont en proportion directe avec l’étroitesse de leur vie ; affligés du sentiment déplaisant de leur propre insuffisance physique et de leur ridicule ; constamment honteux de leur dépendance, économique et autre (« Maman, est-ce que je peux ? ») ; et finalement humiliés à cause de leur naturelle ignorance des choses pratiques. À chaque minute de sa vie, l’enfant subit une contrainte. L’enfance, c’est l’enfer.
Le résultat de tout cela, c’est cette petite personne tourmentée par l’insécurité, par conséquent toujours prête à l’agression ou à la défense, et souvent odieuse, que nous appelons un enfant. Les contraintes économiques, sexuelles, et d’une manière générale, psychologiques qu’il doit supporter ressortent sous forme de timidité, de déloyauté, de rancœur, et ces traits de caractère déplaisants ne font que renforcer davantage l’isolement des enfants du reste de la société. C’est donc avec joie qu’on abandonne aux femmes leur éducation, surtout dans les phases les plus difficiles du développement de leur personnalité – et pour les mêmes raisons, les femmes ont alors tendance à faire montre elles-mêmes de ces traits de caractère. À l’exception des satisfactions que retire leur ego du fait d’avoir des enfants à eux, peu d’hommes éprouvent de l’intérêt pour les enfants. Et certainement pas suffisamment pour en parler dans un livre sur la révolution.
Ce sera donc aux révolutionnaires féministes (ex-enfants et femmes-enfants asservies en tant que telles) de le faire. Dans tous les programmes pour une révolution féministe, il nous faut tenir compte de l’asservissement des enfants, sinon nous commettrions la faute que nous avons souvent reprochée aux hommes : ne pas pousser suffisamment loin l’analyse, ne pas voir un substrat important de cette sujétion, uniquement parce que cela ne nous concerne pas. Je dis cela car je sais que beaucoup de femmes sont excédées d’être toujours réunies aux enfants en un seul bloc ; et le fait qu’ils ne soient pas plus à notre charge et sous notre responsabilité que sous celle de n’importe qui sera un principe essentiel de nos exigences révolutionnaires. Nous avons simplement, au cours d’une longue période de souffrances liées, acquis de la compassion pour eux, ainsi qu’une certaine compréhension, et il n’y a aucune raison d’y renoncer à présent. Nous savons ce qu’ils cherchent et ce qu’ils ressentent, parce que nous aussi nous subissons encore le même type de sujétion. La mère qui voudrait tuer son enfant à cause de tout ce qu’elle a dû lui sacrifier (ce sentiment est répandu) n’apprend à l’aimer que lorsqu’elle s’est rendu compte qu’il est aussi désarmé et opprimé qu’elle, et par le même oppresseur : sa haine se dirige alors vers l’extérieur, et « l’amour maternel » naît. Mais allons plus loin : notre but final doit être la suppression des conditions spécifiques de la femme et de l’enfant qui ont suscité cette alliance des opprimés, et la préparation à une condition nouvelle et pleinement « humaine ». Il n’y a pas encore d’enfants capables d’écrire leurs propres livres, et de raconter leur propre histoire. Nous devrons, une dernière fois, le faire pour eux.
[1] Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, Gallimard, 1986.
[2] Ibid
[3] Toute la détresse de la déesse a été admirablement rendue dans le film de Satyajit Ray, Devi (1960).
[4] Philippe Aries, L’enfant et la vie familiale sous l’Ancien Régime, Points Seuil, 1975.
[5] Avunculaire: qui a rapport à un oncle ou une tante (note de tahin party)
[6] On trouvera en annexe du bouquin de Tahin party le passage dont il est question.
[7] Des vestiges de ces coutumes existent encore de nos jours. Les garçons de la classe laborieuse tendent à devenir commerçants, artisans, ou à adopter des professions modernes équivalentes, plutôt que d’entreprendre des études qu’ils jugent inutiles. C’est ce qui subsiste de l’époque où les enfants de la classe inférieure allaient encore en apprentissage, alors que ceux de la classe moyenne avaient commencé à fréquenter l’école moderne. (Ce n’est pas un hasard non plus si tant de grands artistes de la Renaissance étaient de jeunes garçons de condition modeste formés dans les ateliers des maîtres.) Nous pouvons retrouver aussi des survivances de cette phase de l’histoire dans notre armée actuelle, où se trouvent réunis les extrêmes de la société de classes: d’une part, des jeunes provenant de la classe laborieuse; d’autre part, des officiers issus de la classe supérieure, « West pointers» de l’aristocratie – car l’aristocratie, comme le prolétariat, adopta avec retard la structure familiale et l’instruction publique de la bourgeoisie.
[8] Philippe Aries, op. cit.
[9] Dans le milieu juif orthodoxe où j’ai grandi, et qui vu de l’extérieur paraît souvent anachronique, beaucoup de petits garçons commencent des études sérieuses avant l’âge de cinq ans, et par conséquent les prodiges talmudiques sont chose commune.
[10] Philippe Ariès, op. cit.,
[11] Cette situation est poussée jusqu’à l’extrême dans les écoles contemporaines, où des enfants parfaitement capables doivent attendre une année avant d’entrer dans la classe qui pourrait être la leur, parce que, par rapport à une date arbitrairement fixée, ils sont trop jeunes de quelques jours
[12] Cf. Ariès, op. cit., chap. V, « De l’impudeur à l’innocence», où l’on trouvera une description détaillée de ces « réalités», d’après les expériences sexuelles du dauphin, relatées dans le Journal d’Heroard.
[13] Friedrich Engels, L’origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, éd. sociales, 1983.
[14] Dropout: personne qui rejette la société actuelle, qui « laisse tomber » son rang social et ses obligations, ses études s’il s’agit d’un étudiant, pour vivre au hasard de son inspiration (ndlt).
[15] Robert Stoller, Recherches sur l’identité sexuelle, Gallimard, 1986.
[16] Cf Annexe (note de tahin party)
[17] Précisons, si besoin est, que cet « idéal » n’est pas celui de S. Firestone, qui parle ailleurs « du dommage que peut causer cet idéal, à la fois à la mère et à l’enfant» (note de tahin party).
[18] R. D. Laing, Politique de la famille, Stock, 1979.
[19] Les gangs sont actuellement les seuls groupes d’enfants dirigés par eux-mêmes; si le mot gang a une résonance inquiétante, c’est pour de bonnes raisons politiques.
