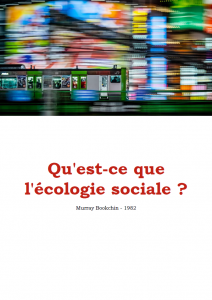
Lien vers la brochure en pdf : Qu’est-ce que l’écologie sociale ?
Texte de la brochure :
Une écologie de la liberté
Préface à la quatrième édition
Murray Bookchin est peu connu en France. Mais il mérite largement de trouver sa place dans la galaxie des « penseurs de l’écologie », où figurent notamment Günther Anders, Jacques Ellul, Barry Commoner, Hans Jonas, Ivan Illich ou André Gorz. Car Bookchin apporte à la réflexion écologiste une idée cruciale : le rapport des sociétés modernes à ce qu’elles appellent la nature reflète les rapports de pouvoir qui structurent ces sociétés.
La domination qu’exercent les riches sur les pauvres, les hommes sur les femmes, les vieux sur les jeunes, se prolonge dans la domination que les sociétés fondées sur la hiérarchie exercent sur leur environnement. Et de même que ces relations de domination aliènent les personnes – c’est-à-dire détruisent ou réduisent leur potentialité humaine -, de même ces sociétés hiérarchiques détruisent la nature. Mener une politique écologique appelle donc une mutation des rapports politiques au sein de la société : « protéger la nature » suppose l’émancipation sociale.
La force de Bookchin est d’explorer cette idée sans tomber dans l’individualisme – selon un thème récurrent de l’idéologie capitaliste : « pour que l’on arrête de détruire l’environnement, il faut que chacun change son comportement » – , mais bien en termes de société politique. Et par ailleurs, de la développer en s’inspirant du fonctionnement de la nature sans pour autant confondre la société avec un écosystème : il n’oublie jamais que si les humains ont tout à voir avec la nature, ils ne peuvent s’y dissoudre, ayant à poursuivre leur propre aventure. Mais cette aventure collective, qui passe par l’exploration de la liberté, ne peut réussir que si elle ne néglige pas le terreau vivant et magnifique dans lequel elle s’enracine.
On est surpris, en relisant Qu’est-ce que l’écologie sociale trente ans après sa parution, de constater à quel point ce texte reste pertinent et stimulant. Je vous souhaite d’y trouver autant de plaisir et de force que j’en ai eu, et d’avoir envie de découvrir les autres ouvrages de Murray Bookchin. Sa pensée est un aliment nécessaire pour nourrir une lutte écologiste plus urgente et plus âpre que jamais.
Hervé Kempf, août 2012
Introduction
Aux énormes problèmes de fond que crée l’ordre social actuel s’ajoutent les énormes problèmes de fond créés par une mentalité qui a commencé à se développer bien avant la naissance du capitalisme, et que ce dernier a entièrement absorbée. Je veux parler de la mentalité structurée par les notions de hiérarchie et de domination, où la domination de l’homme sur l’homme a donné naissance au concept de la domination de la nature comme « destin ». Voire comme nécessité de l’humanité. Que la pensée écologique ait commencé à faire passer l’idée que cette conception du « destin » de l’humanité est pernicieuse a tout lieu de nous réconforter. Toutefois, on ne comprend pas encore clairement comment cette conception est apparue, pourquoi elle persiste et comment l’éliminer. Il faut bien plutôt étudier les origines de la hiérarchie et de la domination si l’on veut porter remède au désastre écologique. Le fait que la hiérarchie sous toutes ses formes – domination des vieux sur les jeunes, des hommes sur les femmes, de l’homme sur l’homme dans le rapport de classe, de caste, d’ethnie ou sous toutes les autres formes de stratifications sociales – ne soit pas reconnue comme un système de domination plus ample que le rapport de classe est une des carences les plus évidentes de la pensée radicale. Aucune libération n’est possible, aucune tentative d’harmoniser les rapports humains et les rapports entre les hommes et la nature ne pourra réussir si l’on n’a pas éradiqué toutes les hiérarchies, et pas seulement les classes sociales, toutes les formes de domination, et pas seulement l’exploitation économique.
Ces idées constituent le cœur même de ma conception de l’écologie sociale. Je souligne l’adjectif social en matière écologique pour introduire un autre concept clef : aucun des principaux problèmes écologiques auxquels nous nous affrontons aujourd’hui ne pourra être résolu sans un changement social profond. Les implications de cette idée n’ont pas encore été assimilées entièrement par le mouvement écologique. Si on les porte à leur conclusion logique, cela signifie qu’on ne peut pas songer à transformer la société actuelle un petit peu à la fois, par de petits changements. En outre, ces petits changements peuvent n’être que des coups de frein réduisant un peu la vitesse effrénée avec laquelle la biosphère est en train d’être détruite. Certes il nous faut gagner autant de temps que possible, dans cette course contre le « biocide », et il faut tout mettre en œuvre pour ne pas nous faire dépasser. Néanmoins, le biocide se poursuivra si nous ne parvenons pas à convaincre les gens qu’un changement radical est indispensable et qu’il faut s’organiser à cette fin. Il nous faut accepter le fait que la société capitaliste actuelle doit être remplacée par ce que j’appelle la société écologique, une société qui implique les changements sociaux radicaux indispensables pour éliminer les abus perpétrés contre l’environnement.
La nature de cette société écologique exige aussi des réflexions et des débats sérieux. Certaines conclusions sont évidentes. Une société écologique doit être non hiérarchique, sans classes, si l’on veut éliminer l’idée même de domination sur la nature. À ce sujet, on ne peut éviter de revenir aux fondements de l’anarchisme tels que les propose un Kropotkine, aux grands idéaux éclairés de raison, de liberté, d’émancipation par l’instruction, tels que les proposent un Malatesta ou un Berneri. Mieux encore, les idéaux humanistes qui guidèrent par le passé les théoriciens de l’anarchisme doivent être retrouvés dans leur entièreté et prendre la forme d’un humanisme écologique qui incarne une nouvelle rationalité, une nouvelle conception de la science et de la technologie : autant de thèmes que je présente dans cet ouvrage.
Si je rappelle les idéaux éclairés des penseurs libertaires, ce n’est pas seulement en fonction de mes prédilections idéologiques. Il s’agit plutôt d’idées qui ne peuvent être mises de côté par aucune personne engagée dans la lutte écologique. Aujourd’hui, dans le monde entier, les mouvements écologiques sont mis devant des choix inquiétants. D’une part on voit se diffuser, venant d’Amérique du Nord, une sorte d’épidémie spirituelle antirationaliste : au nom du retour à la nature, elle évoque des atavismes irrationnels, des mysticismes, des religions « païennes ». Le culte de « déesses », des traditions « paléolithiques » ou « néolithiques » selon les goûts, des rituels de type vaudou ou autres, tout ce courant de « l’écologie profonde » se présente comme une nouvelle spiritualité. Le phénomène n’est pas innocent : il est souvent teinté d’un néo-malthusianisme perfide qui ne voit pas de mal à laisser mourir de faim les pauvres, surtout les victimes des pénuries dans le tiers monde, pour « freiner l’évolution démographique ». La Nature, nous dit-on, doit être « libre de suivre son cours » ; la faim, les pénuries ne seraient pas causées par les industries agroalimentaires ni par l’exploitation des sociétés transnationales, ni par les rivalités impérialistes, ni par les guerres civiles nationalistes : elles ne proviennent que de la surpopulation. Ainsi les problèmes écologiques sont vidés de tout contenu social et réduits à une interaction mythique de « forces naturelles » prenant souvent des intonations racistes qui puent le fascisme.
D’un autre côté, on voit émerger un mythe technocratique selon lequel la science et la technique pourraient résoudre tous les maux dont souffre l’environnement. Comme dans les utopies de H. G. Wells, on nous demande de croire qu’il nous faut une nouvelle élite qui planifie la solution de la crise écologique. Ce genre de fantaisies sont implicites dans la conception du « vaisseau spatial terre » (pour reprendre la métaphore grotesque de Buckminster Fuller), qui pourrait être manipulé par l’ingénierie génétique, nucléaire, électronique, politique… On nous rebat les oreilles avec des idées comme la nécessité d’une plus grande centralisation de l’État, de la création de méga-États, parallèle effrayant avec les sociétés transnationales. Et de même que la mythologie s’est diffusée parmi les écolo-mystiques, les partisans du primitivisme en version écologique, de même la théorie des systèmes a-t-elle acquis une grande popularité parmi les écolo-technocrates, champions du futurisme version écologique. Dans les deux cas, les idéaux libertaires des Lumières – la valorisation de la liberté, de l’instruction, de l’autonomie individuelle – sont niés par la prétention symétrique de ces deux courants de courir à reculons vers un « passé obscur », mythifié et sinistre, ou de se catapulter vers un « avenir » radieux, mais tout autant mythifié et tout autant sinistre.
Le message de l’écologie sociale n’est ni primitiviste ni technocratique. Elle cherche à définir la place de l’humanité dans la nature – place singulière, extraordinaire – sans tomber dans un monde préhistorique anti technologique ni partir sur un vaisseau de science-fiction. L’humanité fait partie de la nature, même si elle diffère profondément de la vie non humaine par la capacité qu’elle a de penser conceptuellement et de communiquer symboliquement. La nature, pour sa part, n’est pas un écran panoramique à regarder passivement : c’est l’ensemble de l’évolution, l’évolution dans sa totalité, tout comme l’individu est toute sa biographie et non pas la somme des données numériques qui mesurent son poids, sa taille, voire son « intelligence ». Les êtres humains ne sont pas une forme de vie parmi les autres, juste un peu spécialisée pour occuper une des niches écologiques du monde naturel. Ce sont des êtres qui, potentiellement, peuvent rendre consciente l’évolution biotique et l’orienter consciemment. Je ne prétends pas par là que l’humanité ne parviendra jamais à avoir une connaissance suffisante de la complexité du monde naturel pour pouvoir prendre le gouvernail de l’évolution naturelle et la diriger à son gré. Ce que je dis sur la spontanéité, dans le chapitre publié ci-après, m’incite à conseiller la plus grande prudence dans les interventions sur le monde naturel.
Nos interventions peuvent être créatrices ou destructrices, et c’est là le plus grand problème à discuter dans toute réflexion sur nos interactions avec la nature. Si nos potentialités humaines sont énormes, rappelons-nous qu’aujourd’hui nous sommes encore moins qu’humains.
Notre espèce est encore divisée par des antagonismes entre les âges, les sexes, les classes, les revenus, les ethnies, etc. Il est 10 absurde de parler de « l’humanité » en termes zoologiques, comme le font aujourd’hui tant d’écologistes, de traiter les gens comme une espèce parmi d’autres et non comme des êtres sociaux qui vivent dans des créations institutionnelles complexes. Une humanité éclairée, consciente de toutes ses potentialités dans une société écologiquement harmonieuse, n’est qu’un espoir et non une réalité présente ; un « devoir être », non un « étant ». Tant que nous n’aurons pas créé cette société écologique, nos capacités de nous entretuer et de dévaster la planète continueront de faire de nous une espèce encore moins évoluée que les autres. Parvenir à notre pleine humanité est un problème social, qui dépend de changements institutionnels et culturels fondamentaux : ne pas le voir, c’est réduire l’écologie à la zoologie et faire de toute tentative de réaliser une société écologique une chimère.
Murray Bookchin
Burlington, Vermont, 1988
Les anciennes légendes nordiques nous parlent d’un temps où tous les êtres se répartissaient leurs domaines en ce monde : les dieux occupaient un domaine céleste, Asgard, et les hommes vivaient dans l’Empire-du-Milieu, Midgard, sous lequel s’étendait Niflheim, domaine de ténèbres et de glaces, celui des géants, des nains et des morts. Ces trois domaines étaient reliés entre eux par un énorme frêne, l’Arbre cosmique, dont la cime se déployait dans les deux et dont les racines pénétraient jusqu’aux extrêmes profondeurs de la terre. Bien qu’il soit rongé sans relâche par les animaux, l’Arbre cosmique restait éternel.
Les dieux, qui l’avaient façonné, présidaient à la tranquillité précaire de ce monde. Ils avaient chassé leurs ennemis, les géants, au pays des glaces. Le loup Fenrir était enchaîné, et le grand serpent de Midgard tenu en respect. Malgré les menaces cachées, la paix universelle régnait, et l’abondance, pour les dieux, les hommes, et tous les êtres vivants. Odin, dieu de la Sagesse, dominait toutes les autres déités ; le plus sage et le plus fort, il veillait aux combats des hommes, choisissant les plus héroïques des victimes et les conviant au festin dans son immense forteresse, le Walhalla. Thor, fils d’Odin, n’était pas seulement un puissant guerrier, défenseur d’Asgard contre les géants rebelles, c’était aussi un dieu d’ordre, qui veillait à ce que les hommes tiennent leur parole et respectent les traités. Il y avait des dieux et des déesses de l’abondance, de la fertilité, de l’amour, des lois, de la mer et des navires, et une multitude d’esprits animistes habitant chaque être et chaque chose de la terre.
Mais l’ordre du monde commença à s’ébranler lorsque les dieux, avides de richesses, voulurent, en la torturant, arracher ses secrets à la sorcière Gullveig, la faiseuse d’or. La discorde se mit alors à sévir parmi les dieux et les hommes. Les dieux rompirent leurs serments ; la corruption, la perfidie, la rivalité et l’avarice prenaient possession du monde. Avec la rupture de l’unité primordiale, les jours des hommes et des dieux, de Midgard et d’Asgard, étaient comptés. La violation de l’ordre du monde mènerait inexorablement au Ragnarok – à la mort des dieux dans une bataille gigantesque devant le Walhalla. Les dieux se jetteraient dans un combat terrible avec les géants, le loup Fenrir et le serpent de Midgard. Lors de la destruction mutuelle de tous les combattants, l’humanité elle-même périrait; et seul subsisterait le roc submergé par l’océan, dans un abîme de froid et d’obscurité. Cependant, après être ainsi retombé dans le chaos de ses origines, le monde renaîtrait, guéri de ses maux antérieurs et de la corruption qui l’avait détruit. Et le nouveau monde qui surgirait de l’abîme ne connaîtrait plus cette fois de catastrophe finale, car la prochaine génération de dieux et de déesses aurait tiré la leçon de ceux et celles qui l’avaient précédée. La voyante qui nous offre cette prédiction affirme qu’à partir de ce moment « les troupes fidèles jouiront du bonheur dans les jours des âges[1] ».
Il y a plus, nous semble-t-il, dans cette cosmographie nordique, que le vieux thème de « l’éternel retour », que cette notion d’un temps enroulant en cycles perpétuels naissance, maturité, mort et renaissance. Nous sommes bien plutôt en présence d’un prophétisme modelé par les chocs de l’histoire ; la légende appartient à ce domaine peu exploré de la mythologie que l’on pourrait appeler « mythes de désintégration ». Nous savons que la légende du Ragnarok est fort ancienne, mais nous ignorons à peu près tout du moment où elle apparaît dans l’évolution des sagas Scandinaves. Le christianisme, avec ses promesses de récompense éternelle, est, on le sait, parvenu chez les peuples Scandinaves plus tard que chez tous les autres grands groupes ethniques d’Europe occidentale. Depuis longtemps, le contact avait été établi entre le Nord païen et les marchands du Sud. Lors des invasions normandes en Europe, les lieux sacrés du Nord se couvrirent d’or profane, et la course aux richesses rompit les liens du sang. Les hiérarchies fondées sur la vaillance cédaient le pas à des systèmes dans lesquels la richesse déterminait les privilèges. Clans et tribus se disloquaient ; les serments entre les hommes, ferments de l’unité de ce monde primordial, étaient bafoués, et la fontaine magique, où s’abreuvait l’Arbre cosmique, obstruée par les débris du négoce. « Les frères affrontés se feront fratricides, se lamente la voyante, les parents détruiront leur propre parenté… temps de la foudre et du fauve avant que le monde s’effondre. »
*
Ce qui nous trouble dans ces mythes de désintégration, ce n’est pas tant leur histoire que leurs prophéties. Tout comme les anciens Scandinaves et, plus encore peut-être, à l’instar des hommes du Moyen Âge finissant, nous avons le sentiment que notre monde, lui aussi, s’effondre – dans ses institutions, sa culture, ses bases matérielles mêmes. Qu’une ère nouvelle, paradisiaque, s’ouvre à nous, ou que nous soyons à la veille d’une catastrophe semblable au Ragnarok nordique, cela est encore incertain, mais le temps du compromis entre passé et avenir dans un présent ambigu ne peut être que de courte durée. La tendance à la reconstruction et la tendance à la destruction sont, à notre époque, trop antagonistes pour autoriser une réconciliation. L’horizon social nous laisse entrevoir deux perspectives violemment opposées : d’une part, celle d’un monde rendu harmonieux grâce à une sensibilité écologique fondée sur la qualité de l’engagement vis-à-vis de la communauté, sur l’entraide et des technologies nouvelles ; d’autre part, la terrible perspective d’un désastre thermonucléaire, quelle qu’en soit la cause. C’est ainsi que notre monde devrait connaître selon toute apparence, ou bien des changements révolutionnaires de telle nature que les rapports sociaux, et l’idée même que les hommes se font de l’existence, en seraient radicalement transformés, ou bien une apocalypse qui mettrait un terme au bail de l’humanité sur la planète.
La tension entre ces deux perspectives a déjà ébranlé le moral de l’ordre social traditionnel. La période dans laquelle nous sommes entrés n’est plus celle de la stabilité, mais celle de la décadence des institutions. Partout augmente la désaffection à l’égard des formes, des aspirations, des exigences, et surtout des institutions de l’ordre établi. La manifestation la plus spectaculaire et la plus exaltée de cette désaffection s’est produite dans les années soixante, lorsque la « révolte des jeunes » s’épanouit en ce qui semblait alors devoir être une contre-culture. Il s’en faut que la contestation et le nihilisme des jeunes aient été les seules marques de cette période. La valorisation d’une sensualité nouvelle, de nouveaux styles de vie communautaire, les changements vestimentaires, dans le langage, la musique, le tout porté par le sentiment de l’imminence d’une transformation sociale, ont profondément influencé une partie importante de cette génération. S’il y eut reflux, il est trop tôt encore pour en discerner le sens : retraite historique ou transformation en un authentique projet de développement social et humain. Que les symboles de ce mouvement aient fini par devenir les produits d’une nouvelle industrie culturelle n’altère en rien la portée qu’il a pu avoir. La société occidentale ne sera plus jamais la même – en dépit des sarcasmes des professeurs et autres critiques du « narcissisme ».
Ce mouvement incessant de désinstitutionalisation et de délégitimation tire toute son importance du fait qu’il prend sa source au niveau d’une couche très vaste de la société occidentale. Car cette désaffection n’est pas seulement le fait des plus pauvres, elle est également répandue dans les milieux relativement aisés, elle touche non seulement les jeunes, mais aussi leurs aînés, aussi bien les victimes flagrantes de l’injustice que ceux qui jouissent d’apparents privilèges. L’ordre régnant est en passe de s’aliéner la loyauté des couches sociales qui se portaient traditionnellement à son secours et chez lesquelles il était fermement implanté aux époques précédentes.
Aussi déterminante que soit cette décadence des institutions et des valeurs, elle ne suffit pas à rendre compte de tous les problèmes auxquels doit faire face la société actuelle. Compénétrant la crise sociale, une autre crise a surgi, directement liée à l’exploitation de la planète par l’homme[2]. La société en place est non seulement confrontée à l’effondrement de ses institutions et de ses valeurs, mais encore à celui de son environnement naturel. Ce problème n’appartient pas en propre à notre époque. La sécheresse des étendues désertiques du Proche-Orient, berceau de l’agriculture et de l’urbanisme, témoigne d’une dilapidation humaine passée, mais cet exemple fait pâle figure en regard de la destruction massive de l’environnement accomplie depuis l’époque de la révolution industrielle, et surtout depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les dommages infligés à l’environnement par la société contemporaine sont à l’échelle de la planète. Un nombre incalculable de livres ont été consacrés aux énormes pertes en sol productif enregistrées chaque année dans presque toutes les régions du globe ; à l’étendue de la destruction de la couverture végétale dans les zones vulnérables à l’érosion ; aux incidents mortels dus à la pollution de l’air dans les grands centres urbains ; à la propagation sur toute la planète d’agents toxiques utilisés par l’agriculture, l’industrie et les installations produisant de l’énergie ; à la présence croissante, dans l’environnement humain immédiat, de substances chimiques provenant des déchets industriels, des résidus d’insecticides et des additifs alimentaires. L’exploitation et la pollution de la terre ont porté atteinte non seulement à l’atmosphère, au climat, aux eaux, au sol, à la flore et à la faune de certaines régions en particulier, mais aussi aux cycles naturels fondamentaux dont dépendent tous les êtres vivants.
La puissance destructrice de l’homme moderne n’est cependant rien d’autre que la preuve donquichottesque de sa capacité de reconstruction. Parmi les puissants agents technologiques que nous avons déchaînés contre l’environnement, beaucoup sont précisément ceux auxquels nous devrons faire appel pour sa reconstruction. Les connaissances et instruments matériels nécessaires pour promouvoir une nouvelle harmonie entre humanité et nature, et entre l’humain et l’humain, sont en grande partie à notre disposition ou facilement réalisables. Parmi les principes physiques appliqués à la construction d’équipements aussi manifestement nuisibles que les centrales électriques classiques, les véhicules à forte consommation d’énergie, les installations minières de surface, et j’en passe, nombreux sont ceux qui pourraient servir à l’élaboration de systèmes pour produire de l’énergie solaire et éolienne à petite échelle, des moyens de transport efficaces et des habitations économisant l’énergie. Ce qui nous fait cruellement défaut, c’est la prise de conscience et la sensibilité qui nous permettraient d’atteindre ces objectifs si fortement souhaitables – une sensibilité et une conscience de beaucoup plus grande envergure qu’il n’est coutume d’entendre par ces mots. Notre définition ne doit pas seulement comporter la capacité de raisonner logiquement et de réagir émotionnellement dans une perspective humaniste ; elle doit aussi impliquer la perception vive des liens qui unissent les choses et une vision créatrice du possible. À cet égard, Marx avait tout à fait raison de souligner que la révolution qu’exigeait notre époque devait puiser sa poésie non dans le passé, mais dans l’avenir, dans le potentiel d’humanité gisant dans les profondeurs de la vie sociale.
Cette conscience et cette sensibilité nouvelles ne peuvent pas être uniquement poétiques ; elles doivent aussi être scientifiques. De fait, à un certain niveau de notre conscience, celle-ci ne peut plus être ni poésie ni science, mais, allant au-delà de l’une et de l’autre vers un nouveau domaine de la théorie et de la pratique, elle doit inventer l’art de marier rêve et raison, logique et imagination, vision créatrice et technique. Nous ne pouvons rejeter notre héritage scientifique, c’est-à-dire revenir à une technologie rudimentaire et à ses chaînes : l’insécurité matérielle, le labeur épuisant, la renonciation. Pas plus que nous ne pouvons-nous laisser assujettir à celles du monde des machines, déshumanisé par la technologie : l’aliénation, la concurrence, et le brutal déni des possibilités humaines. La poésie et l’imagination doivent s’intégrer à la science et à la technologie, car nous avons dépassé le stade d’une innocence pouvant se nourrir exclusivement de rêves et de mythes.
*
Existe-t-il une discipline scientifique qui admette l’indiscipline du rêve, de l’imagination, de l’inventivité ? Qui puisse embrasser les problèmes soulevés par les crises que connaît notre temps, dans la société et l’environnement ? Qui soit capable d’associer critique et reconstruction, théorie et pratique, vision créatrice et technique ?
Il y a toujours eu un lien très étroit, depuis la Renaissance, entre les progrès fondamentaux des sciences naturelles et les bouleversements de la pensée sociale. Aux XVIe et XVIIe siècles l’astronomie et la mécanique naissantes, avec leur ouverture libératrice sur un univers héliocentrique et l’unité entre le mouvement cosmique et le mouvement local, trouvèrent une contrepartie dans des idéologies sociales tout aussi rationnelles et critiques. Les Lumières ont apporté une prise en considération nouvelle des sensations et la revendication pour la raison humaine de faire porter son discernement sur un monde jusqu’alors accaparé par le monopole idéologique du clergé Ce furent ensuite l’anthropologie et la biologie de l’évolution qui mirent à bas les conceptions traditionnelles et statiques de l’aventure humaine et les mythes de la création originelle et de l’histoire comme destinée théologique. En ouvrant de nouvelles perspectives et en mettant en évidence la dynamique séculière de l’histoire sociale, ces sciences ont constitué un puissant renfort pour les nouvelles doctrines socialistes et leurs idéaux de progrès humain issus de la Révolution française.
Face aux gigantesques bouleversements qui nous attendent, notre époque a besoin d’un corpus de savoir – scientifique et social – d’une envergure et d’une profondeur plus grandes, afin de résoudre les problèmes qui se posent à nous. Sans renoncer aux apports des théories scientifiques et sociales antérieures, il nous faut entreprendre une analyse critique plus complète de notre rapport au monde naturel. Nous devons rechercher les fondements d’une approche plus reconstruite des sérieux problèmes posés par les apparentes « contradictions » entre nature et société. Nous ne pouvons plus nous permettre de rester captifs de la tendance de la science classique à disséquer les phénomènes pour en examiner les fragments. Nous devons les associer, les relier, les observer dans leur totalité autant que dans leur spécificité.
C’est pour répondre à ces besoins que nous avons défini une discipline propre à notre temps : l’écologie sociale. Le mot « écologie », plus familier, a été forgé il y a un siècle par Ernst Haeckel pour désigner les recherches concernant l’interaction des animaux et des plantes avec leur milieu inorganique. Depuis Haeckel, le sens s’en est élargi et embrasse maintenant l’écologie des villes, celle de la santé et celle de l’esprit. La prolifération d’un terme à travers des domaines aussi variés peut sembler particulièrement souhaitable pour une époque qui cherche avec tant de ferveur une manière de cohérence intellectuelle et de vision unitaire. Mais elle peut aussi apparaître fort illusoire. À l’instar d’autres nouveaux venus du vocabulaire, holisme, décentralisation, dialectique, le mot écologie court le risque de rester suspendu dans l’air du temps, sans racines, sans contexte ni épaisseur. On s’en sert souvent comme d’une métaphore séduisante ou d’un slogan, et il perd ainsi le fort potentiel de logique interne qu’il contenait au départ. La portée radicale de tels mots se trouve donc rapidement neutralisée. C’est ainsi qu’« holisme » s’évanouit dans un soupir mystique, dans l’expression rhétorique du compagnonnage et de la communion écologique aboutissant à des salutations à usage interne du type « holistiquement vôtre ». Ce qui fut en son temps une position philosophique sérieuse se trouve réduit à du kitsch environnementaliste. Décentralisation a pour l’usage courant le sens d’alternatives logistiques au gigantisme, non celui d’échelle humaine qui rendrait possible une démocratie directe et de proche contact. Quant à l’écologie, son sort est pire encore. Bien trop souvent, tout comme le mot dialectique, elle ne sert que de métaphore, applicable à n’importe quelle forme d’intégration et de développement.
De façon plus troublante encore, le mot sert, depuis quelques années, à désigner une forme assez fruste de gestion technique du milieu naturel que l’on pourrait baptiser environnementalisme.
Je sais bien que beaucoup de ceux dont l’inspiration est authentiquement écologique emploient les termes écologie et environnementalisme de façon indistincte. Je souhaite cependant établir ici une distinction sémantique commode. Je propose que soit désignée par le terme environnementalisme une vision mécaniste et instrumentale de la nature, conçue comme un milieu passif composé d’objets tels qu’animaux, plantes, minéraux et autres, qui doivent simplement être traités de telle manière qu’ils rendent mieux service à leur utilisateur humain. L’environnementalisme, selon la définition que j’en donne, a tendance à ne voir dans la nature qu’un immense silo de « ressources naturelles » et de « matières premières ». Dans un tel cadre, le vocabulaire des environnementalistes n’épargne à peu près rien de ce qui pourrait ressortir d’une dimension sociale : les villes deviennent des « ressources urbaines », et leurs habitants des « ressources humaines ». Que le mot ressources apparaisse aussi souvent dans le discours environnementaliste sur la nature, les villes et les gens, est bien plus qu’un simple point de rhétorique. L’environnementalisme, au sens où j’emploie le terme, tend à se représenter le projet écologique, visant à l’établissement de rapports harmonieux entre humanité et nature, sous la forme d’une trêve plutôt que sous celle d’un équilibre durable. L’harmonie environnementaliste est centrée sur le développement de nouvelles techniques de pillage de la nature, aptes à perturber le moins possible l’habitat humain. L’environnementalisme ne remet pas en cause le postulat fondamental de la société actuelle, à savoir que la nature doit être dominée par l’homme ; au contraire, il s’efforce de rendre cette idée plus aisément praticable, en développant des moyens qui diminuent les risques encourus du fait de la destruction effrénée de l’environnement.
Pour distinguer l’écologie de l’environnementalisme, et aussi pour la démarquer des définitions abstraites, et souvent absconses, du terme, il me faut revenir à l’usage qui était le sien à l’origine et examiner la pertinence de son application à la société. En bref, l’écologie traite de l’équilibre dynamique de la nature, de l’interdépendance du vivant et du non vivant. Les êtres humains faisant eux aussi partie du monde naturel, cette science doit également s’appliquer au rôle de l’humanité dans la nature – plus particulièrement au caractère, aux formes et à la structure des rapports entre l’humanité et les autres espèces, et avec le substrat inorganique de l’environnement biotique. D’un point de vue critique, l’écologie révèle dans toute sa portée le déséquilibre résultant de la rupture entre l’humanité et le monde naturel. L’une des plus extraordinaires parmi les espèces qu’offre la nature, homo sapiens, a lentement et laborieusement transformé l’environnement naturel dont il est issu en un environnement social propre et unique. Ces deux environnements étant entrés en interaction au cours de phases évolutives extrêmement complexes, il est devenu tout aussi indispensable de parler d’écologie sociale que d’écologie naturelle.
Je le dis tout net : ce serait tourner en dérision la notion d’écologie sociale que d’omettre d’étudier les étapes de l’évolution humaine en question, au cours desquelles s’est formée toute une séquence de hiérarchies, de classes, de cités et finalement d’États. Malheureusement, notre discipline est assaillie par certains qui s’en prétendent les zélateurs et qui s’acharnent à vouloir compresser ces différentes phrases de l’évolution naturelle et humaine et les faire entrer dans une « unité » (et non un tout) universelle, béante « nuit où toutes les vaches sont noires », pour emprunter à Hegel un peu de sa causticité[3]. À tout le moins, l’usage que l’on fait habituellement du mot espèces, pour désigner les vivantes richesses qui nous entourent, devrait attirer notre attention sur les notions de spécificité, de particularisme – sur cette abondance et cette variété d’êtres et de choses différenciés qui constituent le véritable objet de l’écologie naturelle. Analyser cet ensemble différentiel, étudier les phases et les interfaces au travers desquelles il s’est constitué et où s’est effectué le long parcours de l’espèce humaine de l’animalité à la société – parcours jalonné de crises et de potentialités – c’est faire de l’écologie sociale l’une des plus puissantes disciplines où nourrir notre critique de l’ordre social actuel.
Mais l’écologie sociale ne propose pas qu’une critique de la rupture entre humanité et nature ; elle pose aussi l’exigence d’y remédier, et même de son indispensable et radical dépassement. Comme l’a souligné E. A. Gutkind[4] « l’écologie sociale a pour objectif la totalité et non la simple accumulation de détails innombrables rassemblés fortuitement et interprétés de façon subjective et insuffisante ». Elle est la science des rapports naturels et sociaux au sein de communautés ou écosystèmes[5]. En abordant ces rapports sur le mode holistique, c’est-à-dire sur la base de leur interdépendance mutuelle, l’écologie sociale cherche à démêler les formes et les modèles de relations qui rendent intelligibles une communauté, qu’elle soit naturelle ou sociale. Le holisme, dans ce cas, est le résultat d’un effort conscient pour discerner comment les divers éléments d’une communauté s’organisent, et de quelle manière sa « géométrie » (comme auraient pu dire les Grecs) fait du tout plus que la somme des parties. Il ne faut donc pas confondre la « totalité » à laquelle fait allusion Gutkind avec une « unité » spectrale, sorte de nirvana sans structure dans lequel se dissoudrait le cosmos; il s’agit au contraire d’une construction riche en articulations variées, possédant une histoire et une logique interne propres.
L’histoire est aussi importante que la forme ou la structure. Dans une très large mesure, l’histoire d’un phénomène constitue le phénomène lui-même. Nous sommes, réellement, tout ce qui a existé avant nous et nous pouvons devenir à notre tour infiniment plus que ce que nous sommes. Il est étonnant de constater que si peu d’éléments évolutifs des différentes formes de vie se sont perdus au cours de l’évolution naturelle et sociale, et même à l’intérieur de notre propre corps, ainsi que l’atteste le développement de l’embryon. L’évolution nous habite (de même qu’elle habite le monde alentour) sous forme d’éléments constitutifs de notre nature même.
Qu’il me suffise pour l’instant de faire remarquer que la totalité n’est pas la pâle « universalité » indifférenciée impliquant la réduction de tout phénomène à ce qu’il a de commun avec tout le reste. Ce n’est pas non plus l’omniprésente, la céleste « énergie » qui se substituerait à l’ample différenciation matérielle dont sont faits les règnes naturel et social. Bien au contraire, la totalité inclut l’ensemble disparate de structures, d’articulations, de médiations, où le tout va puiser la riche variété de ces formes et où ce qu’un esprit étroitement analytique réduirait à une suite de détails « innombrables » et « fortuits » acquiert ainsi des propriétés qualitatives uniques.
*
Des expressions telles que le tout, la totalité, communauté même, sont teintées de nuances menaçantes pour une génération qui a connu le fascisme et d’autres idéologies totalitaires. Ces mots évoquent l’image d’une « totalité » atteinte au moyen de l’homogénéisation, de la standardisation et d’une coordination répressive des êtres humains. Ces craintes sont renforcées par l’idée d’une « totalité » qui semble donner à l’histoire une finalité inexorable – laquelle suppose une conception supra-humaine, étroitement téléologique, des lois de la société, et refuse à la volonté humaine et au choix individuel la possibilité d’influencer le cours des événements sociaux. Pareilles notions des lois de la société et de la téléologie ont servi à mettre l’individu sous le joug implacable de forces supra-humaines échappant au contrôle humain. Notre siècle souffre d’une pléthore d’idéologies totalitaires qui, en mettant les hommes au service de l’histoire, leur interdisent de jouer un rôle quelconque au service de leur propre humanité.
Une telle conception totalitaire du « tout » s’oppose de façon très nette à ce que les écologistes entendent par là. Au-delà de ce que nous entendons comme une conscience plus aiguë des formes et des structures, nous en arrivons maintenant à un important principe de l’écologie : la totalité écologique n’est pas une homogénéité immuable, il s’agirait bien plutôt du contraire – d’une dynamique de l’unité dans la diversité. Équilibre et harmonie sont atteints, dans la nature, par la différenciation constante, par une diversité toujours croissante. La stabilité écologique n’est pas fonction de la simplicité et de l’homogénéité, mais de la complexité et de la variété. La capacité d’un écosystème à maintenir son intégrité ne dépend pas de l’uniformité du milieu, mais bien de sa diversité.
Un exemple frappant de ce principe nous est offert par l’expérience des différentes stratégies écologiques en matière de cultures vivrières. Les agriculteurs ont à maintes reprises fait l’expérience de résultats désastreux, dus à cette conception classique de l’agriculture qui donne la priorité à un seul type de récolte, autrement dit la monoculture, pour reprendre un mot qui a fait fortune et qui désigne ces immenses champs de blé ou de maïs qui s’étendent à perte de vue dans de nombreuses régions du monde. Il est notoire qu’en l’absence de cultures croisées, lesquelles fournissent à la fois les éléments compensatoires et l’appui mutuel caractéristiques des mélanges de populations animales et végétales, la situation agricole d’une région se détériore. Des insectes inoffensifs deviennent des fléaux, leurs barrières naturelles, qui comprenaient oiseaux et petits mammifères, ayant été levées. Le sol, qui ne contient plus en quantité suffisante les vers, les bactéries pouvant fixer l’azote, les engrais végétaux, n’est bientôt plus que sable – support minéral qui absorbera d’énormes quantités de sels azotés inorganiques dont la distribution était auparavant assurée par cycles et selon des rythmes mieux adaptés à la croissance des cultures à l’intérieur de chaque écosystème. Au mépris le plus total de la complexité de la nature et des subtiles nécessités de la vie animale et végétale, les conditions matérielles de l’agriculture sont grossièrement simplifiées; il faut maintenant, pour en satisfaire les besoins, employer des fertilisants synthétiques très solubles, qui s’infiltreront dans l’eau potable, et de dangereux pesticides, qui laisseront des résidus dans les aliments. Le haut niveau de qualité que la diversité des cultures et des animaux avait autrefois permis d’atteindre, dans des récoltes vivrières dont la valeur nutritive était probablement supérieure et d’où étaient absents les agents toxiques persistants, est maintenant à peine approché par les monocultures, qui reposent sur des substances chimiques toxiques et des éléments nutritifs grandement simplifiés.
Si l’on considère que la poussée de l’évolution a bien été dans le sens d’une diversité croissante, que la colonisation de la planète par la vie n’a été possible que comme effet de la variété biotique, un sage réexamen des prétentions humaines devrait nous inciter à la prudence lorsqu’il s’agit de bouleverser les processus naturels. Que les êtres vivants, émergeant il y a des millions d’années de leur habitat aquatique primordial pour aller coloniser jusqu’aux régions les plus inhospitalières de la terre, aient pu créer la riche biosphère qui la recouvre actuellement, cela n’a été possible qu’en raison de l’incroyable faculté d’adaptation de la vie et de l’immense héritage de formes accumulées au cours de son long développement. Beaucoup de ces formes, même les plus simples et les plus primitives, n’ont jamais disparu – si grandes qu’aient pu être leurs modifications au cours de l’évolution. Les formes simples d’algues et d’invertébrés, qui caractérisent les commencements des règnes végétal et animal, existent toujours en grand nombre. Elles représentent les conditions préalables à l’existence d’organismes plus complexes, auxquels elles fournissent la subsistance, des mécanismes de décomposition, et jusqu’à l’oxygène et au gaz carbonique de l’atmosphère. Précédant de plus d’un milliard d’années les plantes et mammifères « supérieurs », elles n’en maintiennent pas moins des relations avec leurs descendants plus complexes au sein d’écosystèmes souvent impossibles à démêler.
S’imaginer que la science maîtrise dans ses moindres détails ce vaste ensemble d’interactions organiques et inorganiques est bien pire que de l’arrogance : c’est de la bêtise, ni plus ni moins. Si l’unité dans la diversité est l’un des principes fondamentaux de l’écologie, l’inépuisable richesse de la flore et de la faune contenue dans un arpent de terre nous amène à un autre postulat écologique de base : la nécessité de laisser à la nature une grande marge de spontanéité. L’impératif catégorique du « respect de la nature » a des conséquences concrètes. Ce serait pure folie de croire que notre connaissance de ce kaléidoscope de formes qu’est la vie, si complexe, si richement et finement construit, et perpétuellement renouvelé, puisse aboutir à une « maîtrise » si grande que nous aurions le champ libre pour manipuler la biosphère.
Il faut donc laisser à la spontanéité de la nature une part considérable de jeu – afin qu’agissent les multiples forces biologiques qui donnent naissance à une situation écologique diversifiée. « Travailler avec la nature » nous oblige à favoriser la variété biotique résultant du développement spontané des phénomènes naturels. Loin de moi l’idée que nous devrions nous en remettre à une « Nature » mythique, inaccessible à la compréhension et à l’intervention humaines, une Nature qui inspirerait aux hommes terreur et soumission. Comme le fait observer avec finesse Charles Elton[6] la conclusion la plus évidente que nous puissions tirer des deux principes écologiques en question est peut-être la suivante : « Il est certes nécessaire de gérer l’avenir du monde, mais plutôt qu’à une partie d’échecs, c’est à la conduite d’un navire que cette tâche devrait être comparée. » Ce que nous pouvons espérer de l’écologie, celle de la nature comme celle de la société, c’est qu’elle nous apprenne à découvrir les courants et à comprendre leurs mouvements.
*
Ce qui confère à la conception écologique son caractère extraordinairement libérateur, en fin de compte, c’est sa remise en cause des notions classiques de hiérarchie. Il est important de souligner que cette remise en question est implicite : il faut la faire surgir, non sans difficultés, du discours de l’écologie, tout imprégné des partis pris du scientisme traditionnel. Les écologistes ont rarement conscience des forts arguments philosophiques que peut fournir leur discipline en faveur d’une vision non hiérarchique de la société. Comme de nombreux savants, ils répugnent aux généralisations philosophiques, étrangères selon eux à leur recherche et à leurs conclusions – préjugé qui est lui-même toute une philosophie, qui s’enracine dans la tradition de l’empirisme anglo-américain. En outre, suivant en cela leurs collègues d’autres disciplines, leur conception de la science est formée sur le modèle de la physique. Ce préjugé, qui remonte à l’époque de Galilée, a eu pour effet la très large acceptation, par les milieux écologiques, de la théorie des systèmes. Bien que cette théorie ait sa place dans le répertoire scientifique, le risque est grand toutefois qu’elle se transforme en une théorie générale, quantitative et réductionniste des systèmes d’énergie, au cas où elle prévaudrait sur les descriptions qualitatives des écosystèmes, fondées sur l’évolution biologique, la diversité et une vision holistique. Quels que soient les mérites de la théorie des systèmes à rendre compte des flux énergétiques au sein des écosystèmes, la primauté que donne cette analyse à l’aspect quantitatif la conduit à ne voir dans les formes vivantes que de simples consommateurs et producteurs de calories.
Après cette mise en garde, je dois insister sur l’impossibilité qu’il y a à décrire les écosystèmes de façon satisfaisante en termes de hiérarchie. La question de savoir s’il existe, dans les communautés animales et végétales et au sein d’une même espèce, des individus « dominants » et d’autres « soumis » pourrait faire l’objet d’une très longue discussion. Mais attribuer un rang à chaque espèce à l’intérieur d’un écosystème, c’est-à-dire effectuer un classement entre les espèces, voilà bien de l’anthropomorphisme, et des plus vulgaires. Comme le fait observer Alison Jolly [7], « le concept de hiérarchies animales a une histoire mouvementée. Schjelderup-Ebbe, qui avait découvert la hiérarchie du becquetage chez les poules, élargit sa trouvaille aux dimensions d’une théorie teutonique du despotisme universel. C’est ainsi que l’eau usant la roche était « dominante ». […] Schjelderup-Ebbe appliqua le terme de « dominance » au classement hiérarchique des animaux, et de nombreux chercheurs se mirent à reconnaître, tout satisfaits, des hiérarchies de dominance dans de nombreux groupes de vertébrés ».
Si l’on s’avise que tout écosystème peut aussi être considéré comme une chaîne alimentaire, on peut se le représenter sous la forme d’un réseau circulaire, d’un entrelacs de relations entre plantes et animaux (plutôt que comme une pyramide stratifiée au sommet de laquelle se tiendrait l’homme) dont font partie des créatures aussi fortement différenciées que les micro-organismes et les grands mammifères. Quiconque examine pour la première fois le diagramme d’une telle chaîne alimentaire est déconcerté par l’impossibilité de repérer un point d’entrée dans le réseau. On peut parcourir la chaîne à partir d’un point quelconque, elle nous y ramènera toujours sans ménager aucune sortie apparente. Mis à part l’énergie provenant de la lumière solaire (et diffusée par radiation), le système, selon toute apparence, est clos. Chaque espèce, qu’il s’agisse de bactéries ou de biches, est enchaînée aux autres dans un réseau d’interdépendance, même si les liens sont indirects. Dans la chaîne, le prédateur est aussi une proie, même si les organismes les plus « inférieurs » ne font que l’affaiblir par des maladies ou contribuent à le consommer après sa mort.
La prédation n’est pas non plus le seul lien qui unit une espèce à l’autre. Il existe déjà une littérature florissante qui montre à quel point le mutualisme symbiotique est un facteur important en faveur de la stabilité écologique et de l’évolution biologique. On constate, chez les animaux et chez les plantes, une adaptation permanente qui leur permet de s’apporter, sans le savoir, une aide réciproque (que ce soit par l’échange de fonctions biochimiques mutuellement bénéfiques ou dans le cas toujours spectaculaire d’une assistance physique) ; une perspective entièrement nouvelle s’ouvre ainsi sur la nature des écosystèmes, sur leur stabilité et leur développement.
Plus la chaîne alimentaire est complexe et moins elle perd de sa stabilité lorsqu’une ou plusieurs espèces en sont retirées. D’où l’immense importance qu’il faut accorder à la complexité et à la diversité entre espèces à l’intérieur d’un système pris dans son ensemble. Un effondrement marquant se produira dans des écosystèmes simples, tels que ceux des régions arctiques et désertiques, par exemple si l’on extermine les loups qui contrôlent les populations d’herbivores ou si l’on fait disparaître une proportion importante des reptiles qui contrôlent les populations de rongeurs dans les écosystèmes arides. En contraste, les écosystèmes des régions tempérées et tropicales, peuplées par une flore et une faune très variées, peuvent supporter sans grands bouleversements la perte de certains carnivores ou herbivores.
*
Pour quelle raison des termes empruntés aux hiérarchies sociales humaines acquièrent-ils une force remarquable lorsqu’il s’agit de décrire les relations unissant plantes et animaux entre eux ? Y a-t-il vraiment dans un écosystème un « roi des animaux » et de « vils serfs » ? Certains insectes en réduisent-ils d’autres à « l’esclavage » ? Une espèce peut-elle en « exploiter » une autre ?
L’usage indiscriminé qui est fait de ces termes en écologie soulève d’importants problèmes. Que ces mots soient porteurs d’une très forte charge de valeur sociale est une évidence trop flagrante pour justifier une longue discussion. Beaucoup de gens font preuve d’une touchante crédulité dans la manière qu’ils ont de considérer la nature comme une dimension de la société. Les grognements d’un animal ne le rendent pas « méchant » ou « sauvage », pas plus qu’il ne « se conduit mal » ou qu’il ne « mérite » une punition simplement parce qu’il réagit de façon appropriée à certains stimuli. En jugeant ainsi les phénomènes naturels d’un point de vue anthropomorphique, on dénie à la nature sa dimension propre. Plus sinistre encore est l’emploi de concepts hiérarchiques pour conférer aux phénomènes naturels « ordre » et « intelligibilité ». Ce procédé a pour effet de renforcer les hiérarchies humaines en justifiant la domination des hommes et des femmes comme étant un trait inhérent à « l’ordre naturel ». La supériorité de l’espèce humaine se voit transcrite dans le code génétique en tant que réalité biologique immuable – de même que la subordination des enfants aux adultes, des femmes aux hommes, des hommes à d’autres hommes.
La confusion même qui préside à l’usage de termes hiérarchiques dans la mise en ordre des différenciations naturelles ne va pas sans incohérence. La « reine » des abeilles ignore qu’elle est reine. L’activité fondamentale d’une ruche vise la reproduction, et la « division du travail » qu’on veut y voir, pour reprendre une expression grossièrement abusive, n’a aucun sens, s’agissant d’un vaste organe sexuel qui n’accomplit aucune fonction économique véritable. Une ruche sert à produire de nouvelles abeilles. Le miel qu’en tirent hommes et animaux est une largesse de la nature : au sein de l’écosystème, les abeilles sont mieux adaptées à la satisfaction des besoins reproductifs des plantes, par la diffusion du pollen, qu’à celle des besoins animaux importants. L’analogie entre la ruche et la société, qui a paru irrésistible à tant de théoriciens, illustre de façon frappante à quel point nos vues sur la nature sont modelées par des intérêts sociaux qui nous sont propres.
Aborder les prétendues hiérarchies des insectes de la même manière que celles qu’on veut voir chez d’autres animaux, ou pire, choisir d’ignorer totalement les fonctions très différentes accomplies par les communautés animales, c’est pousser le raisonnement analogique jusqu’à l’absurde. Si la nature des liens entre primates semble impliquer dominance et soumission, les raisons en sont fort diverses. Et cependant ils sont traités sous la même catégorie « hiérarchique » que les insectes « sociaux » – malgré les différentes formes que prennent, chez les premiers, les liens en question et leur stabilité précaire. On cite les babouins des savanes africaines comme formant les troupes les plus rigidement hiérarchisées parmi les primates, mais cette rigidité se dissout lorsque l’on considère leur « classement » dans un habitat forestier. Dans les savanes même, on peut se demander si les mâles alpha gouvernent, contrôlent ou coordonnent les rapports parmi la troupe. N’importe lequel de ces termes peut être justifié par divers arguments, mais chacun possède une signification nettement distincte de celle qui est la sienne lorsqu’il s’applique à un contexte social humain. Ce qui apparaît comme un harem, avec son « patriarche », peut n’être qu’une configuration sexuelle aussi floue qu’une maison de tolérance, selon que telle ou telle femelle soit en rut, que des changements se soient produits dans le milieu, ou que le primate « patriarche » manifeste simplement son embarras devant la situation dans son ensemble.
Les babouins, il est bon de le souligner, ne sont pas des singes anthropoïdes, malgré la similarité présumée entre leur habitat de savane et celui des premiers hominiens. Leur branche s’est séparée du tronc évolutif commun des anthropoïdes il y a plus de vingt millions d’années. Nos plus proches cousins dans l’évolution, les grands singes, semblent devoir réduire à néant les préjugés dont j’ai parlé au sujet de la hiérarchie. Parmi les quatre espèces de grands singes, les gibbons ne possèdent à première vue aucun système « hiérarchique ». Chez le chimpanzé, considéré par de nombreux primatologistes comme celui des grands singes le plus semblable à l’homme, les formes que prend la « stratification » sont si variables et (selon les caractéristiques écologiques du territoire, qui peuvent être sérieusement affectées par la présence de chercheurs) les types d’associations qui s’établissent sont si instables que le mot hiérarchie devient un obstacle à la compréhension des caractéristiques de son comportement. L’orang-outan ne semble guère connaître ces prétendus rapports de dominance et de soumission. Les gorilles des montagnes, malgré leur terrible réputation, ne présentent pas de « stratification » importante, sauf lors de menaces de prédateurs ou d’agression interne.
Tous ces exemples apportent quelques justifications au reproche que fait Elise Boulding à ceux qui ont traité du parallèle entre l’homme et l’animal d’avoir, dans leur goût immodéré de la hiérarchie et du patriarcat, « donné la préférence au babouin plutôt qu’au gibbon comme modèle du comportement des primates[8] ». À la différence du babouin, fait-elle observer, le gibbon est plus proche de nous physiquement et, ajouterions-nous, plus proche aussi sur l’arbre évolutif des primates. « Le choix de tel ou tel modèle du comportement des primates est, de toute évidence, déterminé culturellement, conclut-elle. Qui voudrait ressembler aux gibbons, paisibles, végétariens, partageant leur nourriture, chez qui les pères, lorsqu’il s’agit d’élever les enfants, y prennent une aussi grande part que les mères, et où chacun vit en petits groupes familiaux en dehors desquels on ne s’assemble guère ? Il vaut beaucoup mieux se comparer aux babouins, qui vivent en groupes importants et solidement unis, jalousement fermés aux babouins étrangers, où tout le monde sait qui commande, et chez qui la mère prend soin des petits tandis que le père s’en va chasser ou pêcher. »
Et encore Boulding fait-elle trop de concessions au sujet des primates des savanes. Même en élargissant le sens du mot dominance pour l’appliquer aux « reines » des abeilles et aux babouins « alpha », on peut difficilement parler de domination en ce qui concerne des actes particuliers de contrainte entre individus, d’animal à animal. Tel ou tel acte ne constitue pas une institution, tel ou tel épisode ne fait pas l’histoire. Et les schémas de comportement des insectes, fortement structurés et enracinés dans l’instinct, sont trop inflexibles pour être considérés comme sociaux. À moins que l’on donne au mot hiérarchie le sens cosmique de Schjelderup-Ebbe, dominance et soumission doivent s’appliquer à des rapports institutionnalisés, des rapports que les êtres vivants instituent ou créent littéralement, mais qui ne sont cependant jamais implacablement fixés par l’instinct d’une part, ni n’ont un caractère d’idiosyncrasie d’autre part. J’entends par là que ces rapports doivent impliquer une structure spécifiquement sociale, dont l’échelle de contraintes et de privilèges existe en dehors des idiosyncrasies individuelles qui peuvent apparaître comme dominantes au sein d’une communauté donnée, autrement dit une hiérarchie inspirée par une logique sociale allant au-delà des interactions individuelles et des schémas innés de comportement[9].
Ces caractéristiques sautent aux yeux lorsque nous avons affaire à des sociétés humaines, et que nous parlons par exemple de bureaucraties qui « s’auto-perpétuent », en les étudiant sans considération individuelle des bureaucrates qui les composent. Toutefois, lorsqu’il s’agit de primates non humains, la hiérarchie, le statut, la domination que l’on croit communément reconnaître chez ces animaux sont précisément les idiosyncrasies de comportement de certains individus. Mike, le chimpanzé alpha de Jane van Lawick-Goodall, avait acquis son « statut » en donnant la charge à un groupe de mâles tout en produisant un vacarme assourdissant à l’aide de deux bidons d’essence vides qu’il frappait l’un contre l’autre [10]. À ce point de son récit, van Lawick-Goodall se demande si Mike aurait pu devenir un mâle alpha sans les bidons d’essence. En guise de réponse, elle suggère que « l’usage d’objets fabriqués par l’homme est probablement le signe d’une intelligence supérieure ». Devient-on un mâle alpha en raison d’une vague différence d’intelligence plutôt qu’en fonction de l’agressivité, du caprice, ou de l’arrogance ? Quoi qu’il en soit, tout cela témoigne bien plus de la subtile projection de valeurs humaines historiquement déterminées que de l’objectivité scientifique que l’éthologie se plaît à revendiquer.
Les apparentes caractéristiques hiérarchiques de nombreux animaux ressemblent plus aux variations entre les anneaux d’une chaîne qu’aux stratifications que l’on voit s’établir dans les sociétés et les institutions humaines. Même les prétendues sociétés de classes des Indiens du Nord-Ouest sont, comme nous le verrons, des chaînes de relations interindividuelles, alors que les premiers envahisseurs euro-américains, projetant sur les Indiens l’image de leur propre société, ont voulu y voir des liens de classe entre couches sociales. Si les actes ne sont pas des institutions ni les épisodes ne constituent pas l’histoire, de même des traits du comportement individuel ne suffisent pas à former des classes ou des couches sociales. Ces dernières sont faites d’un matériau moins meuble et ont une vie propre, distincte des personnalités qui en forment la substance.
*
Comment l’écologie pourra-t-elle éviter le raisonnement analogique qui donne si souvent à l’éthologie et à la sociobiologie l’aspect de fallacieuses projections de la société humaine dans la nature ? Existe-t-il des concepts capables de donner une signification commune, à la fois dans la nature et dans la société, à l’unité dans la diversité, à la spontanéité naturelle, aux rapports non hiérarchiques ? Compte tenu des nombreux principes mis en évidence par l’écologie de la nature, pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Et pourquoi ne pas introduire dans l’étude de la société d’autres notions écologiques, fussent-elles moins séduisantes, telles que la prédation et l’agression ?
La plupart de ces points sont devenus, au début de ce siècle, autant de questions essentielles de la théorie sociale, lorsque l’École de sociologie urbaine de Chicago[11] mit tout son zèle à l’application de la quasi-totalité des concepts de l’écologie naturelle au développement et à la « physiologie » des villes. Robert Park, Ernest Burgess et Roderick McKenzie, passionnés par la nouvelle science, réussirent à imposer dans leurs études sur Chicago un modèle biologique rigoureux dont la force et l’inspiration domineront la sociologie urbaine américaine pendant deux générations. On retrouve parmi leurs postulats l’idée de succession écologique, la distribution de l’espace, les aires de répartition, les équilibres anabolique et catabolique, et même la concurrence et la sélection naturelle, qui auraient pu faire glisser l’École vers une forme insidieuse de darwinisme social, n’eût été le parti pris libéral de ses fondateurs.
Malgré des résultats empiriques admirables, l’École allait sombrer sous son réductionnisme métaphorique. L’application indiscriminée des catégories les vida de leur sens. Lorsque Park compare l’apparition de certains services municipaux spécialisés à la « dominance successive de différentes espèces de plantes », séquence qui culmine dans la formation d’une forêt de hêtres ou de pins, l’analogie est manifestement forcée et déviée jusqu’à l’absurde. Sa comparaison des groupes ethniques, culturels, professionnels et économiques avec les « invasions d’espèces végétales » dénote une absence de discernement théorique, qui réduit les caractéristiques sociales humaines aux caractéristiques écologiques des plantes. Ce qui faisait défaut à Park et à ses collaborateurs, c’étaient les outils philosophiques qui leur auraient permis de distinguer les phases qui unissent et séparent à la fois les phénomènes naturels et sociaux dans un continuum de développement. Ce qui n’était que similarité de surface devint ainsi identité parfaite – avec pour conséquence, malheureusement, la constante réduction de l’écologie sociale à l’écologie de la nature. L’évolution du naturel au social et ses innombrables jalons, qui auraient pu servir de critères à un choix rationnel de catégories écologiques, ne faisaient pas partie du bagage théorique de l’École.
Chaque fois que nous voulons ignorer que les rapports sociaux humains vont au-delà des liens qui existent entre animaux et végétaux, nous avons tendance à nous engager dans deux directions également fausses. Soit nous succombons à un dualisme très strict, qui sépare abruptement le naturel du social, soit nous tombons dans un réductionnisme grossier où l’un et l’autre se dissolvent. Dans les deux cas, les problèmes soulevés cessent, à proprement parler, d’occuper notre réflexion. Nous ne faisons que saisir la « solution » la moins inconfortable à un problème d’une complexité extrême : la nécessité d’analyser les étapes au cours desquelles une nature biologique « muette » se transforme en une nature humaine consciente.
L’unité dans la diversité, dans la nature, ne serait qu’une évocation métaphorique de l’unité dans la diversité de la société, n’était le concept philosophique de totalité. J’entends par totalité des niveaux d’actualisation variables, le déploiement des multiples particularités potentielles. Cette potentialité peut aussi bien être une graine qu’on vient de semer, un enfant qui vient de naître, qu’une communauté ou une société nouvellement formée. Le fameux passage où Hegel décrit en termes biologiques le « déploiement » de la connaissance humaine s’applique ici presque point par point[12] : « L’éclosion de la fleur fait disparaître le bourgeon, et l’on pourrait dire que celui-ci est réfuté par celle-là ; de la même façon, lorsque le fruit apparaît, la fleur à son tour s’avère être une fausse manifestation de la plante, et c’est maintenant le fruit qui se présente comme la vérité. Ces formes ne sont pas simplement distinctes les unes des autres, elles se supplantent aussi comme étant mutuellement incompatibles. Et cependant leur nature changeante en fait des moments d’une unité organique au sein de laquelle non seulement elles n’entrent pas en conflit, mais où chacune est aussi nécessaire que l’autre; et c’est cette nécessité mutuelle qui seule constitue la vie du tout. »
Si je me suis arrêté à ce remarquable passage, c’est que Hegel ne l’entend pas simplement comme une métaphore. Son exemple biologique et l’objet social qui constitue son propos convergent de telle sorte qu’ils sont dépassés, précisément en tant qu’aspects analogues d’un processus plus vaste. La vie elle-même, en tant que distincte du non vivant, émerge du latent inorganique avec toutes les particularités que la logique interne de ses formes les plus primitives d’auto-organisation a produites de façon immanente. Et ainsi de la société, en tant que distincte du biologique, de l’humanité par rapport à l’animalité, et de l’individualité par rapport à l’humanité. Il ne faut pas voir de manipulation malveillante dans la maxime de Hegel, « le vrai, c’est le tout », si l’on déclare : « le tout, c’est le vrai ». On peut considérer cette inversion des termes comme signifiant que le vrai consiste en l’auto-accomplissement d’un procès au travers de son développement, en l’épanouissement de ses particularités latentes en leur plénitude ou totalité, exactement de la même manière que les potentialités d’un enfant trouvent leur expression dans les multiples expériences et la croissance physique qui accompagnent l’âge adulte.
*
Ne cédons pas au piège des comparaisons directes entre plantes, animaux et êtres humains ou entre écosystèmes d’animaux et de plantes et communautés humaines. Pas un seul d’entre eux n’est parfaitement assimilable aux autres. En acceptant de trop bon gré de telles équivalences, nous ne ferions qu’en revenir à la perspective de Park, Burgess et McKenzie, pour ne rien dire de l’actuel florilège des sociobiologistes[13]. Le trait d’union écologique entre les communautés animales et végétales, d’une part, et les communautés humaines d’autre part, ne réside pas dans les détails de la différenciation, mais bien plutôt dans une logique de la différenciation. Car en réalité, totalité veut dire complétude. La stabilité dynamique du tout procède d’un niveau visible de complétude, tant dans les communautés humaines que dans les écosystèmes à leur apogée. Le trait d’union entre ces divers modes de totalité et de complétude, aussi divers qu’ils puissent être dans leurs spécificités et leurs caractéristiques qualitatives, réside dans la logique même de leur développement. Une forêt au sommet de sa stabilité forme un tout, est complète, en raison du même processus unificateur – de la même dialectique – par lequel une formation sociale particulière constitue un tout.
Ce n’est pas porter atteinte au caractère unique des phénomènes que de considérer ainsi totalité et complétude comme étant le résultat d’une dialectique immanente à ceux-ci, pas plus que les lois de la pesanteur ne portent atteinte au caractère unique des objets qui y sont « soumis ». En ce sens, l’idéal d’un équilibre humain, produit de l’ajustement de la communauté, est issu en droite ligne de l’idéal d’une nature stabilisée, produit de l’ajustement de l’environnement naturel. Marx a tenté d’enraciner l’identité de l’humanité et sa découverte d’elle-même dans l’interaction productive avec la nature. Mais il me faut ajouter que non seulement l’humanité imprime sa marque au monde naturel et le transforme, mais qu’aussi la nature imprime la sienne au monde humain et le transforme. Retournant contre lui-même le langage de la hiérarchie, disons que ce n’est pas seulement nous qui « domptons » la nature, mais que c’est aussi la nature qui nous « dompte ».
Il ne faudrait pas prendre ces formules pour de simples métaphores. Pour qu’on ne m’accuse pas de faire du concept de totalité un principe dialectique abstrait et par trop éthéré, je ferai observer que l’interaction des écosystèmes naturels et des communautés humaines prend des formes très existentielles. Notre nature animale n’est jamais si éloignée de notre nature sociale que nous puissions nous soustraire au monde organique qui est en nous et hors de nous. Du développement de l’embryon jusqu’aux couches de notre cerveau, c’est en partie notre propre évolution naturelle que nous récapitulons. La distance n’est pas si grande entre nos ancêtres primates et nous pour que nous puissions feindre d’ignorer cet héritage physique, dans notre vision stéréoscopique, dans l’acuité de notre intelligence et nos doigts préhensiles. Notre intégration en tant qu’individus à la société se fait par phases, de la même manière que la société prend forme en émergeant progressivement de la nature.
Ces continuités, bien sûr, font figure d’évidences. Ce qui est souvent moins évident, c’est tout ce que la nature elle-même recèle de potentialité en matière de formes sociales différenciées. La nature est une condition préalable au développement de la société – et pas seulement à son émergence – au même titre que le sont la technique, le travail, le langage et la conscience. Condition préalable non pas simplement au sens où l’entendait William Petty – pour qui, le travail étant le Père des richesses, la nature en serait la Mère. Cette formule, chère à Marx, exprime en fait un dédain de la nature en lui attribuant la notion patriarcale de « passivité » féminine. Les affinités entre la nature et la société sont plus agissantes qu’on ne serait enclin à l’admettre. Des structures naturelles très spécifiques – des écosystèmes très spécifiques – constituent le fondement de structures sociales très spécifiques. Au risque de faire usage d’une formule âprement controversée, je dirai qu’il est possible d’élaborer un « matérialisme historique » du développement naturel, qui ferait d’une nature passive – « l’objet » du travail humain – une nature active, créatrice du travail humain. Le « métabolisme » du travail et de la nature fonctionne dans les deux sens, de sorte que c’est l’interaction de la nature et de l’humanité qui aboutit à l’actualisation de leurs potentialités communes à l’intérieur des sphères naturelle et sociale. Cette forme d’interaction, au regard de laquelle les termes de Père et de Mère sonnent faux, peut être définie de manière très concrète. L’accent mis récemment sur les biorégions comme cadres de communautés humaines diverses apporte de solides arguments en faveur de la nécessaire réadaptation des techniques et des styles de travail aux conditions et possibilités des zones écologiques particulières. Les exigences et possibilités de chaque biorégion imposent une lourde contrainte aux prétentions de l’humanité à la souveraineté sur la nature et à l’autonomie par rapport aux besoins de celles-ci. S’il est vrai que les hommes font leur propre histoire, mais pas dans les conditions de leur choix, comme le dit Marx [14], il n’en est pas moins vrai que l’histoire fait la société, mais pas dans les conditions de son choix. La dimension cachée que suggère ce jeu avec les mots et la célèbre formule de Marx n’est autre que l’histoire naturelle qui participe à la formation de l’histoire sociale – et bien en tant que nature active, concrète, existentielle, qui émerge, d’une phase à l’autre d’un développement toujours plus complexe, sous la forme d’écosystèmes également complexes et dynamiques. Nos écosystèmes, à leur tour, sont reliés les uns aux autres dans des biorégions complexes et dynamiques au plus haut point. Le caractère ô combien concret de cette dimension cachée du développement social – et à quel point les prétentions de l’humanité à la souveraineté doivent s’y plier – n’est apparu que tout récemment, compte tenu de la nécessité d’élaborer des alternatives technologiques qui soient à la fois adaptées aux diverses biorégions et productives pour la société. De là que notre concept de totalité ne constitue pas la fresque achevée des rapports existant dans la nature et la société que nous pourrions offrir en pâture à la curiosité des sociologues. C’est celui d’une histoire naturelle féconde, constamment agissante et changeante – à la façon dont l’enfance va vers l’adolescence qui l’absorbe bientôt, puis l’adolescence vers l’âge adulte.
La nécessité d’impartir à la nature un sens de l’histoire est tout aussi impérieuse que celle d’impartir un sens de l’histoire à la société. Jamais un écosystème n’est une communauté aléatoire de plantes et d’animaux qui prendrait forme par le simple fait du hasard. Il possède à part entière une potentialité, une direction, un sens et un mode d’auto-réalisation. Considérer un écosystème comme donné (mauvaise habitude qu’inculque le scientisme à l’observateur réputé neutre) est tout aussi anhistorique que de considérer une communauté humaine comme donnée. L’un et l’autre ont une histoire, qui donne intelligibilité et ordonnance à leurs relations internes et une orientation à leur développement.
À ses commencements, l’histoire humaine est pour une large part histoire naturelle autant qu’histoire sociale – comme l’indiquent clairement les structures de parentés traditionnelles et la division sexuelle du travail. L’histoire humaine ne pourra jamais se débarrasser ou se déprendre de la nature. Elle sera toujours, nous le verrons, imbriquée dans la nature – que nous voyons dans cette dernière un limon, ou une mère féconde. Ce qui pourrait bien s’avérer l’épreuve la plus difficile à laquelle soit soumis le génie humain est de savoir quelle sorte de nature nous favoriserons : une nature richement organique et complexe ou une nature inorganique et désastreusement simplifiée.
Non seulement l’engagement de l’humanité dans la nature a des racines très profondes, mais il ne cesse de prendre des formes plus subtiles encore que n’auraient pu le prévoir les théories les mieux élaborées. La connaissance que nous avons de cet enracinement en est encore, pour ainsi dire, à sa « préhistoire ». Pour Ernst Bloch[15], nous n’avons pas seulement avec la nature une histoire commune, abstraction faite de toutes les différences existant entre nature et société, mais nous partageons également avec elle une même destinée : « La nature en sa manifestation ultime, tout comme l’histoire en sa manifestation ultime, repose à l’horizon du futur… Plus une technique d’alliance, médiatisée avec la coproductivité de la nature, sera possible, remplaçant la technique superficielle et isolée, plus sûrement les forces constituantes d’une nature gelée seront à nouveau libérées. La nature n’est pas du passé, elle est le chantier non encore déblayé, les outils non encore conçus dans leur forme appropriée pour bâtir la demeure humaine qui n’a pas non plus encore de forme appropriée. La capacité du sujet naturel, avec son bagage de problèmes, à participer à la construction de cette demeure est le corrélât objectif-utopique de l’imagination humaine-utopique, comprise en termes concrets. C’est pourquoi il est certain que la demeure humaine ne se trouve pas seulement dans l’histoire, sur le terrain de l’activité humaine; elle se trouve aussi et surtout sur le terrain d’un sujet de la nature médiatisé et sur le chantier de la nature. Le concept limite de celle-ci n’est pas le commencement de l’histoire humaine, quand la nature (toujours présente dans l’histoire et autour d’elle) devient le lieu du regnum hominis, mais là où elle se change en lieu juste et où elle s’épanouit, désaliénée, en tant que bien médiatisé. »
On peut discuter l’accent mis par Bloch sur la souveraineté humaine dans l’interaction avec la nature et la phraséologie constructiviste qui s’insinue dans sa lumineuse compréhension de la nature organique de cette interaction. Das Prinzip Hoffnung a été écrit au début des années quarante, à une époque sombre et assiégée où un tel canevas conceptuel restait totalement étranger à l’esprit anti-naturel, pour tout dire militariste, du moment. Auprès de sa clairvoyance, notre sagesse rétrospective fait pâle figure, saturée comme elle l’est du jargon écologique à la mode et de mysticisme doucereux. Quoi qu’il en soit, on a suffisamment décrit les différences entre nature et société. Cela vaudrait la peine aujourd’hui, avec Bloch, de déplacer l’accent vers les traits communs à la nature et à la société, à condition de prendre grand soin d’éviter ces sauts frivoles de l’une à l’autre, en faisant comme si elles n’étaient pas liées par les riches phases de développement qui sont les véritables traits d’union entre l’une et l’autre.
*
La spontanéité joue en écologie sociale un rôle assez analogue à celui qu’elle joue en écologie naturelle – elle est fonction de la diversité et de la complexité. Les écosystèmes sont beaucoup trop disparates pour pouvoir s’inscrire entièrement dans ce que Bloch appelait le regnum hominis ou, du moins, s’accorder à la revendication de l’humanité à la souveraineté sur la nature. Mais on peut à bon droit se demander si cela ne vaut pas également pour la complexité sociale face à la prétention de l’histoire à la souveraineté sur l’homme. Les soi-disant spécialistes et autres « gardiens » de la société en savent-ils assez long (au-delà des points de vue le plus souvent utilitaires qui sont les leurs) sur les facteurs qui régissent le développement social, pour pouvoir prétendre les contrôler ? Et même après qu’ait été découverte la « forme appropriée de la demeure humaine » et qu’on lui ait donné substance, jusqu’à quel point pouvons-nous être certains de leur désintéressement dans l’accomplissement de leur tâche ? La documentation historique abonde concernant les mécomptes commis par les chefs, les partis, les factions, les « gardiens » et les « avant-gardes ». Si la nature est « aveugle », la société l’est aussi dans la présomption de se connaître elle-même complètement, que ce soit sous la forme des sciences humaines, de la théorie sociale, de l’analyse des systèmes. Les « génies » de l’humanité, d’Alexandre le Grand à Lénine, ne l’ont certes pas toujours bien servie. Ils ont fait montre d’une arrogance capricieuse qui a fait autant de tort à l’environnement social que l’arrogance des hommes ordinaires a été désastreuse pour l’environnement naturel.
Les grandes périodes historiques de transition nous montrent qu’il faut laisser les flots montants du changement social trouver spontanément leur niveau. Les organisations d’avant-garde ont provoqué des catastrophes répétées chaque fois qu’elles ont cherché à forcer des changements que le peuple et les conditions du temps n’étaient pas en mesure de soutenir matériellement, idéologiquement ou moralement. Là où des changements sociaux provoqués ne s’alimentaient pas à une conscience populaire formée et informée, ils devaient finalement être imposés par la terreur – et les divers mouvements se sont sauvagement retournés contre leurs idéaux humanistes et libérateurs les plus chers et ont fini par les dévorer. Notre propre siècle s’achève dans l’ombre d’un événement qui a complètement obscurci l’avenir de l’humanité, à savoir la révolution russe et ses terrifiantes séquelles. Le moment précis où la révolution, aisément menée à bien par le mouvement populaire sans aucune contrainte, prend fin et cède le pas au coup d’État de Lénine d’octobre 1917, ce moment peut être facilement repéré et daté. Mais la façon dont une poignée d’hommes, encouragés par la démoralisation et la bêtise de leurs opposants, allaient transformer de par leur volonté le succès en échec au nom de ce même « succès », voilà qui est plus difficile à expliquer. Peut-être le jugement le plus sûr que l’on puisse porter, issu de la compréhension acquise avec le recul du temps, se serait-il assagi si l’on avait laissé jouer l’impulsion et l’autodétermination populaires spontanées – et il aurait peut-être bien abouti à des gains qui seraient venus renforcer un progrès social encore plus décisif à l’étranger. Les chefs dont les volontés supplantent les mouvements spontanés du peuple se révèlent en général les pires ennemis du changement social, et notamment de la révolution sociale. L’arrogance est aussi dangereuse dans l’évolution sociale que dans l’évolution naturelle, et pour les mêmes raisons. Dans les deux cas, la complexité d’une situation, les limites qu’imposent le temps et l’espace, et l’empreinte des préjugés dans ce qui n’est souvent qu’apparente clairvoyance, tout cela contribue à voiler la multitude des détails, plus vrais au regard de la réalité que n’importe laquelle des idées préconçues ou des exigences de l’idéologie.
Mon intention n’est pas de nier l’apport de la volonté, de la clairvoyance et de la connaissance qui doivent guider la spontanéité humaine dans la sphère sociale. Dans la nature, par contre, la spontanéité opère dans le cadre d’un ensemble plus restreint de conditions. Un écosystème parvient à son point culminant lorsqu’est atteint le plus haut degré de stabilité que permet le niveau donné de possibilités qui lui est propre. Bien entendu, nous savons qu’il ne s’agit pas là d’un processus passif. Mais au-delà de ce niveau et de la stabilité qu’il peut atteindre, rien dans un écosystème ne manifeste une motivation ou un choix. Étant donné ses potentialités et ce qu’Aristote appelait son entéléchie[16], cette stabilité est pour lui une fin en soi, de même que la fonction d’une ruche est de produire des abeilles. Un écosystème culminant équilibre pour un temps les interactions qui le sous-tendent. Au contraire, la sphère sociale fait naître la possibilité de la liberté et de la conscience de soi en tant que fonction surajoutée à la stabilité. La communauté humaine, quel que soit le niveau où elle atteint l’équilibre, reste incomplète tant qu’elle ne parvient pas à la volonté libre de toute entrave et à la conscience de soi, autrement dit à ce que nous appelons liberté – laquelle est, ajouterai-je, un état final qui n’est autre que le point de départ d’un nouveau commencement. À quel point la liberté humaine repose sur la stabilité de l’écosystème naturel dans lequel elle reste constamment insérée ; quelle est, dans une perspective philosophique plus large, son importance au-delà de la simple survie ; et quelles normes développe-t-elle à partir de son histoire commune avec le monde vivant dans son entier et de sa propre histoire : toutes ces questions font la matière des pages de ce livre.
*
Il nous faut maintenant tenter de transposer à la société le caractère non hiérarchique des écosystèmes naturels à partir de cet ensemble d’idées si complexe. L’écologie sociale tire toute son importance du fait qu’elle ne présente pas le moindre argument en faveur d’une quelconque hiérarchie dans la nature et la société ; elle remet en cause de façon décisive la notion même de hiérarchie comme principe stabilisateur ou ordonnateur dans l’un ou l’autre de ces domaines. La liaison de l’ordre en tant que tel à la hiérarchie se voit ainsi rompue. Et ce lien est rompu sans que le soit celui qui unit la nature et la société – comme la sociologie, dans son opposition bien intentionnée à la sociobiologie, inclinerait à le faire. À la différence des sociologues, nous ne sommes pas conduits à rendre la sphère sociale si parfaitement autonome par rapport à la nature qu’il nous faille rompre le continuum qui fait passer progressivement de la nature à la société. Bref, nous ne sommes contraints d’accepter ni le dogme grossier de la sociobiologie qui nous enchaîne brutalement à la nature, ni à l’opposé la doctrine naïve de la sociologie qui nous sépare abruptement d’elle. La hiérarchie existe dans la société actuelle, mais il n’est pas nécessaire qu’elle se perpétue – abstraction faite, par ailleurs, de son absence de sens ou de réalité dans la nature. Mais les arguments contre la hiérarchie ne sont pas liés au fait qu’il s’agirait d’un phénomène unique et social. C’est parce que la hiérarchie menace aujourd’hui l’existence de la vie sociale qu’elle ne peut pas continuer de constituer un fait social. Et c’est précisément parce qu’elle menace l’intégrité du monde organique qu’elle ne pourra continuer de le faire, en vertu de la sévère loi de la nature « aveugle et muette ».
La continuité qui s’établit entre nous et une nature non hiérarchique suggère qu’une société non hiérarchique n’est pas moins aléatoire qu’un écosystème. On n’a pas manqué de soutenir de façon convaincante que la liberté est beaucoup plus que l’absence de contrainte, et que la tradition anglo-américaine de simple pluralisme et d’hétérogénéité institutionnelle donne des résultats sensiblement plus pauvres qu’un écosystème social. En réalité, la démocratie, considérée comme l’apothéose de la liberté sociale, a été tellement dénaturée, comme le souligne Benjamin R. Barber[17], qu’elle a abouti « au remplacement progressif de la participation par la représentation. Alors que la démocratie dans sa forme classique signifiait assez littéralement gouvernement du demos, des gens eux-mêmes, elle semble souvent n’être plus guère qu’un gouvernement de l’élite sanctionné (au travers du procédé de la représentation) par le peuple. Des élites concurrentes se disputent le soutien d’un public dont la souveraineté populaire est réduite au pitoyable droit de choisir le tyran qui le gouvernera ».
De façon peut-être plus significative encore, la notion d’une sphère publique, d’un corps politique, s’est littéralement désincarnée, au profit d’une apparente hétérogénéité – plus précisément, d’une atomisation qui s’étend de l’institutionnel à l’individuel – qui a remplacé la cohérence politique par le chaos. Le remplacement de la vertu publique par les droits personnels a non seulement provoqué la subversion du principe éthique unificateur qui donnait jadis substance à la notion de public, mais aussi celle même de la personne, sur laquelle se fondait la notion du droit.
Reste à répondre à une question, vaste et fréquemment posée : dans quelle mesure la nature a-t-elle une réalité propre qu’il est possible d’évoquer légitimement ? En supposant que la nature existe vraiment, quelle connaissance du monde naturel pouvons-nous avoir qui ne soit pas exclusivement sociale ou, pour être encore plus restrictif, qui ne soit pas le produit de notre subjectivité ? Que la nature consiste en tout ce qui est non humain ou, dans un sens plus large, non social, c’est là une supposition qui ne s’enracine pas seulement dans le discours rationnel. Elle est au cœur de toute une théorie de la connaissance – d’une épistémologie qui fait très nettement la part de l’objectivité et de la subjectivité. Depuis la Renaissance, l’idée que la connaissance est enfermée dans un esprit que bornent des limitations et une faculté d’intelligence surnaturelles qui lui sont propres, cette idée a été la source de tous nos doutes au sujet de l’existence même d’une configuration cohérente qui puisse être appelée nature. Elle est aussi le fondement de tout un ensemble anti-naturaliste de théories épistémologiques.
À la prétention de l’épistémologie à se prononcer sur la validité de la connaissance de manière formelle et abstraite s’est toujours opposée celle de l’histoire, désireuse de traiter la connaissance comme un problème génétique. Selon ce point de vue historique, les processus mentaux n’ont pas de vie propre. L’apparente autonomie de leur construction du monde est en fait inséparable de la façon dont ils sont construits par le monde – monde qui possède une riche texture historique non seulement dans sa dimension sociale, mais également dans sa dimension naturelle. Je ne veux pas dire que la nature « connaît » des choses que nous ne connaissons pas, mais plutôt que nous sommes justement ce « connaître » de la nature, l’incarnation de l’évolution naturelle vers l’intellect, l’esprit et l’auto-réflexivité[18].
Dans l’univers abstrait de l’épistémologie de Descartes, de Locke ou de Kant, il est difficile de démontrer une telle proposition. Le sens de l’historicité fait totalement défaut à l’épistémologie de la Renaissance et de la période postérieure. Quand elle jette un regard rétrospectif sur l’histoire de l’esprit, c’est dans une perspective à tel point sociale, et à partir de niveaux historiques si éloignés de la genèse biologique de l’esprit, qu’elle est incapable d’établir un contact avec la nature. Son principal titre à la « modernité » est justement d’avoir fait disparaître un à un les points de contact entre la nature et l’esprit que la pensée grecque avait tenté de mettre en évidence. À cette liaison s’est substitué un dualisme insurmontable entre le monde mental et le monde extérieur. Chez Descartes, le dualisme s’instaure entre l’âme et le corps ; chez Locke, entre les sens percepteurs et le monde perçu ; chez Kant, entre l’esprit et la réalité extérieure. C’est ainsi que le problème de la dimension connaissante de la nature a été traditionnellement envisagé à partir d’une connaissance représentant l’aboutissement d’une longue histoire sociale, et non à partir de ses commencements. Quand au contraire on contemple cette histoire à partir de ses origines, le monde mental et la continuité qui le lie à la nature acquièrent une dimension radicalement différente. L’anthropologie physique de l’esprit, du cerveau humain, est-elle une véritable épistémologie, non le fatras culturel de l’histoire qui nous empêche de voir la genèse du cerveau dans la nature et de saisir son évolution au sein du monde social, conçue comme une exceptionnelle mise en œuvre de phénomènes naturels.
Dans le même ordre d’idées, je ne voudrais pas accorder à l’esprit une « souveraineté » qui de toute évidence lui fait défaut. La nature est un fécond kaléidoscope de transformations qui résiste à une catégorisation nette et précise. L’esprit peut saisir l’essence de ce changement, mais jamais l’ensemble de ses détails. Or c’est précisément dans les questions de détail que la présomption humaine se montre le plus vulnérable. Pour reprendre la pertinente métaphore de Charles Elton, disons que nous avons appris à naviguer dans les eaux profondes de ce monde naturel, mais non parmi les écueils innombrables et changeants qui rendent notre débarquement des plus précaires. C’est là où les détails de la ligne de côte prennent toute leur importance, et de façon si éloquente, que nous ferions bien de ne pas faire fi des courants dont nous savons par expérience qu’ils sont sûrs et qu’ils nous préserveront du naufrage.
En fin de compte, la connaissance organique est une mobilisation de l’intelligence en vue de connaître la nature de l’intérieur de la nature, sans qu’il s’agisse d’abandonner l’analyse au profit du mysticisme, ou la dialectique au profit de l’intuition. Notre pensée elle-même est un processus naturel, tout en étant profondément conditionnée par la société et finalement modelée par l’évolution sociale. Notre capacité à mettre en accord la pensée et son histoire organique (son évolution à partir des molécules organiques fortement réactives qui sont à la source de la sensibilité des molécules plus complexes, l’extravagante nébuleuse de formes de vie qui s’ensuit, et l’évolution du système nerveux) fait partie de la connaissance de ce « connaître », qui procure à la pensée un tissu organique aussi réel que le sont les instruments intellectuels que nous acquérons de la société. Bien plus que l’intuition ou la foi, la pensée est aussi réelle que la naissance ou la mort, que le moment où nous commençons à connaître et le moment où nous cessons de le faire. C’est ainsi que la nature habite l’épistémologie aussi sûrement qu’un parent habite un enfant. Ce que nous renions trop souvent comme phase intuitive de la connaissance est en fait la vérité que notre animalité octroie à notre humanité, et le stade embryonnaire de notre développement adulte. Lorsque la séparation vient à être consommée entre ces phases profondes de notre être et de notre pensée avec nos corps et nos esprits, nous ne faisons pas que réduire notre ambition épistémologique à des jugements kantiens fondés sur un dualisme abrupt entre pensée et nature ; nous détachons notre intellect de nous-mêmes, notre état d’esprit du développement de notre corps, notre intelligence immédiate de notre intelligence rétrospective, et notre entendement des lointaines sources de sa mémoire.
*
En termes plus concrets, quels enjeux l’écologie sociale propose-t-elle à notre époque et à notre avenir ? En multipliant les points de contact avec la nature, sera-t-il possible de parvenir à un nouvel équilibre, moyennant le délicat ajustement de nos pratiques agricoles, de nos zones urbaines et de nos technologies aux conditions naturelles d’une région et de ses écosystèmes ? Peut-on espérer « gérer » l’environnement naturel par une rigoureuse décentralisation de l’agriculture, qui permettrait de cultiver la terre comme s’il s’agissait d’un jardin dont une faune et une flore diversifiées maintiendraient l’équilibre ? Ces changements exigeront-ils la décentralisation de nos villes sous la forme de communautés de taille moyenne, créant ainsi un nouvel équilibre entre ville et campagne ? De quelle technologie aura-t-on besoin pour atteindre ces objectifs et éviter que se poursuive la pollution de la terre ? Quelles institutions seront nécessaires pour créer une nouvelle sphère publique, quels rapports sociaux devront s’instaurer pour que se développe une nouvelle sensibilité écologique, quels styles de travail rendront le labeur humain créatif et ludique, quelle taille et quelle population les communautés devront-elles avoir pour que la vie soit à l’échelle humaine et contrôlable par tous ? Quelle sorte de poésie appellera tout cela ?
Les questions concrètes – écologiques, sociales, politiques et de comportement – affluent tel un torrent, jusqu’ici contenu par les contraintes des idéologies et les habitudes de pensée traditionnelles.
Les réponses que nous apporterons à ces questions ont un rapport direct avec les chances de survie de l’humanité sur la planète. Les tendances de notre époque vont visiblement à l’encontre de la diversité écologique ; en réalité, elles vont en direction d’une brutale simplification de toute la biosphère. Les chaînes alimentaires du sol et de la surface terrestre sont soumises à une cruelle agression due à la sotte application de techniques industrielles dans l’agriculture ; en conséquence de quoi le sol, dans de nombreuses régions, est réduit au rôle d’éponge absorbant les substances chimiques « nutritives » simples. La monoculture pratiquée sur de vastes étendues de terres fait disparaître la variété naturelle, agricole, voire géographique. D’immenses ceintures urbaines ne cessent d’empiéter sur la campagne, remplaçant la faune et la flore par le béton, le métal et le verre, et enveloppant des régions entières dans un brouillard de pollutions atmosphériques. Dans cet univers urbain de masse, l’expérience humaine elle-même devient grossière et élémentaire, exposée à de violents stimuli sonores et en proie aux imbéciles manipulations bureaucratiques. La division nationale du travail, uniformisé selon les critères de la grande industrie, efface les variations régionales et locales, transformant des continents entiers en d’immenses usines fumantes et les villes en des supermarchés où tout n’est que tape-à-l’œil et matières plastiques.
La société moderne s’emploie ainsi à démanteler la complexité biotique qui était l’aboutissement de millénaires d’évolution organique. Le grand mouvement de la vie, à partir de formes vivantes et d’interactions relativement simples vers une complexité toujours plus grande, est en train d’être impitoyablement renversé pour aller dans le sens d’un environnement qui ne pourra plus supporter que des formes de vie extrêmement simples. La poursuite d’un tel renversement de l’évolution biologique, la destruction des chaînes alimentaires biotiques dont l’humanité dépend pour ses moyens d’existence, mettent en cause la survie même de l’espèce humaine. Si le renversement du processus évolutif se poursuit, il y a de bonnes raisons de croire – abstraction faite du contrôle d’autres agents toxiques – que les conditions préalables à l’existence de formes de vie complexes seront irréparablement détruites et que la terre sera incapable de nous maintenir en tant qu’espèce viable.
Devant cette confluence de la crise sociale et de la crise écologique, nous ne pouvons plus nous permettre de manquer d’imagination ; nous ne pouvons plus nous permettre de négliger la pensée utopique. Ces crises sont trop graves et les diverses possibilités ont une trop vaste portée pour qu’elles puissent être résolues en faisant appel aux modes de pensée habituels – en particulier, en s’appuyant sur les mentalités qui sont précisément celles qui ont provoqué ces crises. Il y a quelques années, lors de la révolte de mai et juin 1968, les étudiants français ont magnifiquement exprimé cette alternative : « Soyons réalistes, demandons l’impossible ! » À cette exigence, la génération qui va être confrontée au prochain siècle peut ajouter une injonction plus solennelle : « Si nous ne réalisons pas l’impossible, nous devrons faire face à l’impensable ! »
*
Dans les légendes nordiques, Odin, pour acquérir la sagesse, boit à la fontaine magique dont se nourrit l’Arbre cosmique. Mais le dieu doit la payer d’un de ses yeux. Le symbolisme est clair : Odin doit verser une rançon pour acquérir la clairvoyance qui lui donnera un moyen de contrôle sur le monde naturel et en rompra la prime harmonie. Mais sa « sagesse » est celle d’un borgne. Bien qu’il voie le monde de façon plus précise, sa vision est unilatérale. La « sagesse » d’Odin implique la renonciation, non seulement au lien primordial avec la nature, mais aussi à l’honnêteté d’une perception en accord avec l’unité primitive de la nature. La vérité devient exacte, prévisible et, surtout, manipulable ; elle devient science, au sens ordinaire du terme. Mais la science telle que nous la connaissons aujourd’hui est la vision fragmentaire et unilatérale d’un dieu borgne, dont l’avantage conduit à la domination et à l’antagonisme, non à l’égalité et à l’harmonie. Dans les légendes nordiques, cette sagesse mène au Ragnarok, à la chute des dieux et à la destruction du monde tribal. De nos jours, cette sagesse borgne est lourde des menaces de l’holocauste nucléaire et de la catastrophe écologique.
L’humanité a traversé une longue histoire de vision unilatérale et d’une condition sociale qui a toujours renfermé un potentiel de destruction, malgré ses réussites créatives en matière de technologie. Ouvrir l’autre œil, voilà en quoi doit consister le grand projet de notre temps : voir de tous côtés, combler et dépasser la distance qu’a mise l’ancienne sagesse entre l’humanité et la nature. Et nous ne devons pas non plus nourrir l’illusion que l’œil réouvert sera amené à se fixer sur les visions et les mythes des peuples primordiaux, car l’histoire n’a pas cessé d’œuvrer pendant des milliers d’années et a produit des domaines de réalité entièrement nouveaux et qui font partie intégrante de notre être humain. Notre capacité à être libres – qui comprend notre capacité à l’individualité, à l’expérience, et au désir – est plus profondément enracinée en nous que celle de nos lointains aïeux. Nous avons constitué une base matérielle plus large pour le temps libre, le jeu, la sécurité, la perception et la sensualité – une potentialité matérielle pour de plus vastes domaines de liberté et d’humanité – que celle à laquelle pouvait prétendre vraiment une humanité en lien primordial avec la nature.
Mais nous ne pouvons-nous défaire de nos liens si nous ne les connaissons pas. Quelque inconsciente que soit son influence, un héritage de domination imprime sa marque à notre pensée, à nos valeurs, à nos émotions et jusqu’à notre musculature. L’histoire domine chacun de nous d’autant plus fermement que nous restons dans l’ignorance à son sujet. Il s’agit de prendre conscience de l’inconscient historique. Tranchant avec cet héritage de domination, il en est un autre : celui de la liberté, qui vit dans les rêves de l’humanité, dans les grands idéaux et mouvements – rebelles, anarchiques, dionysiaques – qui ont surgi à toutes les grandes époques de transition. De nos jours, ces deux héritages s’enchevêtrent et corrompent les modèles clairs qui existaient dans le passé, au point que le langage de la liberté devient interchangeable avec celui de la domination. Cette confusion a modelé le tragique destin du socialisme moderne, doctrine maintenant exsangue de tous ses idéaux généreux. Il faut donc disséquer le passé afin de l’exorciser et d’acquérir une nouvelle vision intègre. Nous devons réexaminer les clivages qui ont séparé l’humanité de la nature, et les ruptures au sein de la communauté humaine qui ont originellement provoqué cette séparation, si l’on veut que le concept de totalité devienne intelligible et que l’œil réouvert surprenne l’image de la liberté renaissante.
[1] Régis Boyer, Anthologie de la poésie nordique ancienne, Paris, 1964.
[2] J’emploie ici le mot « homme » à dessein. Très exactement, la rupture entre humanité et nature est l’œuvre des mâles qui, souvenons-nous des mots admirables de Theodor Adomo et Max Horkheimer, « pendant des millénaires ont rêvé de dominer la nature, de transformer le cosmos en un immense territoire de chasse » (la Dialectique de la raison, Paris, 1974, p. 271). À la formule « immense territoire de chasse », je serais tenté de préférer celle d’« immense abattoir » pour décrire la « civilisation » à dominante virile de notre époque
[3] G. F. Hegel, Phénoménologie de l’esprit.
[4] E. A. Gutkind, Community and Environement, New York, 1954.
[5] Le terme écosystème – ou système écologique – est souvent utilisé de façon assez vague dans de nombreux travaux sur l’écologie. Je l’emploie ici, comme le fait l’écologie naturelle, pour désigner une communauté d’animaux et de plantes aisément délimitable, ainsi que les facteurs abiotiques, ou non vivants, nécessaires à sa subsistance. J’emploie aussi le terme en écologie sociale, désignant alors telle ou telle communauté humaine et naturelle particulière, et les facteurs sociaux et biologiques dont les interrelations forment la base d’une communauté écologiquement complète et équilibrée.
[6] Charles Elton, The Ecology of Invasions by Animals and Plants, New York, 1958.
[7] Alison Jolly, The Evolution of Primate Behavior, New York, 1972.
[8] Elise Boulding, The Underside of History: A View of Women through Time, Boulder, 1976.
[9] Il est important ici de bien faire la distinction entre les mots communauté et société. Les animaux, et aussi les plantes, forment assurément des communautés ; les écosystèmes n’auraient aucune signification si l’on ne se représentait les animaux, les plantes et le substrat abiotique sous la forme d’un réseau de relations, allant du niveau interspécifique au niveau interspécifique. Dans leurs interactions, les différentes formes de vie se comportent donc « communautairement », en ce sens qu’elles sont interdépendantes d’une manière ou d’une autre. Chez certaines espèces, en particulier chez les primates, ces liens d’interdépendance forment un réseau si serré qu’il s’apparente à une société, ou du moins à une forme rudimentaire de socialité. Mais une société, aussi profondément enracinée dans la nature qu’elle soit, n’en est pas moins autre chose qu’une communauté. Ce qui donne aux sociétés humaines des caractéristiques uniques parmi toutes les communautés, c’est que ce sont des communautés institutionnalisées, fortement et souvent rigidement structurées autour de formes explicites de responsabilité, d’assoc
