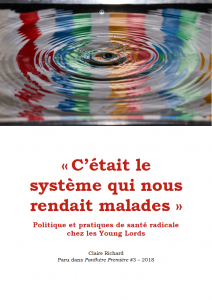Lien vers la brochure en pdf : C’était le système qui nous rendait malades
Lire le texte sur le site de Panthère Première
Texte de la brochure :
Dans les années 1970 aux États-Unis, le mouvement révolutionnaire des Young Lords investit le champ de la santé, révélateur par excellence des inégalités sociales et raciales. De dépistage sauvage en occupations de services hospitaliers, cet équivalent latino des Black Panthers développe une conception communautaire du soin tout en faisant fléchir les politiques publiques.
*
Juillet 1970, South Bronx, New York, 5 h 30 du matin. L’hôpital Lincoln fonctionne au ralenti. Soudain, un camion entre et se gare devant la Nurse’s Residence, un bâtiment administratif. Les portes arrière s’ouvrent et des dizaines de jeunes gens en descendent. Ils et elles ne portent pas de blouses blanches : ce sont des militant·es des Young Lords, un mouvement « nationaliste révolutionnaire » portoricain inspiré des Black Panthers. Sont venu·es avec elleux quelques travailleur·euses de santé et internes engagé·es. Très vite, sans rencontrer d’obstacles, elles et ils prennent le contrôle du bâtiment. Quelques heures plus tard, une conférence de presse est organisée pour annoncer la nouvelle : les Young Lords, un parti ayant moins d’un an d’existence, occupe l’un des principaux hôpitaux du Bronx[1].
Aux origines de l’occupation, il y a la mort d’une patiente portoricaine, admise pour un avortement et décédée des suites d’une erreur médicale. Elle n’est pas la première : dans le quartier, Lincoln est surnommé « the butcher’s shop », « la boucherie ». Cet ancien hôpital pour esclaves construit au xixe siècle est si vétuste que la mairie a ordonné sa démolition vingt-cinq ans auparavant. Les pannes de climatisation sont fréquentes, les heures d’attente aux urgences interminables et il n’est pas rare qu’on y voie courir des rats.
Aux yeux des Young Lords, Lincoln incarne les pires dysfonctionnements du système de soin en régime capitaliste : une santé à deux vitesses, qui reflète et décuple les inégalités existantes, économiques et raciales. Cela fait des mois que les Young Lords militent au sein de Lincoln avec des travailleur·euses hospitalier·es et quelques internes politisé·es. Mais l’occupation est une façon de frapper un grand coup et de diffuser largement leurs revendications : arrêt des coupes budgétaires et maintien des emplois, construction d’un nouvel hôpital, mise en place de soins préventifs en porte à porte adaptés à la communauté[2], possibilité pour elle d’exercer un « contrôle plus grand » (greater control) dans l’administration de l’hôpital. Pendant que se déroulent les négociations avec cette dernière, des membres du parti organisent une crèche, installent une table pour recueillir les plaintes des patient·es.
L’occupation proprement dite dure moins de vingt-quatre heures : la police encercle l’hôpital, qui est évacué sans encombre, en échange de l’amnistie pour les participant·es. Elle n’entraînera pas la réorganisation profonde espérée, mais elle attire l’attention des médias et devient un symbole de ce que les Young Lords défendent et pratiquent : la santé n’est pas le domaine réservé des experts et des médecins issus des classes dominantes, c’est une question politique qui doit appartenir au peuple.
« Servir le peuple »
Qui sont alors les Young Lords ? Ils et elles se définissent comme des « nationalistes révolutionnaires » et luttent pour l’indépendance de Porto Rico autant que pour l’amélioration des conditions de vie de leur « peuple ». Référence constante de leur discours et socle de leur légitimité, ce terme désigne pour elleux autant les Portoricain·es que les habitant·es des quartiers pauvres où elles et ils vivent, parmi lesquel·les des Africain·es-Américain·es ou des Latinos et Latinas d’autres origines.
La communauté portoricaine est alors la communauté latino la plus importante de la côte est. Porto Rico vit sous domination américaine depuis le xixe siècle, et ses ressortissant·es ont un statut à part : ils et elles possèdent la nationalité américaine depuis 1917 mais jouissent d’une citoyenneté restreinte (en ne votant pas aux élections présidentielles, par exemple). Dans les années 1940, face à la pauvreté endémique, beaucoup ont quitté l’île pour aller chercher du travail et de meilleures conditions de vie aux États-Unis. Mais là-bas, sur le « mainland », elles et ils ont découvert une société raciste qui les considère comme des étranger·es, des spics[3]. Dans l’imaginaire américain dominant, les Portoricains sont soit de dangereux criminels affiliés à des gangs, soit des ouvriers corvéables, dociles et bon marché. La plupart vivent dans des quartiers pauvres et insalubres, aux côtés d’autres communautés discriminées. C’est dans ces ghettos qu’ont grandi les Young Lords et leur mode d’action sera profondément influencé par cette expérience précoce et intime de la pauvreté. Car s’ils et elles disent s’inspirer autant du nationalisme portoricain, du nationalisme noir, du maoïsme et du guévarisme, les Young Lords préfèrent de loin les actions aux discours, et ont repris à leur compte la devise des Black Panthers : « Serve the People », servir le peuple. Et c’est leur insistance à répondre aux problèmes concrets et urgents de leur communauté qui va les conduire rapidement à développer un efficace militantisme de santé.
De fait, il y a urgence. Dans El Barrio, le quartier de Spanish Harlem où les Young Lords sont installé·es, ainsi que dans le Sud du Bronx tout proche, les conditions sanitaires sont catastrophiques. Les habitant·es s’entassent dans des logements exigus et vétustes, les poubelles s’amoncellent dans les rues, les rats pullulent. Cleo Silvers, membre des Lords et des Black Panthers, se souvient en ces termes de son arrivée dans le quartier : « Je venais des banlieues de Philadelphie, en Pennsylvanie, et je n’avais jamais vu des conditions de vie aussi atroces. Les logements, les questions environnementales… Le taux de mortalité infantile était terrifiant. Le degré d’exposition au plomb était incroyable, il y avait d’énormes problèmes de saturnisme mais personne ne faisait rien pour régler le problème. Il y avait de la tuberculose. Des gens se faisaient tirer dessus. Il y avait de nombreux problèmes de santé mentale. Les conditions sanitaires étaient celles d’un pays du tiers-monde. » Comme le souligne Silvers, les habitant·es souffrent de « maladies de la pauvreté », liées à l’environnement, dont le saturnisme est l’archétype. Cette maladie est une intoxication par le plomb. Elle est souvent acquise par ingestion ou inhalation de la substance présente dans les tuyauteries vétustes et les peintures de mauvaise qualité, dont les écailles sont mangées par les enfants. Le saturnisme peut entraîner des comas ou la mort chez les plus jeunes, et provoque de nombreux troubles du développement (troubles du comportement, difficultés de concentration, agressivité etc.).
Il existe bien des hôpitaux dans le quartier, mais les conditions d’accueil et de soin y sont largement déficientes et souvent déplorables. À Lincoln, des médecins notent qu’on trouve plus de plomb dans les peintures que dans les os des enfants qui y sont traités pour saturnisme. Beaucoup d’entre eux ne parlent pas espagnol et de nombreux patients pauvres se sentent méprisés. Ainsi, en 1970, Gloria Gonzalez, ancienne travailleuse hospitalière devenue responsable de la santé chez les Lords, décrit avec fureur comment, pendant son propre accouchement, elle a découvert en salle de travail qu’elle serait observée par une dizaine d’internes – tous blancs. Personne n’avait songé à la prévenir, encore moins à lui demander son avis. De façon générale, écrit-elle alors, « chez nous, quand les gens tombent malades et sont forcés d’aller à l’hôpital, ils doivent attendre des heures avant de pouvoir consulter un médecin. Quand ils y arrivent enfin, celui-ci se donne rarement la peine de leur expliquer de quoi ils souffrent. Les gens prennent leurs médicaments sans savoir à quoi ils servent : est-ce pour les douleurs d’estomac pour lesquelles ils sont venus consulter, ou pour leurs nerfs ? Beaucoup de gens sont diagnostiqués “névrosés” et traités pour cela, sans que leurs souffrances physiques ne soient jamais prises en compte. Ce genre de négligences médicales peut durer des années ». Ce n’est pas un hasard si les travailleur·euses hospitalier·es, dont beaucoup sont afro-américain·es ou portoricain·es, seront nombreux·euses parmi les Lords. Car celleux-là sont aux premières loges pour observer les ravages, sur les corps et les intimités, de la discrimination. Comme le dira Cleo Silvers : « Franchement, je crois que c’est juste ça, ce qui m’a radicalisée : de voir les conditions atroces dans lesquelles ces gens vivaient, et de réfléchir à ce qui pourrait être fait, collectivement, pour changer les choses. »
Les Young Lords et le mouvement
de santé radical
D’un point de vue militant, la santé présente un autre avantage : c’est un domaine qui peut servir de prisme pour aborder de façon très terre à terre des questions systémiques plus larges. « C’était une réalité, quelque chose de concret, qui avait du sens pour les gens. Nous pouvions montrer comment leurs problèmes de santé étaient le produit d’un système cupide et raciste. Nous ne méritions pas nos maladies, nous n’étions ni bêtes ni irresponsables, c’était le système qui nous rendait malades ! La santé, comprise ainsi, permettait aussi de parler d’alimentation et d’environnement – qui sont des thèmes habituellement difficiles à aborder dans le milieu militant. Si vous essayez d’en parler aux gens dans la rue, personne ne va s’arrêter. Mais si vous leur démontrez que tout est lié, que les enfants qui ont faim mangent du poison parce qu’ils avalent la peinture qui tombe des murs, et que c’est ça qui les rend malades, affecte leur cerveau puis leur comportement et leurs résultats scolaires… là, ils commencent à vous écouter », explique Pablo Guzmán, un des membres fondateurs des Young Lords.
Cette conception de la santé comme objet politique et incarnation d’oppressions plus larges n’est pas propre aux Young Lords. Dans les années 1960 et 1970, elle est partagée par un certain nombre de militant·es, qui forment ce que la chercheuse Alondra Nelson appelle le radical health movement[4], le mouvement de santé radical. Plus que d’un « mouvement » structuré, il s’agit d’une constellation de groupes, collectifs, associations, etc. venant d’horizons très divers et aux buts souvent distincts : hippies, féministes, nationalistes noir·es, membres de la Nouvelle Gauche[5], etc. Si différents soient-ils, ces groupes partagent une même approche de la
santé : celle-ci ne se résume pas au bon fonctionnement d’un corps, mais constitue un objet politique qui traduit un système plus profond d’oppression et de discriminations et où s’exercent de nombreuses dominations, économiques et symboliques. Le diagnostic d’une « crise de la santé » n’est pas propre à la gauche : il revient régulièrement dans le discours public des années soixante, qui s’inquiète de la piètre qualité de soins, de la multiplication des assurances privées et de la fragmentation de l’offre sanitaire. Mais le mouvement de santé radical accuse précisément la marchandisation du secteur de la santé, sa transformation en une puissante industrie et sa privatisation croissante. Ainsi, à New York, face à la crise des hôpitaux publics, la mairie a incité certains d’entre eux à « s’affilier » à des hôpitaux privés qui prennent alors en charge la gestion de certains de leurs départements. Les militant·es de la santé y voient un arrangement inégal qui ne profite qu’aux cliniques privées et creuse encore l’écart avec les infrastructures publiques. Ainsi, pour toute une frange de militant·es, la lutte contre le « système » passe aussi par la prise en main des pratiques de santé.
Avec l’aide de médecins ou de personnels de santé radicaux, qui partagent leurs idées sur l’importance de la participation des non-professionnel·les et des patient·es aux soins (patient empowerment), les militant·es développent des lieux de santé et des pratiques médicales alternatives. À San Francisco, la Haight-Ashbury Free Clinic ou encore la Berkeley Free Clinic sont des « centres de santé de rue » (street clinics ou health clinics) gratuits et ouverts à tout le monde, pensés pour les habitant·es marginaux·ales ou discriminé·es qui peuplent alors la ville (soins en addictologie, soins à domicile pour les Noir·es ou les Latinos et Latinas qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer dans les structures officielles). Les militant·es apprennent à pratiquer elleux-mêmes certains gestes : dépistages, prises de sang, examens gynécologiques voire avortements dans certaines cliniques de santé féministes. Ils et elles encouragent les patient·es à faire entendre leurs voix, à intervenir dans le processus de soin et, dans certains cas, à remettre en question l’expertise médicale (comme le font les féministes adeptes du self-help, groupes d’entraides autour du soin).
Pour les Young Lords, c’est le Black Panther Party (BPP) qui sera le modèle le plus immédiat. Dès ses débuts, le BPP a fait de la santé une de ses priorités[6]. Dans les quartiers où ils et elles sont implanté·es, les Black Panthers organisent des programmes de petits-déjeuners gratuits destinés aux enfants pauvres et ouvrent des health clinics, des centres de soin communautaires qui fonctionnent à la fois comme dispensaires et centres d’aide sociale et d’éducation politique. Ces cliniques sont tenues par des militant·es, avec l’aide d’« experts allié·es », c’est-à-dire de professionnel·les de la médecine qui soutiennent l’action des Panthers. Car l’activisme dans ce domaine implique un certain transfert de connaissances qui ne peut se faire sans alliances, à un moment ou à un autre du processus, avec des professionnel·les (que ce soit pour l’accès aux pratiques, aux équipements, aux connaissances, etc.). À Los Angeles, par exemple, les militant·es travaillent avec des médecins et des vétérans, qui leur apprennent des techniques de médecine de guerre. Selon les mots d’une militante d’alors, « dans cette clinique, on avait des médecins supers, très ouverts d’esprits, qui ne considéraient pas la médecine comme une chose sacrée, que personne d’autre qu’eux ne pourrait apprendre… En médecine, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas si compliquées »[7].
L’action directe contre le saturnisme
et la tuberculose
Dès leurs premiers mois d’existence, les Young Lords mettent en place des « programmes de survie » inspirés de ceux des Panthers : petits-déjeuners pour les enfants, distribution de vêtements et de nourriture – le tout gratuit, reposant sur les dons de la communauté. Mais très vite, à l’initiative de Juan González qui multiplie les rencontres et les alliances avec des travailleur·euses hospitalier·eres et des figures du mouvement de santé radical, ils et elles se lancent dans des actions de plus grande envergure.
Dès l’automne 1969, les Young Lords commencent des actions de dépistage gratuit du saturnisme. Dans un des hôpitaux, des étudiant·es en médecine « très politisé·es et radicaux·ales » soupçonnent l’existence d’une épidémie. Elles et ils contactent les Young Lords pour leur proposer de mener ensemble des opérations de dépistage en porte- à-porte. Les étudiant·es apprendront aux militant·es à utiliser les seringues. En retour, ces dernier·es leur permettront d’accéder à la communauté dont ils et elles ont la confiance. « Nous travaillions collectivement, en petits groupes, avec un médecin, un ou une infirmier·e, un membre de la communauté et un Lord ou une Panthère. Les docteurs nous apprenaient à utiliser les équipements », détaille Cleo Silvers. Fitzhugh Mullan était alors interne en médecine dans le quartier : « L’idée était de travailler avec la communauté. Nous les formions, nous leur apprenions des techniques, et eux, qui connaissaient le quartier bien mieux que nous, nous disaient où aller, où installer nos équipements. » Les militant·es diffusent des tracts qui annoncent l’opération et les jours de passage, et organisent un sit-in à la mairie pour obtenir plus de kits de dépistage. Un journaliste militant du Village Voice, un magazine contre-culturel gratuit largement diffusé à New York, qui avait enquêté sur la mort d’un enfant de deux ans atteint de saturnisme dans El Barrio, publicise leur action et déclare qu’ils et elles font le travail de la mairie, qui devrait assurer elle-même la prévention. Cela tombe bien : la nouvelle chargée de la santé pour la ville, Mary MacLaughlin, est sensible au problème de l’intoxication au plomb, qu’elle a étudié en tant que médecin. Elle s’appuie sur le scandale créé par les Young Lords pour faire modifier le New York City Code – la substance est désormais interdite dans les peintures et les propriétaires qui ne remplacent pas les peintures dangereuses peuvent être puni·es. En 1970, un Bureau de contrôle du saturnisme est mis en place. Cette campagne reste une des victoires les plus durables des Young Lords. Elle souligne aussi une dimension importante de leur activisme de santé : celui-ci ne vise pas à remplacer toutes les infrastructures de santé (leurs moyens seraient insuffisants), mais à proposer des modèles de soins alternatifs et à faire pression sur les pouvoirs publics pour transformer le système de soins inégalitaire, en pratiquant l’action directe et en utilisant habilement les médias.
Les Lords vont ainsi employer une stratégie similaire pour lutter contre la tuberculose. Les rares cliniques qui offrent des dépistages sont situées loin du quartier et peu d’habitant·es peuvent se permettre de perdre de précieuses heures de travail pour s’y rendre. « Comme il était quasiment impossible de convaincre les gens d’y aller, nous avons décidé d’amener la clinique à eux », explique Micky Melendez, ancien Lord. « Un peu partout dans la ville, des médecins progressistes nous ont donné des tests Mantoux (des tests cutanés tuberculiniques par injection) et nous ont appris à les faire. Sans eux, nous n’aurions pas pu convaincre les gens du quartier de se faire dépister et de sauver leur propre vie. » Parmi les Lords, les anciens héroïnomanes se révèlent particulièrement doués pour faire des piqûres indolores aux bébés. Les Lords déclareront au New York Times avoir testé plus de 900 personnes entre mai et juin 1970. Mais le diagnostic cutané doit être complété par une radio. De nouveau, le problème de l’accessibilité des infrastructures se pose : la mairie de New York possède un camion de radiologie itinérant, mais il passe rarement dans El Barrio, et toujours pendant les horaires de travail des habitant·es. Devant le refus de la mairie de modifier ces créneaux, les Lords décident de détourner le camion – d’autant que celui-ci reste stationné de longues heures dans un quartier tout proche, où vivent majoritairement des classes moyennes et où le taux de tuberculose est nettement moins élevé.
Le 17 juin 1970, deux Young Lords déguisés en infirmiers s’approchent du camion et s’en emparent pour le conduire quelques rues plus loin, dans El Barrio. L’un des deux a grimpé à l’arrière avec les deux opérateurs radio, deux hommes blancs d’une cinquantaine d’années, et leur explique qu’ils pourront partir dès que le camion sera garé à destination, qu’il ne leur sera fait aucun mal mais qu’ils sont les bienvenus s’ils désirent continuer à travailler là-bas. Dans El Barrio, une foule d’habitant·es et de journalistes prévenu·es à l’avance attend le camion, aux fenêtres duquel flottent de petits drapeaux portoricains. Les opérateurs décident de rester et réalisent des radios pour les habitants qui font la queue. Face à ce nouveau scandale, la mairie accepte de laisser le camion stationné dans El Barrio et de payer les heures supplémentaires des opérateurs. Dans Palante, le journal du parti, on peut lire : « Le camion de radiologie gratuite Ramon Emeterio Betances [du nom d’une des principales figures du mouvement nationaliste portoricain, qui était aussi médecin] est maintenant aux mains du peuple. Il sera dans les rues 7 jours par semaine, 10 heures par jour. Ce camion est là pour servir les besoins de notre peuple. TOUT LE POUVOIR AU PEUPLE ! SANTÉ GRATUITE POUR TOUT LE MONDE ! LIBERTÉ POUR PORTO-RICO ! »
La gratuité des soins constitue en effet une des revendications principales des Young Lords. En janvier 1970, sous l’influence de plusieurs travailleur·euses hospitalier·es qui les rejoignent, les Lords se sont doté·es d’un programme de santé en dix points, dans lequel figurent notamment : l’autodétermination complète pour tous les services de santé d’East Harlem, par le biais d’un conseil d’administration composé d’employé·es issu·es de la communauté, la gratuité de l’accès à la prévention et aux soins, la mise en place, dans chaque block (pâté de maison), de référent·es de santé, des services de prévention sanitaire travaillant en faisant du porte-à-porte et abordant des sujets aussi divers que « les contrôles environnementaux et sanitaires, la nutrition, la toxicomanie, les soins maternels et infantiles et les soins aux personnes âgées».
Le Lincoln People Detox Center :
la désintoxication politique
Cette pratique de la santé qui met l’accent sur la participation de la communauté à l’élaboration et à la réalisation des soins va trouver sa plus belle réalisation dans une expérience peu connue : celle du Lincoln People Detox Center, le « Centre de désintoxication populaire de Lincoln ».
L’occupation de Lincoln, si brève a-t-elle été, a donné lieu à plusieurs rencontres déterminantes. Des Young Lords ont discuté avec d’autres militant·es de la santé actif·ves dans le quartier. Tou·tes partagent un même diagnostic : El Barrio et le Bronx manquent cruellement d’infrastructures pour lutter contre la toxicomanie, en particulier l’addiction à l’héroïne. Peu chère, facilement accessible, cette drogue ravage les quartiers pauvres de New York : elle tourne dans les lycées et il n’est pas rare de trouver des mort·es d’overdose âgé·es de 12 à 19 ans. La lutte contre la toxicomanie est présente dès les débuts des Young Lords, qui connaissent intimement le problème : ils et elles ont grandi dans ces quartiers, ont des proches qui sont mort·es d’overdose et comptent parmi leurs membres plusieurs ancien·nes toxicomanes. Les « règles de discipline » qui organisent strictement la vie des membres interdisent l’usage de drogues douces pendant la journée de travail militant, et tout usage de drogue dure : l’injection d’héroïne entraîne immédiatement l’exclusion du parti. Les Lords aident ceux qui veulent décrocher, lors de sessions de « désintoxications sauvages » au cours desquelles elles et ils veillent de leur mieux sur le membre qui décroche, se relayant à son chevet durant le temps du sevrage. Mais après Lincoln, plusieurs militant·es décident de passer à la vitesse supérieure. En novembre 1970, avec une coalition antidrogue du sud du Bronx, les Young Lords occupent de nouveau le bâtiment des infirmières de Lincoln, cette fois pour y créer un service de désintoxication. Les militant·es sont soutenu·es par plusieurs médecins et infirmier·es et l’administration finit par leur allouer quelques fonds. Vicente Panamá Alba, ancien Young Lord qui y fut très actif, se souvient : « Des centaines et des centaines de gens venaient nous voir, à mesure que la rumeur se répandait qu’il existait un endroit où l’on pouvait aller sans rendez-vous et être aidé efficacement par des gens ordinaires et généreux – des gens comme eux, pas des professionnels blancs – qui cherchaient aussi à comprendre ce que recouvrait la toxicomanie. »
Le centre est géré par des militant·es avec des infirmiers et des infirmières, des médecins et de nombreux et nombreuses bénévoles, parmi lesquel·les beaucoup d’ancien·nes patient·es. La cure comporte deux aspects : le traitement de l’addiction physiologique, avec des prescriptions de méthadone utilisée comme produit de substitution à l’héroïne, et des discussions politiques qui visent à produire une pensée critique de la toxicomanie. « Pour nous, l’addiction d’un individu était bien plus qu’un simple problème physique, c’était aussi un problème psychologique. Si la toxicomanie touchait particulièrement notre communauté, ce n’était pas parce que nous étions psychologiquement déficients, mais à cause de l’oppression et de la violence de nos conditions de vie, qui nous poussaient vers la drogue », explique Alba. La désintoxication passe ainsi par l’exploration, collective, des facteurs politiques de l’addiction. « Nous organisions des sessions en groupe, avec des participants presque uniquement noirs et portoricains, et nous lancions la conversation sur ce que ça faisait d’être noir ou portoricain, de se faire traiter de spic sans même savoir ce qu’était Porto Rico. Les effets du colonialisme et la façon dont on traite les Portoricains sur le continent sont mal connus parce qu’ils sont intériorisés. Mais il faut commencer par là. Nous demandions : Comment vivez-vous le fait que votre famille soit trop pauvre pour s’occuper de vous ? Pourquoi la police vous hait-elle ? Pourquoi l’école vous hait-elle ? Je suis allé à l’école publique, je ne parlais pas anglais en CM2, on m’a mis dans une classe pour “retardés mentaux”. Certaines personnes reçoivent de l’aide, mais pas moi. Quand les institutions d’une société nous traitent comme ça, quel est le résultat ? Qu’est-ce qui arrive à quelqu’un qui vit dans ces conditions, qui se fait battre par la police, qui se fait traiter de “sale spic”, dont la demande d’amitié est rejetée si l’autre personne est blanche et lui de couleur ? Toutes ces conditions d’existence finissent par avoir un impact cumulatif et nous parlions longuement de tout ça. »
Affaibli par des problèmes de gestion et des fraudes, ainsi que le meurtre non résolu d’un des docteurs de l’équipe, le centre fermera ses portes en 1978. Malgré cette fin en demi-teinte, il reste l’un des plus beaux exemples de santé communautaire de la période.
Dépistages sauvages, occupations et détournements d’équipements médicaux : la santé demeure l’un des domaines où les Young Lords ont été les plus efficaces et les plus novateur·ices. Leurs actions incarnent une conception politique de la santé qui n’a rien perdu de sa pertinence. Comme les féministes qui apprenaient à pratiquer des avortements, comme les Black Panthers qui organisaient des campagnes de dépistage de la drépanocytose, les Young Lords ont attiré l’attention sur le fait qu’une politique de la santé n’était jamais neutre et engageait toujours une certaine vision du corps et du savoir que l’action collective pouvait transformer. Après la dissolution des Young Lords, en 1976, beaucoup d’ancien·nes activistes continueront d’ailleurs leur vie militante dans le secteur de la santé publique, ou dans la lutte contre le sida – une lutte où les approches communautaires, conçues par et pour les malades, seront centrales pour organiser la survie et le soin face au déni des pouvoirs publics.
[1] Cet article est tiré du chapitre consacré à la santé de mon ouvrage Young Lords, Histoire des Black Panthers latinos 1969-1976 (éd. L’Échappée), 2017, écrit à partir d’entretiens menés avec d’ancien·nes Young Lords et de recherches d’archives. On peut s’y référer pour la provenance exacte des citations figurant dans l’article, ainsi que toute information supplémentaire.
[2] Ce terme, central dans la pensée et l’action des Young Lords, désigne selon les contextes les Portoricain·es opprimé·es ou les habitant·es pauvres des quartiers où ils et elles luttent, quelle que soit leur appartenance. Pour simplifier, on pourrait dire que ce sont les gens qu’elle et ils veulent aider et le groupe auquel ils et elles se sentent appartenir.
[3] Terme injurieux pour désigner les Hispaniques et notamment les Portoricain·es.
[4] Voir Alondra Nelson, Body and Soul : the Black Panther Party and the Fight Against Medical Discrimination, University of Minnesota Press, 2011.
[5] « New Left », ensemble de mouvements de gauche et d’extrême-gauche rejetant la « vieille » gauche marxiste et influencée par les valeurs et luttes de la contre-culture : contre l’aliénation, l’autorité, la guerre du Vietnam par exemple.
[6] Comme l’a montré brillamment Alondra Nelson dans son ouvrage Body and Soul, op. cit.
[7] Bryan Shih, Yohuru Williams, The Black Panthers, Portraits From an Unfinished Revolution, Hachette UK, 2016.