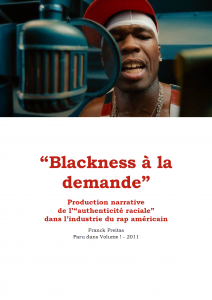Le texte sur le site de la revue Volume !
La brochure en pdf page par page : Blackness à la demande
La brochure en pdf en livret : Blackness à la demande_livret
« Les industries culturelles ont en effet le pouvoir de réélaborer et de refaçonner ce qu’elles représentent et, à force de répétition et de sélection, d’imposer et d’implanter des définitions de nous-mêmes qui correspondent plus facilement aux descriptions de la culture dominante ou hégémonique. »
Stuart Hall« Yeah, and I don’t have to go to Hollywood ‘Cause Hollywood come through my neighborhood with cameras on I really think they’re stealin from us like a sample song »
Lil’ Wayne[1]
Au cours de leur embrigadement dans une milice armée, il était de coutume que les enfants-soldats (entre autres de Sierra Léone ou de la République du Congo[2]) adoptent un nouveau nom de guerre, marquant une rupture définitive avec leur expérience civile. Les surnoms sélectionnés par les jeunes recrues symbolisaient non seulement les traits de caractère qu’ils voulaient voir transparaître de leur personnalité mais désignaient également le type de représentations auxquelles ils s’associaient (Wessels, 2007 : 82-84). Les noms de personnages hollywoodiens comme Rambo ou Terminator côtoyaient ceux de certains rappeurs américains comme 2pac ou 50 Cent. En raison du « capital d’authenticité » qu’ils apportaient, ces derniers étaient particulièrement appréciés : la violence de leur musique reflétait fidèlement la violence de leur existence[3]. En outre, ils incarnaient un certain type de virilité, celle exacerbée par la violence meurtrière, et les récits de vie que contiennent leurs paroles servaient de grille de lecture à l’environnement de violence et de mort permanente dans lequel se trouvaient ces adolescents[4]. Les identifications qu’ils trouvaient soit dans le cinéma, soit dans la musique leur permettaient ainsi de se plonger dans des univers narratifs importés et réappropriés, les préparant psychologiquement à l’âpreté des combats (dont les enjeux politiques leur échappaient en général) (Wessel, 2007).
Au même titre que l’industrie hollywoodienne, le rap américain semble en mesure de fabriquer des fables collectives et de proposer des « types » d’identifications à ses auditeurs. Le type de narration que cette musique produit met principalement en scène les épreuves d’une expérience noire évoluant dans un cadre pauvre et urbain. Parmi ces narrations, on trouve celle dites « thug life » (« vie de voyou ») dominant la production de cette musique (depuis une vingtaine d’années) sous l’appellation de gangsta rap (« rap de gangster »[5]) et dans lequel se trouvent exposées des représentations de genre racisées – venues signifier une « authenticité raciale » – présentant l’ambiguïté d’être à la fois dangereuses et « attractives » (à l’image des deux artistes susmentionnés). Ces récits mettent essentiellement en exergue des hommes noirs, pauvres et revanchards, usant crapuleusement de la violence armée pour obtenir aisément des biens matériels. Les femmes y sont généralement décrites comme objets sexuels et signes extérieurs de richesse.
Le rap aux États-Unis est devenu le médium par lequel s’affirme la « vérité » de l’identité noire (Rose, 2008) et les narrations produites dans cette musique agissent comme des « scripts » (Stephens & Phillips, 2003) ou des « controlling images » (Hill Collins, 1990 et 2005). Ces deux expressions désignent les discours[6] ou représentations produisant des effets réels lorsqu’ils sont dits – sur la population africaine-américaine (et j’ajouterai sur les jeunesses du monde entier en général, du moins celles exposées à ce genre d’images ou de narrations). Si les protagonistes de cette musique s’accordent pour affirmer l’authenticité de leurs paroles comme simple reflet de leur réalité – celle de l’« expérience vécue de Noir » dans le ghetto – ces derniers ont rapidement compris qu’ils pouvaient tirer profit de cette affirmation. Depuis une dizaine d’année l’expérience noire américaine n’est-elle pas de plus en plus réappropriée et canalisée par le secteur économique qui (re)produit des fables afin de vendre des produits ? L’authenticité « réelle » revendiquée dans la musique rap se confondrait alors avec une « authenticité » raciale et commerciale, intéressée et performée en vue de l’accroissement de gains financiers.
Sous couvert d’un « label d’authenticité », j’interroge la confusion entre réalité vécue et « réalité » reproduite (en spectacle), dans laquelle les représentations identitaires (mêlant les catégories de genre, de « race », de classe) deviennent des objets de consommation à part entière. Si le rap se trouve à la confluence de deux logiques narratives – l’art du storytelling hérité de la tradition orale noire-américaine d’un côté et le storytelling du marketing narratif de l’autre – quelle(s) incidence(s) cette nouvelle connexion induirait-elle sur la « mise en récit » d’une expérience noire dite « véridique » ?
J’inscris cet article dans le champ des cultural studies. Il tire parti des travaux de Stuart Hall, notamment ceux sur l’idéologie ou sur ses concepts de « codage/décodage » et dans lesquels le théoricien jamaïco-britannique tente de décrypter les mécanismes de production et de réception des messages transmis dans les médias en général. À partir de cette analyse, je propose de déconstruire la première phase du circuit de communication – le « codage » – et les logiques rationalistes qui façonnent les représentations « authentiques » et dominantes dans cette musique[7]. De ces représentations, il s’agit d’en souligner la dimension « mythique »[8].
Dans cet article, j’examinerai dans un premier temps les liens qu’entretient la musique rap avec la tradition noire américaine, afin de montrer en quoi la narration est l’expression d’une condition noire, où se formule de manière ésotérique une identité noire états-unienne. Dans un second temps, j’analyserai les effets de la commercialisation de la musique africaine-américaine, voir dans quelle mesure sa marchandisation a bouleversé sa capacité à traduire cette condition de subalterne. Enfin, j’analyserai comment, avec sa connexion à l’« industrie du spectacle », le gangsta rap peut être compris comme l’illustration de cette réorientation commerciale et constituer le résultat d’une narration hybride, au carrefour de l’héritage oral et narratif africain-américain et du marketing narratif (storytelling). Quelles incidences cette association peut-elle avoir sur la production d’un récit à la première personne, expression de l’« authenticité raciale » dans le rap américain ?
Le récit de l’âme
Bien que l’historien américain Lawrence W. Levine n’ait pu s’intéresser à la musique rap, (son ouvrage intitulé Black Culture and Black Consciousness ne sort qu’en 1978, soit lorsque le rap n’était encore qu’une pratique embryonnaire), sa recherche peut nous permettre de comprendre en quoi cette musique s’inscrit dans l’héritage culturel des Noir.e.s aux États-Unis. L’historien américain consacra sa recherche à analyser la naissance puis le développement d’une culture noire américaine qui s’est essentiellement forgée sur une tradition orale et narrative, et ceci afin de surmonter les assignations d’une identité subalterne (le statut de sous-homme de l’esclave). Plus précisément, l’expression orale développée par les esclaves – à mi-chemin entre la tradition africaine du griot et la tradition narrative déjà présente en Amérique (et héritée de l’Europe) – a permis à cette population de produire une subjectivité propre capable de contester et de subvertir un système d’exploitation leur refusant toute humanité.
C’est à travers l’investissement de l’oralité que les esclaves ont pu se constituer une mémoire commune faite d’histoires quelconques, de pratiques, d’enseignements et de fables qui constitueront, au fil des transmissions d’une génération à l’autre, une conscience noire aux États-Unis[9]. Celle-ci a pu devenir un médium maintenant la transmission et l’entretien de la mémoire telles les fables qui « permettai[en]t de réinscrire le passé dans l’expérience présente. En général, les esclaves utilisèrent chansons et sermons pour atteindre cette fin ; ils dirigeaient la structure et le message de leurs contes dans cette direction et au service de leur situation présente[10] » (Levine, 1977 : 97).
En réaction à la négation dont ils faisaient l’objet, les esclaves réinventèrent, par l’entremise de ces expressions orales, l’origine des hommes sur terre à partir de la « race noire » et ceci afin de se prémunir des discours brimant leur reconnaissance humaine : « les esclaves noirs se dotèrent de leur propre forme d’ethnocentrisme racial dans lequel la race blanche devenait la forme dégénérée de la race noire. » (ibid. : 85) Ce type d’inversion du stigmate a constitué les premiers balbutiements de l’émergence d’une fierté raciale qui sera, ensuite, récurrente dans la redéfinition de l’identité africaine-américaine. Ce renversement de situation se trouvera également dans les toasts[11] qui mettaient en scène des personnages anthropomorphes[12], dont l’habilité leur permettait de prendre l’avantage sur des adversaires plus redoutables. La figure du personnage rusé qui se sort d’une situation hostile sera également récurrente dans les récits de rap décrivant les aventures du player (le « manipulateur ») ou du hustler (le « lascar[13] »).
Enfin, la narration prenait une dimension cathartique dans laquelle les Noir.e.s exprimèrent leurs frustrations, leurs interrogations mais aussi leurs espoirs. Du Bois voyait, par exemple, dans les « sorrow songs[14] » l’expression d’espoirs déçus « parlant de mort et de souffrance » (2007 : 240), mais aussi « du désir indicible d’un monde plus vrai, d’errances confuses et de chemins secrets[15] ». Cette indicibilité évoquée par Du Bois mettait l’accent sur l’aspect ésotérique de ces musiques noires-américaines. Les sentiments profonds que l’on retrouve dans la narrativité du blues, du gospel, etc., sont ceux liés à une condition subalterne qui a marqué l’existence des Noirs en Amérique. Cette dernière a fourni la source d’inspiration à la production narrative de la culture populaire noire américaine (allant des contes aux musiques « black ») et permettait aux Noirs d’Amérique de se penser sur ce nouveau sol et de redéfinir leur propre identité (Jones, 1996).
C’est dans sa capacité à produire de la narration et à occuper certains rôles sociaux (espace de réflexivité, éveil des consciences, transmission de connaissances, etc.), que le rap est devenu l’héritier d’une tradition orale constituée au moment de l’esclavage comme médium principal de la conscience et de la mémoire des Noirs aux États-Unis (Du Bois, 2007). Cette musique se connecte à d’autres courants comme le blues, le jazz, la soul qui présentaient ces mêmes propriétés. Mais aux côtés des vertus « thérapeutiques » (Gilroy, 2004 : 16) – présentes « dans l’intimité de la communauté » – toute la musique africaine-américaine présentera également une autre dimension, celle, « publique » cette fois-ci, imaginée « lors de sa confrontation avec le monde blanc, [et] où la performance épousera forcément un aspect commercial » (Parent, 2009), tournée vers la satisfaction de la demande blanche.
Commercialisation de l’« âme noire »
La ségrégation post-abolitionniste aux États-Unis ne se limitait pas uniquement à une séparation en terme spatial. La culture représentait également un moyen de distinguer les groupes raciaux. C’est ainsi que l’on parlait, à partir des années 1920, de « race music » puis de « race records[16] » pour qualifier respectivement les musiques noires américaines (comme le blues ou le rhythm & blues) et les labels qui les produisaient. Lorsque des labels comme Atlantic ou Black Swan Records (respectivement dirigés par des entrepreneurs blancs et noirs) produisaient des artistes noirs, leurs musiques ne visaient que le marché africain-américain (quant au label Atlantic, qui produisait autant des artistes blancs que noirs, il ne cherchait pas à créer des musiques fédératrices allant au-delà de la « ligne de couleur »). Les amateurs blancs devaient alors transgresser la « frontière » spatio-raciale pour avoir accès à ce type de musique. Ce qui n’empêchait pas des artistes noirs de jouir d’un relatif succès, qui restait cependant limité aux frontières de la communauté, et seuls des artistes blancs (Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Rick Nelson) s’inspirant des musiques noires bénéficiaient d’un large succès.
Cependant, la création en 1960 du label Motown à Detroit par Berry Gordy va modifier la donne en termes de transgression des frontières raciales. Tout commença lorsque Gordy travailla sur une chaîne de montage de l’usine Ford à Détroit. Il voyait dans la méthode de travail fordiste un moyen de produire de la musique et de fabriquer des artistes à succès :
« J’ai obtenu un emploi à l’usine d’assemblage des automobiles Ford. Tous les jours, je pouvais observer comment une barre de métal se transforma progressivement le long de la chaîne en une voiture flambant neuve. […] Peut-être que je pourrais faire de même avec ma musique – créer un lieu où un gamin de la rue pourrait entrer par une porte et en ressortir par une autre en véritable vedette. C’est ce genre de pensées qui me traversait l’esprit lorsque je parcourais la chaine d’assemblage de l’usine Ford et qui s’est ensuite nommée Motown, connue de tous[17]. »
Chaque projet artistique fera dorénavant l’objet d’une division rationnelle du travail avec à chaque étape de la production des spécialistes : on trouvera ainsi le fameux trio « Holland-Dozier-Holland » affecté à la production des chansons, puis les Funk Brothers (musiciens de studio) pour la fabrication du son « Motown ». Mais Gordy ira encore plus loin. Constatant que les Noirs ne représentaient que douze pour cent de la population américaine, il en déduit que la communauté noire ne pourrait pas lui rapporter autant de bénéfices que s’il en vendait ne serait-ce qu’à un quart de la population blanche (Schweikart, 2003). Au cours d’un discours, Gordy juge l’accès à la population blanche comme un tremplin possible pour l’élévation sociale des Noirs mais seulement si ces derniers soignent leur présentation :
« Croyez le ou pas, je savais dès l’âge de 11 ans que j’avais le sens des affaires. Je me nommais d’ailleurs expert en marketing lorsque je travaillais dans un hebdomadaire noir […]. J’ai eu, un jour, l’idée de vendre les « Chroniques du Michigan » (Michigan Chronicles) dans les quartiers blancs, car je les adorais, […]. Je sentais que les Blancs pouvaient les apprécier tout autant que moi. J’ai finalement vendu plus de journaux [chez les Blancs] que je n’en ai jamais vendus de ma vie. Partout où j’allais, j’en vendais et c’était merveilleux.
Mon jeune frère Robert était tout excité car nous nous imaginions devenir riches et parce que nous étions les seuls à faire cela. Lorsque nous sommes retournés dans ces quartiers, nous avions avec nous, un paquet de journaux mais nous n’avions finalement rien vendu […]. C’était si ridicule que nous avions eu du mal à y croire. Nous étions trois petits garçons noirs : un était beau, les deux autres constituaient une menace pour ces quartiers blancs. [rire] C’était ma première leçon de marketing dont j’allais m’inspirer plus tard dans ma carrière. » (Schweikart, 2003)
Dans cette anecdote, Gordy souligne quelque chose de banal en économie : la stimulation de la demande dépend de la qualité de l’offre. Mais dans son raisonnement, lié au contexte de ségrégation raciale, l’offre et la demande sont racialement marquées et dans le cas qui intéressa Gordy – celui de la musique – c’est une « consommation/demande blanche » qu’une « production/offre noire » se doit de « séduire ». Afin de percer la ligne de couleur et avoir accès à une potentielle demande, le patron de la Motown va soigner la forme de l’offre. Tout l’enjeu pour l’homme d’affaire était alors de rompre avec les productions rhythm & blues trop racialement connotées pour une Amérique blanche. Suivant la logique fordiste – à une production de masse, doit correspondre une consommation de masse – Gordy pensa à une musique qui soit la plus consensuelle et fédératrice possible (Schweikart, 2003). Un seul thème pouvait être décliné à l’infini : l’amour[18]. Face à cette nouvelle règle, l’offre noire devait s’ajuster au profil de la clientèle visée (foyer blanc et puritain). D’une certaine manière, on peut dire que Gordy a été l’instigateur d’un formatage de la musique noire américaine en inventant une nouvelle façon de fabriquer et de vendre un produit, dont la principale distinction était l’expression d’une identité raciale. Ceci revenait à « polir » cette dernière selon les normes dominantes d’une « blanchité » bourgeoise et puritaine (faites de pudeur, de respect rigoureux de principes moraux, etc.).
Pour atteindre ces objectifs, Gordy s’est assuré les services de professionnels enseignant aux artistes les règles de « bonnes conduites » telles qu’apprendre à « bien » parler, à « bien » marcher, à « bien » s’habiller ou encore à « bien » danser (c’est-à-dire sans la moindre connotation sexuelle[19]), conformément aux valeurs d’une société puritaine et blanche. Autrement dit ce sont de nouvelles performances raciales que le patron de la Motown invente, rationalise, exige (de ses artistes), réifie[20] et met sur le marché.
La stratégie de Gordy se présentait comme un modèle de réussite pour le « Black capitalism[21] ». Il constituait une version noire-américaine du Self-Made Man imaginé par l’auteur américain Horatio Algier et que Booker T. Washington définissait comme le « New Negro[22] » du siècle à venir, soit ce Noir dont l’émancipation, après l’abolition de l’esclavage (1865), ne devait dépendre que du développement économique et du service rendu à la nation (au détriment de revendications à l’égalité politique). Gordy ré-inventait donc une nouvelle manière de vendre de la musique noire pour qu’une partie de celle-ci ne se limite plus aux frontières communautaires mais vise bien plutôt des objectifs commerciaux plus ambitieux, par-delà la color line. Il privilégia dans sa musique la dimension de divertissement (entertainment) que l’on retrouvait déjà dans les Minstrel shows[23] aux XIXe et XXe siècles et dans le blues commercial conçu pour ce type de spectacle destiné à un public blanc. Selon Samuel Charters (historien américain spécialisé dans les musiques blues et jazz), cette musique du sud des États-Unis se constitue toujours dans une dualité : « d’un côté une créativité originale, soit la conscience d’une créativité personnelle utilisant le blues comme moyen d’expression. De l’autre, un blues perçu comme un divertissement » (cité dans Baker, 1983 : 841). C’est sans doute cette figure du « performeur » qui divertit (entertainer), que Berry Gordy réactualisera au sein de son label. Elle correspond à une activité professionnelle où l’offre s’ajuste aux attentes de la demande. Pour les artistes noirs, ce paramètre, se présentera sous la forme d’un dilemme : soit être complètement en phase avec son public de base – et communier avec lui ses espoirs et frustrations – soit se tourner vers un public plus largement blanc qui ouvre l’accès au rêve américain. Ainsi un artiste comme Ray Charles dira : « C’est mon peuple qui a fait de moi ce que je suis, car on doit d’abord devenir quelqu’un d’important dans sa « propre communauté », mais dès que j’ai cessé de m’adresser exclusivement au public noir, je n’ai plus jeté un seul regard en arrière. » (Guralnick, 2008 : 24) L’artiste soul indique ici que la fuite de la misère passe par une sorte de « transgression », c’est-à-dire l’éloignement de son environnement social et racial d’origine, pour évoluer dans un milieu certes racialement différent, mais qui garantit prospérité et liberté économique. Loin d’être un acte aliénant (ou de fourvoiement) contrairement aux apparences, Houston Baker explique que la démarche commerciale de l’expression noire (« black expressiveness ») s’inscrit au cœur même de la logique de la culture africaine-américaine. Elle constitue même un « acte déterminant dans l’esthétique qui se situe au cœur de la politique afro-américaine conçue en termes de qui obtient quoi et quand et comment » (Baker, ibid. : 842).
En 2004, le théoricien guyano-britannique Paul Gilroy publia un ouvrage intitulé Between Camps – Nations, Culture and the Allure of Race. L’auteur y analyse les effets pervers des discours sur la valorisation raciale (qui passe notamment par le corps noir) et d’inversion du stigmate, autrefois déployés par les populations noires pour se prémunir contre les dépréciations liées aux discours racistes. Aujourd’hui repris et réifiés par les groupes discriminés eux-mêmes (il parle essentiellement de la communauté africaine-américaine) en signe de capital identitaire, ces discours, au départ subversifs, enterrent tout projet de constitution d’une humanité commune post-raciale. Gilroy voit dans la musique rap les effets de cette réification et le déclin de la culture noire. Bien que cette musique connaisse un succès planétaire, celle-ci s’est faite, selon Gilroy, au prix d’un appauvrissement du contenu narratif (au profit d’une dimension visuelle). La commercialisation de cette musique et son association avec les nouvelles technologies multimédias ont fait progressivement perdre à cette dernière ses considérations morales et politiques (propre à l’oralité des descendants d’esclaves). La musique noire est passée d’un discours de libération à celui imagé autour du culte du corps (Gilroy, 2004 : 190). Bien que l’analyse du théoricien s’avère stimulante pour comprendre l’évolution générale qu’a connue la musique noire-américaine – et son passage de « musique de nègre » (race records) à musique populaire – l’opposition qu’il soulève entre forme vernaculaire d’un côté et forme visuelle de l’autre (faisant la part belle à la première au détriment de la seconde) me semble trop radicale et gagnerait à être repensée. Dans le cas de la musique rap, la transition de l’oralité au visuel, suggérée par Gilroy, fait l’impasse sur la connexion de la tradition narrative africaine-américaine avec le marketing narratif (autrement appelé storytelling) depuis les années 1990. Mais comment ces deux logiques narratives peuvent-elles s’articuler ?
Le storytelling repose sur l’idée que toute marque (aussi bien le simple produit que l’artiste ou la personnalité politique) doit avant tout s’inscrire dans un récit capable de la « mythifier » car « les gens n’achètent pas des produits, mais les histoires que ces produits représentent. Pas plus qu’ils n’achètent des marques mais les mythes et les archétypes que ces marques symbolisent » (Salmon, 2008 : 32). En tant que technique narrative, le storytelling produit des « effets de croyance », c’est-à-dire des histoires suffisamment crédibles pour faciliter l’identification des consommateurs avec ces récits et les amener à adopter des modèles de conduite (comme les actes d’achats) qui l’intègrent dans la rationalité de ladite narration. Dans le storytelling chaque individu est invité à investir un rôle prédéfini : « [Le néomarketing] transforme la consommation en distribution théâtrale. Choisissez un personnage et nous fournissons les accessoires. Donnez-vous un rôle, nous nous occupons du décor et des costumes. » (ibid. : 42) Le storytelling constitue un « espace performatif » dans lequel se produit, s’organise et se trouve sélectionné un ensemble de discours performatifs, soit des énoncés qui ont des propriétés à la fois descriptives mais aussi productives (d’effets concrets dans la réalité), en faisant concrètement advenir l’affirmation énoncée (Austin, 1991). Les discours performatifs soulignent comment s’orientent et se déterminent nos conduites au quotidien. En tant qu’« espace performatif », on peut imaginer que le storytelling sert de cadre à la myriade de discours performatifs existants, renforçant la cohérence de ces derniers entre eux et en les dotant d’une « couverture » narrative facilitant leur légitimité. Le storytelling constitue finalement un « instrument de contrôle » (ibid. : 8) donnant des voies à suivre et des modèles de conduite auxquels se conformer. Il est d’autant plus efficace qu’il stimule les émotions de tout un chacun, invoquant notre consentement et notre participation active dans le déroulement de la narration. L’intériorisation de modèles de conduite – autrement appelés « controlling images » par la chercheuse féministe africaine-américaine Patricia Hill Collins – que ce consentement implique, crée des « identifications carcérales » qui réduisent le champs des possibles d’une catégorie de population donnée, en les enfermant dans une naturalité et auxquels il devient difficile d’échapper.
Le gangsta rap est né au lendemain des luttes du mouvement des Droits civiques. L’analyse de Levine sur l’émergence de la figure du « bandit criminel » comme personnage majeur des contes et des toasts inventés par les Noirs Américains à la fin du xixe siècle, peut une fois de plus nous éclairer sur les conditions d’émergence d’un rap dit « de gangster » :
« Ceux qui se satisfont de leur sort, qui disposent du pouvoir, qui se sentent pleinement intégrés dans leur société ne sont généralement pas ceux chez qui émanent les histoires de bandits. Les prérequis pour la création de ce type de figure dans les communautés aussi bien blanches que noires ont été le ressentiment d’un niveau de frustration et d’impuissance. » (Levine, 1977 : 419)
Le gangsta rap témoigne de la condition de la jeunesse africaine-américaine des centres urbains. Il exprime le harcèlement du système judiciaire à l’encontre de la communauté noire et formule sa propre réflexion politique sur l’Amérique. Bien que vivement critiqué, le « nihilisme noir » – discours rageur teinté de pessimisme et de désenchantement moral – illustrant les propos des rappeurs, revêt également une dimension subversive et « révolutionnaire » en remettant en question l’illusion de « progrès » que défend une Amérique (noire comme blanche) progressiste (De Genova, 1995).
En même temps que le gangsta rap délivrait un message politique nihiliste, il est devenu au début des années 1990 un genre musical à succès aux États-Unis, se vendant à des millions d’exemplaires, s’associant à des multinationales (de vêtements, de musique, de boissons, etc.) qui tirent leurs profits d’une clientèle jeune, urbaine et branchée. Ces marques commerciales s’inspirent de l’univers narratif créé par les rappeurs pour donner un caractère « cool » et rebelle à leurs produits[24]. Comment cette tradition narrative va-t-elle être récupérée puis réifiée par l’industrie du divertissement ?
Dans un ouvrage intitulé The Hip Hop Wars – What we talk about, when we talk about – and why it matters, Tricia Rose explique comment le gangsta rap s’est imposé comme genre musical prépondérant de ces vingt dernières années aux États-Unis. L’invention du Nielsen Soundscan (baromètre mesurant les ventes d’albums hebdomadaires) en 1991 a permis aux maisons de disques de constater deux choses : d’une part le succès national du groupe de rap N.W.A. (Niggers With Attitude) – connu pour ses propos provocants, outranciers et misogynes. De l’autre, que les principaux amateurs de ce type de musique sont des adolescents, majoritairement blancs, et de classe moyenne (Rose, 2008 : 4). La dimension subversive de cette musique accroît son attractivité, notamment auprès d’un public plutôt jeune et blanc : l’irrévérence des personnalités noires envers l’ordre établi est récupérée comme objet de fantasme et de transgression pour des adolescents désirant rompre avec les valeurs générationnelles de l’autorité parentale (De Genova, 1995 : 109). Cependant, comme l’affirme l’anthropologue De Genova :
« La marchandisation de la « négrité » [blackness] dans la musique rap avec ses gangsters et ses représentations des ghettos est si facilement mobilisée pour heurter les parents de classe moyenne, ceci est rendu possible en raison de prémisses racistes et hégémoniques au sujet du « négro » [nigger] qui sont autant partagées par les parents que par leurs enfants récalcitrants » (ibid. : 109).
Patrons de maisons de disques et artistes s’accordent pour dire qu’il existe un marché autour d’une configuration narrative « type » – celle dite « thug life » (« vie de bandit[25] »). S’ajustant à la demande du marché, les artistes n’ont plus qu’à s’y engouffrer, en conformant leur image à celle du proxénète, du trafiquant de drogue, de l’escroc (pour les hommes noirs) ou encore des prostituées et des michetonneuses (concernant les femmes noires). Dans son titre « Moment of Clarity » (« Instant de lucidité »), le rappeur Jay-Z admet que la rédaction de ses paroles a, avant tout, été influencée par la demande du public[26]. Loin d’être une simple description d’une réalité, Patricia Hill Collins montre que les personnages des récits de rap correspondraient à des stéréotypes qui s’inscrivent dans une généalogie héritée de l’esclavage et de la ségrégation (Hill Collins, 1990). Ces représentations constitueraient la « matière » d’une nouvelle idéologie (succédant à celle de l’esclavage, puis de la ségrégation) dite du « genre noir » (Black Gender Ideology) (Hill Collins, 2004[27]).
Bien que se revendiquant comme le reflet fidèle et sans concession d’une expérience noire aux États-Unis, la narration est guidée, comme on l’a dit, par l’intervention d’un spectateur externe, le consommateur, qui définit au final ce qu’il souhaite entendre. L’offre se trouve en quelque sorte interpellée par la demande et ceci se traduit, comme on l’a déjà vu avec la musique Motown, non seulement par une racialisation de ces deux éléments mais aussi par une « offre noire » finalement tributaire d’une « demande blanche ». En d’autres termes, l’authenticité des récits de vie, dont dépend la crédibilité des rappeurs dans leurs paroles, est sélectionnée et motivée pour des raisons commerciales. Elle donne lieu à la mise en place d’un véritable « jeu de rôle » de type « racial » où ces artistes revêtent consciemment le « masque du ménestrel » (« minstrel mask[28] »). Répétés abondamment et continûment sous des formes variées (publicités, vidéoclips, films, chansons, faits divers, etc.), ces discours sont vus et confirment les « clichés » (non-retouchés) des ghettos américains, servant de cadre normatif quant à la « vérité » de l’expérience urbaine noire-américaine.
Le storytelling « hybride » proposé dans le gangsta rap n’est pas tant l’exposition de l’authenticité d’un artiste, qu’une injonction à répondre à l’interpellation « qui tu es ? ». Le « je » narratif dépend de sa relation à l’Autre et du cadre imposé par ce dernier. Le processus de racialisation, entendu comme un rapport de pouvoir, installe une configuration mettant en scène des figures racialisées – celles du « real Nigga » (« vrai négro ») et de la « real Bitch » (« vraie chienne ») – se confrontant et construisant un modèle opposé, une féminité et une masculinité blanches et bourgeoises[29].
À l’instar de la méthode fordiste pour la fabrication standardisée de voitures, la narration « thug life » – réifiée dans l’« industrie du rap » – définirait, rationaliserait, puis produirait des performances de genre racialisées. Dans cette perspective, le corps ne pourrait-il pas être l’expression matérielle de cette narration ? Les tatouages ornés sur le corps d’un grand nombre de rappeurs et rappeuses indiquent déjà comment la surface corporelle sert de medium à l’expression d’un style de vie. Nous verrons en quoi ce dernier, comme « surface d’inscription » (Grosz, 1994 : 138-159), devient le lieu de marquage de ce récit « type » de « gangster® » pour en faire un produit fini « prêt-à-consommer ». Je propose maintenant d’illustrer mes propos sur les effets d’interpellation du récit de soi, vus à travers la biographie de Curtis Jackson, mieux connu sous le nom de 50 Cent.
Le corps noir comme
surface de la narration
Loin d’être un simple divertissement, la musique rap est également productrice de « scripts » (scénarii) façonnant le regard porté sur la jeunesse noire-américaine. C’est ce que soulignent les chercheuses américaines Dionne P. Stephens et Layli D. Philips. Ces dernières montrent comment – à travers le cas des femmes noires – le sens dominant donné à leur sexualité est en fait produit par un « codage[30] » (Hall, 2008) réalisé par des entrepreneurs, en association avec les artistes hip hop, et dans lequel le corps devient un enjeu central (Stephens & Phillips, 2003 : 11). Et si les storytellings présents dans le gangsta rap paraissent si crédibles aux yeux du public, c’est parce qu’ils s’articulent harmonieusement avec l’ensemble des discours et institutions (soit un dispositif) qui définissent la population noire-américaine comme potentiellement déviante. Le corps de ces hommes et de ces femmes devient la cible sur laquelle s’exerce l’autorité d’un dispositif que l’on pourrait qualifier de racialo-capitaliste et qui viserait, depuis l’esclavage, à donner à cette population une fonction utilitaire. Cette musique sert de cadre de reconnaissance de la jeunesse noire américaine[31] (et peut-être des jeunesses noires en général) faisant écho aux minstrel shows qui servaient à renseigner la population blanche (en particulier du nord des États-Unis) sur ce que sont les esclaves noirs du sud.
La carrière de Curtis Jackson – alias 50 Cent – va me permettre d’illustrer mes propos. Si j’ai choisi cet artiste, c’est parce qu’il souligne à la fois la continuité entre expérience vécue et mise en scène de la réalité (fabriquée dans le rap commercial), mais aussi parce que sa promotion montre le lien entre représentation raciale et logique économique. Une partie de sa biographie a en effet servi d’argument marketing pour vendre ses albums (mais aussi son film et les nombreux produits dérivés), l’invitant à se tenir dans un rôle pré-établi afin d’assurer son succès commercial.
L’autobiographie de 50 Cent (50 Cent & Kris Ex : 2003), telle qu’elle nous a été commercialement présentée, commence dans un ghetto new-yorkais du Queens. La mère de Jackson n’avait que 15 ans quand il est né. L’artiste précisa que, l’élevant seule (son père, trafiquant de stupéfiants, fut assassiné), celle-ci fut obligée de vendre de la drogue et de se prostituer pour subvenir à ses besoins[32]. Mais quand elle fut empoisonnée (il n’avait que 12 ans), il fut repris par ses grands-parents. Son adolescence fut marquée par le trafic de drogue, la pratique de la boxe, du rap et quelques séjours en maison de correction. Malgré une signature en maison de disque, la carrière artistique de Jackson se trouvait en attente, le contraignant à continuer la vente illicite afin de nourrir son fils.
Mais l’an 2000 constituait un moment crucial dans sa vie/carrière : il survit à une tentative d’assassinat après avoir été blessé de neuf balles dans le corps. La biographie de l’artiste, avant sa consécration artistique et commerciale s’arrête sur cet épisode. Toute la campagne promotionnelle de son premier album officiel va ensuite se constituer autour de cet événement : le témoignage d’un survivant du ghetto accédant au rêve américain.
Cette histoire met l’accent sur le caractère menaçant et criminel du musicien. Elle vient ainsi corroborer les représentations racistes légitimant le contrôle institutionnel du corps noir masculin par le système carcéral et les politiques urbaines (Wacquant, 2001 ; Davis, 2006). À l’écoute de ce récit, les spectateurs sont invités à authentifier ce qui fait la particularité de l’« homme Noir ». La première vidéo – intitulée « In Da Club » – promouvant la sortie de son album Get Rich or Die Tryin (« Devenir riche, quitte à mourir ») détaille comment l’artiste parvient à se rétablir de ses blessures et à renaître en tant que rappeur.
La première scène s’ouvre sur un centre de formation pour artistes laissant imaginer comment se fabrique un modèle standard et hégémonique d’artiste rap et, par extension, une représentation commune et certifiée de masculinité noire (si l’on s’en tient à l’idée qu’il s’agit d’une musique exprimant la réalité de l’identité noire). On retrouve alors étrangement la fameuse métaphore de la chaîne de montage de Berry Gordy dans lequel un « gamin de la rue entre par une porte et en sort par une autre sous forme de célébrité ».
Je suggère que l’on assiste à une véritable présentation condensée d’une disciplinarisation du corps noir, symbolisée par la personnalité de 50 Cent, et qu’il s’agit de conformer aux normes de virilité dominante (dans le milieu du rap notamment). Le scénario qui organise la vidéo nous donne l’opportunité de voir – de manière explicite – la production d’un corps docile (racialisé). Il s’agit en effet de « construire » le « nouveau 50 Cent[33] ». Ces images nous donnent à penser ce qu’est l’« authentique » masculinité du « real nigga », celle que l’on retrouve dans la plupart des vidéoclips de rap (sous forme de « produit fini ») et que l’on se doit d’accepter comme « naturelle » conformément à la narration interpellative dans laquelle cette masculinité noire et urbaine s’inscrit. Dans son examen critique sur le sens du terme « populaire » associé au mot de « culture » (dont rend compte la citation en épigraphe de cette étude), Stuart Hall souligne la capacité des institutions à recréer des images de soi (Hall, 2007 : 72). La vidéo dans laquelle 50 Cent est le héros, pourrait nous aider à comprendre les propos du théoricien : la métaphore (filée) de la construction, que suggèrent ces images, ne désigne-t-elle pas au final la fabrication réelle des artistes, selon des normes (de genre, de « race », de classe) standard, fixées et établies par l’industrie de la musique (et sur l’idée qu’elle se fait de ce qu’est un « véritable » artiste de rap) ? Le scénario de la vidéo ne dénaturalise-t-il pas l’ « authenticité » de rigueur, imposée dans la commercialisation de cette musique ? On pourrait ainsi penser que cette présentation explicite de la fabrication d’un artiste de rap n’est pas innocente et serait déjà l’amorce d’une critique sur la réification du corps noir dans la musique rap et de l’expression d’une distance consciente par rapport aux rôles assignés[34].
Le processus de fabrication du corps noir masculin se déroule, ici, sur six scènes, chacune d’entre elles assignant un rôle particulier à la figure du « rappeur-gangster » : la salle d’opération, la salle de musculation, la piste de danse, la salle d’enregistrement, la salle de tir, puis la salle d’interrogation (indiquée par la présence d’un détecteur de mensonge). Six différents lieux déclinant autant de spécificités prêtées à la masculinité noire : la violence, la force, la concupiscence, l’appétit sexuel, le talent artistique, et la criminalité. En correspondant à des espaces clos, ces lieux réduisent la mobilité du musicien et rationnalisent son examen (par les médecins, les femmes présentes, etc.), facilitant le contrôle et le renforcement des techniques disciplinaires (observation, jugement normalisant, etc.), exercés sur son corps (Markula & Pringle, 2006).
Or ce qui caractérise les activités entreprises par notre protagoniste réside dans le fait qu’elles font justement l’objet d’une étroite surveillance. Le regard porté sur le corps de 50 Cent est en effet omniprésent. Que ce soit par le personnel médical pour juger de la viabilité de leur « produit » ou par les regards féminins sur l’artiste, dont la présence vise à certifier l’« authenticité » de sa virilité ainsi que l’attractivité d’un corps produit en tant qu’objet sexuel (à convoiter). Dans ce contexte la présence des femmes (celles principalement qui entourent l’artiste) ne bouleverse-t-elle pas les rôles de genre, en réduisant, à leur tour, le protagoniste en un objet à posséder ? Au même titre que la féminité se forme et se construit pour le regard masculin, ne pouvons-nous pas avancer l’idée que cette virilité racialisée se construit non pas uniquement pour le regard des « pairs masculins » en général (blancs comme noirs) mais aussi sous la validation d’un désir féminin ?
Cette surveillance prend, par ailleurs, un caractère particulier, par notre participation constante et implicite. La caméra (pour 50 Cent) ou l’écran de télévision (pour nous spectateurs et spectatrices) jouent un rôle d’interface. Seul l’artiste, pourtant entouré, prend réellement conscience qu’il est observé par un œil extérieur et invisible (symbolisé par la caméra). Cette supposition l’amène alors à agir en conformité avec ce que les présupposés regards attendent de lui. Il se montre capable de s’auto-surveiller et de s’auto-discipliner sans la présence explicite d’un gardien (comme le suggère déjà sa pratique intensive et autonome d’exercices physiques). Cette idée d’auto-discipline se renforce par la présence d’un miroir sans tain (voir image ci-dessus), qui permet au protagoniste d’ajuster son attitude. Objet trivial, le miroir est associé à notre intimité. Cette position particulière confère à cet objet un fort pouvoir d’auto-contrôle (social) sur chacun de nous, et au niveau le plus intime, en invitant (à imaginer) le jugement du « regard invisible » sur nous. Dans la vidéo, il permet à nos deux superviseurs (Eminem et Dr Dre) d’observer l’évolution de leur « produit » sans être vus.
On retrouve, ici, l’idée de panoptisme, inspiré du philosophe anglais Jeremy Bentham, et que Michel Foucault reprend dans Surveiller et Punir – Naissance de la prison, pour expliquer comment l’architecture d’une prison permettait une rationalisation et un contrôle des conduites à distance et par la norme. Le panoptisme décrit une tour centrale autour duquel gravitent les cellules. Une telle architecture instaurait chez les prisonniers un sentiment de suspicion permanent (le surveillant pouvait observer sans être vu), qui devait les pousser à s’auto-discipliner. Pour Foucault, cette version carcérale n’a constitué que la forme paradigmatique d’une société de contrôle beaucoup plus large (englobant l’école, l’usine, etc.), et s’étendant à l’ensemble de la société. Le panoptisme, ici comme métaphore, permet de révéler non seulement quel type de relation unit l’« auditeur-client-surveillant » et l’« artiste-performeur », mais aussi comment la figure du décepteur (trikster), peut habilement tirer profit d’une situation normative et restrictive à son égard.
Conclusion
Au travers de cet article, j’ai essayé de démontrer comment la musique rap se situe au carrefour de deux conceptions du storytelling : d’un côté une tradition narrative qui, par les contes et les musiques, délivre les tourments d’une « âme noire » ; de l’autre une narration, établie comme stratégie marketing, au service de la promotion d’un produit. J’ai par ailleurs voulu souligner dans quelle mesure cette musique participe de la constitution d’un savoir sur la jeunesse noire américaine au sein d’un dispositif racialo-capitaliste. Mon intérêt était de nuancer les propos de Paul Gilroy, en soulignant que l’évolution des musiques noires américaines actuelles, loin de muter simplement et « brutalement » d’une forme orale à une forme visuelle, devait avant tout se comprendre dans un processus de marchandisation au sein duquel l’expérience noire américaine, exprimée dans les paroles de rap américain, est captée, réifiée puis rationalisée dans un souci de rentabilité économique. Loin de constituer un phénomène nouveau et contradictoire, l’association du commerce et de l’art est un dualisme constitutif de la culture africaine-américaine depuis au moins la naissance du blues. Pour les artistes noirs américains, il s’agit en effet de revêtir un masque ou d’endosser un rôle dans un spectacle pour lequel un public a payé pour y assister. La performance de « nègre », née avec les Minstrel Shows, n’a cessé d’être réactualisée, sous des formes différentes mais toujours sous l’influence des normes dominantes blanches, comme l’a montré l’analyse de la fabrique Motown et de la carrière du rappeur 50 Cent. Elle a permis de voir comment se déroule le processus de négociation entre une « hégémonie blanche et une créativité noire » (Levering, cité dans Baker, ibid. : 842), dont font l’objet les musiques noires américaines dès lors qu’elles s’intègrent dans le marché de la musique. Se pose, au final, la question du sens accordé à ces performances raciales considérées comme véridiques, façonnant la représentation des artistes et des jeunesses noires en général. Face à l’objectivation dont elles font l’objet depuis leur entrée sur le territoire états-unien, comment les générations d’Africains-Américains parviennent-elles à déjouer les assignations identitaires qui tentent d’asseoir leur asservissement aux modèles économiques (esclavagistes, puis capitalistes) déterminant leur existence ? C’est dans le dualisme identitaire et l’interchangeabilité des « masques » (ou performances), comme tradition et mode d’expression d’une capacité d’agir produite par les esclaves et leurs descendants, qu’il faut chercher les stratégies de résistances capables de mettre à mal les mécanismes de domination.
Résumé
Cet article porte sur les effets de la rencontre de deux types de storytelling au sein d’un style de rap – gangsta rap – qui a connu un succès commercial sans précédent aux États-Unis et dans le monde. S’inscrivant dans la tradition orale africaine-américaine de transmission de connaissances sur soi et son milieu, le succès fulgurant du rap a progressivement donné lieu à un repositionnement stratégique de sa production narrative via sa connexion avec un nouvel outil de commercialisation : le marketing narratif. L’« authenticité raciale » fièrement affichée dans les paroles et vidéos de rap répond-elle simplement à l’expression « innocente » de son expérience vécue ou n’est-elle pas une performance de soi assujettie aux intérêts commerciaux escomptés ? Mes propos vont s’appuyer sur une analyse de la carrière de l’artiste 50 Cent et de son célèbre clip « In Da Club » qui souligne à la fois la continuité entre expérience vécue et mise en récit de celle-ci à des fins commerciales, et déconstruit la présupposé « naturalité » d’une masculinité noire, « label de qualité » dans cette musique, habillement manufacturée par l’« industrie du rap ».
[1] Outkast, « Hollywood divorce », Idlewild, Atlanta, La Face Records, 2006.
[2] La Guerre civile au Sierra Léone se déroula de 1991 à 2002. Pour celle du Congo, nous faisons référence à celle de 1998-2002.
[3] Tous deux décrivent abondamment la violence dans leurs paroles comme extension de leur vécu. Après avoir fait l’objet de plusieurs altercations armées, Tupac Shakur mourut dans la violence, en succombant à ses blessures par balle. Il avait alors 25 ans. Quant à Curtis Jackson (50 Cent), il allait également frôler la mort de près (voir infra).
[4] « La double agression et le désespoir décrit dans les textes de Tupac ont à la fois marqué nombre de ces chansons postérieures à sa mort mais ont également offert une bande sonore résonnante aux vies de nombreux jeunes à partir de la fin des années 1990. » (Prestholdt, 2009 : 200 et sq.)
[5] Rap originaire de la côte ouest des États-Unis et qui s’est propagé ensuite à l’ensemble de la scène rap américaine. J’inclus dans cette catégorie le rap dit « mafieux » symbolisé par des artistes comme Kool G Rap, Raekwon ou Rick Ross. J’explicite plus en détail p. 14 et al. Je traduis, ainsi que toutes les citations de ce texte, sauf mention contraire.
[6] On y inclut également les images qui sont aussi, pour Roland Barthes (1957), des formes de discours lorsque celles-ci se transforment en « mythe ».
[7] Dans cet article, je m’arrêterai à la question de la production de la représentation. La transmission, c’est-à-dire la réception et la réappropriation du message (brièvement évoquée dans cette introduction et en conclusion), qui traite de la question de la « puissance d’agir » (agency) donnera lieu à un examen plus approfondi.
[8] Je renvoie à la définition de Roland Barthes : est« mythique » une image faisant office de discours (puisqu’il interpelle le spectateur) et qui tire son apparition d’une histoire manipulée et orientée selon certaines fins.
[9] L’expression « conscience noire » désigne la faculté des Noirs à penser leur condition et leur identité, en l’occurrence ici, sur le territoire états-unien. Parmi les premiers penseurs, on trouve Frederick Douglass et W.E.B. Du Bois.
[10] Je traduis, ainsi que toutes les citations de ce texte, sauf mention contraire.
[11] « Fables rimées mettant en scène la puissance de la parole et attachant une importance prépondérante à l’art de dire (flow), faisant la part belle à l’argot et aux images évocatrices, au sexe et à la violence. Le toast est généralement considéré comme l’ancêtre du rap. » (Béthune, 2004 : 161)
[12] Les plus connus d’entre eux sont Br’er the Rabbit (Brother Rabbit) et The Signifyin’ Monkey – le singe semeur de zizanie.
[13] Le rappeur Jay-z en constitue une parfaite illustration avec un titre comme « U Don’t Know » (The Blueprint, New York, Def Jam Records, 2001).
[14] Littéralement « chansons mélancoliques » en référence aux chansons interprétées par les esclaves et leurs descendances (après l’Abolition de 1865) en réaction au mal-être qui marquait leur existence sur le sol américain. Ces « sorrow songs » sont souvent empreintes d’une dimension religieuse.
[15] Ibid. Comme illustration des sentiments décrits par Du Bois, je propose ces vers tirés d’un Negro Spiritual intitulé There is a Balm in Gilead : « Sometimes I feel discouraged / And think my work’s is vain / But then the Holy Spirit / Revives my soul again. »
[16] En 1949, le journaliste à Billboard Jerry Wexler (devenu ensuite co-dirigeant d’Atlantic) remplaça le terme « race music » par rhythm & blues « plus digne et plus descriptif » (Guralnick, 2008 : 34).
[17] Berry Gordy Jr, allocution tenue à l’Occidental College (Los Angeles, États-Unis) vue sur le site http://www.oxy.edu/x2494.xml, le 10 janvier 2011.
[18] Les spécialistes musicaux comme Peter Guralnick opposaient généralement la Motown au label Stax de Memphis (dans le Tennessee) dont les artistes étaient ouvertement engagés dans la lutte pour les droits civiques. L’un des seuls albums Motown exprimant des revendications à caractère ouvertement politique est le fameux disque What’s Going On (1971) de Marvin Gaye.
[19] Le public puritain et blanc reprochait à certains chanteurs blancs comme Elvis Presley ou Rick Nelson, par exemple, de danser comme des « nègres » en raison de leur déhanché jugé suggestif ou du moins transgressant les normes morales fondées sur la pruderie.
[20] Le terme de « réification » désigne le processus par lequel l’objet fabriqué par le travailleur devient une marchandise mise en vente sur un marché. Il passe alors d’une valeur d’usage à une valeur d’échange (fixée par son prix) permettant à la marchandise d’être échangée contre n’importe quelle autre indépendamment de son usage.
[21] Le « Black Capitalism » est un mouvement né à la fin du xixe siècle (sous l’instigation de Booker T. Washington) en réaction à l’exclusion des Noirs sur le marché de l’emploi. L’idée était de développer un tissu économique capable de fournir aux Noirs des emplois et d’encourager l’entrepreneuriat.
[22] Cf. A New Negro for a New Century édité, en 1900, par Booker T. Washington, Fannie Barrier Williams et N.B. Wood. À ne pas confondre avec le concept de « New Negro » prêté au mouvement Harlem Renaissance et qui a donné lieu à un recueil de textes, du même nom, édité par Alain Locke. Selon Du Bois, ce concept reformulé par les activistes du mouvement se veut une réponse à la pensée de Washington.
[23] Pièce théâtrale apparue dans la première moitié du xixe siècle aux États-Unis et dans laquelle les comédiens (d’abord Blancs puis Noirs) se couvre la peau de cirage noir pour parodier les esclaves (voir dans ce volume la note de lecture sur l’ouvrage de William Lhamon, Peaux blanches, masques noirs, p. 216).
[24] Cf. la campagne de publicités « Rbk » (Reebok) « I am what I am » – slogan fondé sur l’expérience d’artistes (Jay-Z, 50 Cent) et de sportifs – en est une illustration parmi d’autres. Voir aussi des marques d’alcool comme St Ides (marque de bière pur malt).
[25] Cette narration fut popularisée par des rappeurs comme Ice T, NWA ou 2pac sur la côte ouest (Los Angeles), et Jay-Z, Nas, Mobb Deep sur la côte est (New York).
[26] « And the music I be making/I dumb down for my audience/And double my dollars » (« Sur la musique que je compose/ J’l’ai simplifiée pour plaire à mon public/Et doubler mes dollars »), in « Moment of Clarity », Jay-Z, The Black Album, Def Jam Island Music Group, 2003.
[27] Cette idéologie se rapprocherait, dans le cas français, de celle d’une laïcité républicaine qui stigmatiserait le « garçon de cité » et « sa » religion musulmane en raison de ses mœurs « rétrogrades » et menaçant l’égalité républicaine entre les hommes et les femmes (cf. Guenif-Souilamas & Macé, 2004).
[28] Voir l’analyse stimulante que fait Houston A. Baker dans son article « To Move without Moving : An Analysis of Creativity and Commerce in Ralph Ellison’s Trueblood Episode » sur le métayer Trueblood, personnage apparaissant dans le roman de Ralph Ellison Homme invisible, pour qui chantes-tu ?, et qui gagne sa vie en contant astucieusement sa vie dépravée à un public blanc, toujours enthousiaste lorsqu’il s’agit d’entendre un Noir stimuler leur propre fantasme.
[29] Voir l’article de Karima Ramdani, « Bitch et Beurette, quand féminité rime avec liberté », dans ce présent numéro de Volume !
[30] Au côté du « décodage », le « codage » forme un circuit de communication reliant un émetteur à des récepteurs. Le « codage » s’intéresse aux mécanismes de production (matériel, relation de production et structure de connaissances) du message (fait d’un ensemble de signes) émis dans les médias de masse. Les messages proposées sont des types d’identifications que les spectateurs soit reconnaissent et reproduisent, soit négocient en se les appropriant et en les soumettant à leur propre système de pensée ou soit les refusent catégoriquement.
[31] « L’exoticisation des femmes africaines-américaines, décrites comme sauvages, à la promiscuité sexuelle, et amorales, continue d’être normalisée par les descripteurs. Ces représentations sont largement diffusées, acceptées et utilisées pour structurer des idées sur cette population. » (Stephens & Phillips, 2003 : 4) Voir aussi l’ouvrage de bell hooks, Black Looks : Race and Representations (1992).
[32] Voir la campagne de pub « RBK » intitulée « I Am What I Am » : http://www.youtube.com/watch?v=vD5VDnMRj_s
[33] Cf. le making-off in 50 Cent, 50 Cent – The New Breed [vidéo DVD], Los Angeles, Interscope Records, États-Unis, 2003.
[34] Je remercie Cornelia Möser pour cette remarque. Dans la même veine, on trouve le clip de Lil’ Kim, « How many licks » (2000), dans lequel la rappeuse performe la poupée Barbie (au service des besoins masculins), fabriquée dans une chaîne de montage. Par ailleurs, je tiens à préciser que l’« authenticité » constitutive de ce type de rap n’en est qu’une parmi tant d’autres, et que cette dernière entre elle-même en concurrence avec d’autres types d’« authenticité » – celle, par exemple, qui fonde le rap conscient (autour d’artistes comme Lupe Fiasco, Talib Kweli ou encore Dead Prez) et qui repose sur une critique sociale de la société américaine.