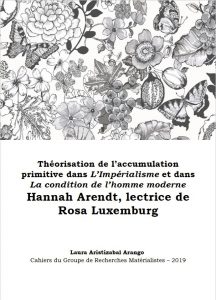Lien vers la brochure en pdf : Arendt-Accumulation
Lire le texte original (anglais) sur Les Cahiers du GRM
Texte de la brochure :
L’évidence d’un héritage
En 1948, paraît L’Impérialisme, deuxième tome des Origines du totalitarisme dans lequel Arendt étudie les causes et les mécanismes de la politique impérialiste européenne de la fin du 19e siècle en tant qu’elle constitue à ses yeux, au même titre que l’antisémitisme, l’un des éléments structurels du totalitarisme. Les études qui portent sur ce tome des Origines du totalitarisme ont relevé qu’Arendt construit son étude de l’impérialisme en héritant des thèses que Rosa Luxemburg avance dans L’accumulation du capital (1913) à propos de l’accumulation primitive du capital. Cette évidence vient des textes mêmes d’Arendt : non seulement dans L’Impérialisme Arendt mentionne les « brillantes recherches de Luxemburg à propos de la structure politique de l’impérialisme » mais, en outre, en 1966, Arendt consacre un texte-hommage à Rosa Luxemburg, dans lequel elle affirme, contre les critiques marxistes « orthodoxes » de Luxemburg, que L’accumulation du capital était une « description éminemment fidèle des choses telles qu’elles se produisaient en réalité ». Par la suite, de nombreux·ses commentateur·rices ont rappelé la dette d’Arendt vis-à-vis de la compréhension luxemburgienne de l’accumulation primitive. Pour n’en citer que quelques-un·es : Elisabeth Young-Bruehl remarque dans la biographie qu’elle consacre à Hannah Arendt (1999) que les thèses de Luxemburg sur l’impérialisme étaient pour Arendt un outil théorique non seulement dans la compréhension de l’impérialisme européen de la fin du 19e siècle mais aussi dans celle de l’impérialisme américain au Vietnam et en Amérique latine ; David Harvey, quant à lui, situe ses thèses sur « l’accumulation par dépossession » dans une généalogie qu’il fait remonter à Rosa Luxemburg et à Hannah Arendt ; pour sa part, Anne Amiel rappelle que dans L’Impérialisme Arendt dialogue avec « l’historiographie marxienne – à commencer par Rosa Luxemburg envers laquelle elle est débitrice ».
Pourtant, dans L’Impérialisme, Arendt ne cite L’accumulation du capital de Luxemburg que par deux fois, dans des notes de bas de page et sans s’arrêter longuement sur ses thèses. Comment comprendre l’évidence d’un héritage luxemburgien dans L’Impérialisme alors même que le texte d’Arendt ne recourt que très peu à Luxemburg ? Notre propos sera de rendre intelligible la transmission entre ces autrices. Comment ont fonctionné chez Arendt les emprunts qu’elle a faits à Luxemburg concernant le problème de l’accumulation primitive du capital ? Comment, donc, Arendt a forgé sa propre pensée de l’impérialisme en déplaçant et en renversant les thèses qu’elle emprunte à L’accumulation du capital ? Nous proposons de répondre à ces questions en lisant L’Impérialisme à la lumière de l’anthropologie qu’Arendt proposera quelques années après son étude du totalitarisme dans La condition de l’homme moderne (1958). Nous soutenons que la question de l’accumulation primitive, essentielle dans L’Impérialisme, est retravaillée dans l’anthropologie arendtienne : cela permet un retour sur des problèmes qui étaient implicites dans L’Impérialisme mais qu’Arendt ne thématisait pas encore comme tels. Nous pensons que ce retour vers l’héritage luxemburgien d’Arendt dans L’Impérialisme à la lumière des thèses de La condition de l’homme moderne permet de saisir dans toute sa radicalité le propos d’Arendt sur l’accumulation primitive, sur la formation des États-nations en Europe et sur l’expansion impérialiste et sa politique raciste.
Notre propos s’articule autour de deux temps majeurs : un temps consacré à Luxemburg et un temps consacré à Arendt. Nous commencerons par introduire la conception arendtienne de l’impérialisme afin de mettre en évidence qu’elle se construit à partir de la lecture que fait Rosa Luxemburg de l’accumulation primitive. Nous étudierons les critiques que Luxemburg adresse à Marx et les solutions qu’elle propose à ce qu’elle considère comme des impasses du marxisme. À ce stade, nous aurons les outils pour aborder la traduction qu’Arendt fait des thèses de Luxemburg dans les termes de son anthropologie de La condition de l’homme moderne. Cela nous permettra de comprendre ce qu’Arendt voit comme l’enjeu politique majeur du bouleversement de la condition humaine à la modernité : la fondation du politique sur la nation. Sur cette base, nous pourrons alors opérer un retour à L’Impérialisme afin d’expliciter ce qu’est, pour Arendt, la politique impérialiste de l’accumulation illimitée du pouvoir fondée sur le racisme d’État. Nous conclurons alors en soulignant l’intérêt de ces thèses aujourd’hui pour les pensées de la domination politique du capitalisme, en particulier pour les postcolonial et les gender studies.
La théorie luxemburgienne de l’impérialisme : relecture du chapitre 24 du Livre 1 du Capital
Chez Arendt, l’impérialisme renvoie à deux phénomènes de la fin du 19e siècle : l’impérialisme colonial des pays d’Europe occidentale (Angleterre, France, Belgique, Allemagne, Italie) et l’impérialisme continental d’Europe orientale fondé sur les mouvements annexionnistes comme le panslavisme et le pangermanisme. C’est la première définition de l’impérialisme qui retiendra ici notre attention. L’impérialisme colonial désigne chez Arendt la « mêlée pour l’Afrique (scramble for Africa) », l’occupation de l’Afrique (mais aussi de l’Asie, bien qu’Arendt s’intéresse surtout à l’Afrique) par les pays d’Europe occidentale. Cette occupation devient une politique officielle européenne lors de la conférence de Berlin de 1884, mais elle avait en réalité débuté, selon Arendt, entre 1870 et 1880, décennie pendant laquelle des mines d’or et de diamants furent découvertes en Afrique du Sud, qu’Arendt désigne alors comme « le berceau de l’impérialisme ». Arendt souligne que :
Les dépressions des années 1860 et 1870, qui ont ouvert l’ère de l’impérialisme, ont joué un rôle décisif en contraignant la bourgeoisie à prendre conscience pour la première fois que le péché originel de pillage pur et simple qui, des siècles auparavant, avait permis « l’accumulation originelle du capital » (Marx) et amorcé toute l’accumulation à venir, allait finalement devoir se répéter si l’on ne voulait pas voir soudain mourir le moteur de l’accumulation.
Ce passage est majeur pour comprendre le cadre de pensée à partir duquel Arendt pense l’impérialisme : d’abord, parce qu’Arendt y est explicite sur la référence au problème de l’accumulation primitive théorisé par Marx ; ensuite, parce qu’Arendt y soutient que l’accumulation dite « primitive » n’est pas seulement un phénomène qui « amorce » le mode de production capitaliste, mais est aussi un phénomène dont la répétition est nécessaire à la survie même du mode de production capitaliste. Cette dernière thèse est un héritage dans la pensée arendtienne de la théorisation de l’impérialisme que Rosa Luxemburg propose en 1913 dans un texte majeur : L’accumulation du capital. Contribution à l’explication économique de l’impérialisme (Die Akkumulation des Kapitals. Ein Beitrag zur ökonomischen Erklärung des Imperialismus).
Rosa Luxemburg, marxiste dissidente
Rosa Luxemburg fonde L’accumulation du capital sur une critique qu’elle adresse au Livre II du Capital de Marx. Dans ce texte, Marx fonde son étude de l’histoire et de la logique de la reproduction du capitalisme sur l’hypothèse qu’« il n’y a que deux classes : la classe capitaliste et la classe ouvrière ». Marx présupposait qu’il était possible d’étudier le capitalisme sans considérer les rapports du capitalisme avec les modes de production non capitalistes. Luxemburg remarque qu’« il ne s’agissait cependant pour Marx que d’une hypothèse théorique, destinée à simplifier et faciliter l’étude des problèmes ». Cette hypothèse de travail n’est pas problématique, selon Luxemburg, si elle est adoptée dans l’étude des rapports d’exploitation au sein de l’usine, du point de vue des capitalistes individuels – ce que fait Marx dans le Livre I du Capital. Par contre, cette hypothèse, selon Luxemburg, est inutile voire « gênante » lorsqu’on étudie la reproduction du capitalisme du point de vue de la société dans son ensemble. En ce sens, la critique que Luxemburg adresse à Marx constitue surtout une réponse à « ce que les épigones ont fait de la théorie marxiste ». Luxemburg est très critique à l’égard des marxistes « orthodoxes » pour lesquels les thèses de L’accumulation du capital étaient fausses dans la mesure où elles mettaient en question le Livre II du Capital : pour l’autrice, ils faisaient l’erreur de dresser en dogme une hypothèse de travail, alors même que cela contredisait la réalité de la reproduction capitaliste :
Personne n’ignore qu’un pays dominé exclusivement par la production capitaliste (…) n’existe pas encore et n’a jusqu’à présent existé nulle part. La société évoquée par l’hypothèse du deuxième livre du Capital ne se rencontre jamais dans la réalité. Et malgré tout cela, les « experts » officiels du marxisme déclarent que le problème de l’accumulation est inexistant et que Marx a définitivement tout résolu !
Pour Luxemburg, si, comme les « épigones » de Marx, on s’obstine à garder cette hypothèse pour comprendre la reproduction du capital social total, on en arrive non seulement à une impasse théorique, mais aussi à l’impossibilité de comprendre la réalité de la logique et de l’histoire du capitalisme – et donc, dit Luxemburg, on ne comprend pas non plus l’impérialisme. Luxemburg affirme que l’hypothèse de Marx mène à l’impasse théorique car elle ne permet pas de comprendre comment peut avoir lieu la reproduction de la société capitaliste – ce que Marx théorise sous le nom d’accumulation élargie du capital. Cette dernière consiste en effet en une « utilisation de la survaleur comme capital ou la retransformation de la survaleur en capital ». Cependant, dit Luxemburg, « pour obtenir ce résultat, la volonté des capitalistes ne suffit pas. Le processus est lié à des conditions sociales objectives ». Selon Luxemburg, ces conditions sociales objectives sont, d’une part, une quantité suffisante de force de travail ; d’autre part, l’existence de débouchés pour la vente des marchandises permettant de réaliser la survaleur. Or, Luxemburg montre que si l’on s’en tient à l’hypothèse marxienne de l’exclusivité du capitalisme, on doit affirmer que la survaleur est réalisée au sein même du monde capitaliste. Mais il est bien connu que selon Luxemburg cela est impossible car, comme l’ont remarqué David Harvey et, avant lui, Michael Bleaney et Anthony Brewer, la théorie de Luxemburg se fonde sur la thèse de la sous-consommation, c’est-à-dire de « la carence générale d’une demande effective suffisante pour absorber la croissance de la production générée par le capitalisme ». Selon Luxemburg, en effet, ni les capitalistes ni les ouvriers ne peuvent réaliser la survaleur : si les premiers le font, ce serait un « suicide économique » dans la mesure où ils consommeraient ce qui précisément est supposé être réinvesti pour accumuler le capital ; les seconds ne peuvent pas être considérés comme des « acheteurs » car ce qu’ils consomment est le strict nécessaire à la survie. C’est pourquoi, selon Luxemburg, il est impossible de comprendre comment la reproduction élargie du capital a lieu si on ne tient pas compte des rapports réels entretenus par les économies capitalistes avec les économies non capitalistes. Bien que la thèse luxemburgienne de la sous-consommation soit aujourd’hui considérée comme erronée, les thèses de L’accumulation du capital restent précieuses dans la mesure où Luxemburg tente de comprendre la logique des rapports entre sociétés capitalistes et sociétés non capitalistes – ce qui nous mène à ce que Luxemburg voyait comme une deuxième impasse dans la théorie de Marx : son hypothèse de l’exclusivité du capitalisme manque la réalité historique de ce mode de production. Luxemburg affirme qu’« en réalité, il n’a jamais existé et il n’existe nulle part de société capitaliste se suffisant à elle-même et entièrement régie par le mode de production capitaliste ». L’accumulation du capital étaye cette thèse par un rappel de la situation du capitalisme européen dans le monde au début du 20e siècle : il y avait en Europe des pays non capitalistes où dominait l’économie paysanne (en Russie, aux Balkans et en Espagne), et, à l’exception de certains pays d’Europe et de l’Amérique du Nord, la plupart des régions du monde fonctionnaient de manière non capitaliste. Luxemburg ajoute :
Non seulement toutes ces formes de sociétés et de production subsistent et ont subsisté à côté du capitalisme sur le mode d’une tranquille coexistence, mais, depuis le début de l’ère capitaliste, on a vu se développer entre elles et le capital européen des relations d’échange très intenses d’un ordre particulier.
Par conséquent, si l’on veut comprendre la logique et l’histoire de l’accumulation du capital, il faut, selon Luxemburg, abandonner l’hypothèse de Marx d’une société entièrement dominée par le mode de production capitaliste. Luxemburg revient alors aux thèses sur la « prétendue ‘accumulation primitive’« (Die sogennante ursprüngliche Akkumulation) du chapitre 24 du Livre I du Capital dans la mesure où c’est là que Marx pose la question des rapports entre les sociétés capitalistes et les sociétés non capitalistes.
Les thèses de ce chapitre du Capital sont bien connues : Marx y avance que le « fondement historique du capitalisme » est l’inégalité entre deux possesseurs de marchandises – le capitaliste, propriétaire des moyens de production, et le prolétaire, qui ne possède que sa force de travail. Cette inégalité vient, selon Marx, de l’expropriation des moyens de production subie par les travailleurs au profit de l’accumulation de ces mêmes moyens par les capitalistes. Dans le chapitre 24 du Livre I du Capital, l’accumulation primitive consiste donc dans le processus historique d’expropriation qui, aux 15e et 16e siècles, a eu pour résultat la concentration des moyens de production dans les mains des capitalistes ainsi que l’obligation pour les expropriés de vendre leur force de travail aux premiers. Le chapitre 24 du Livre I du Capital étudie ce processus historique d’expropriation et de prolétarisation massives aussi bien au sein de la société féodale européenne que dans les territoires occupés par le colonialisme européen : Marx montre ainsi que la mise en place du mode de production capitaliste exige la destruction des modes de production non capitalistes. L’accumulation primitive est donc un moment d’extrême violence et de destruction qui, selon Marx, a lieu par l’intervention du pouvoir de l’État : la mise en place du mode de production capitaliste exige « le pouvoir de l’État, la violence concentrée et organisée de la société, pour activer artificiellement le procès de transformation du mode de production féodal en mode de production capitaliste et pour en abréger les transitions ». Cette accumulation primitive constitue selon Marx « la préhistoire du capitalisme », ce qui signifie que la violence politique brutale mise en place par l’État lors de l’expropriation des travailleurs n’est, d’après ce chapitre 24, qu’un moment ponctuel qui rend possible le capitalisme et qui le précède comme tel. Comme chacun sait, cela ne signifie nullement chez Marx que la violence disparaîtrait une fois le capitalisme installé. Certes, selon Marx, elle n’existe plus principalement dans sa forme brutale, éclatante et spectaculaire, mais elle persiste sous la forme plus insidieuse des rapports de production capitalistes – la tâche du Livre I du Capital est précisément de mettre au jour cette violence cachée dans l’économie capitaliste. Pour Marx, la violence politique mise en place lors de la « préhistoire du capitalisme », si elle ne disparaît pas complètement de l’histoire du capitalisme, en fait partie d’une manière qui n’est plus spectaculaire, qui est même implicite dans la mesure où elle est intégrée dans les rapports juridiques qui soutiennent l’exploitation capitaliste : la violence politique passe ainsi pour « légitime » et n’est censée s’exercer que de manière « exceptionnelle » lorsque les rapports de production capitaliste sont remis en question.
Mise au jour par Luxemburg de la domination politique inhérente au capitalisme
Luxemburg relit cette théorisation marxienne de la prétendue accumulation primitive dans la perspective d’une étude de l’impérialisme. L’autrice soutient que « le capitalisme a besoin pour son existence et son développement de formes de production non capitalistes autour de lui » ou encore que « le capitalisme, même dans sa phase de maturité, est lié à tous les égards à l’existence de couches et de sociétés non capitalistes ». Cette thèse majeure de L’accumulation du Capital revient à affirmer, comme Marx, que l’accumulation n’est que prétendument « primitive ». Mais la raison qu’avance Luxemburg est différente de celle qu’avance l’auteur du Capital : cette accumulation n’est que soi-disant « primitive » dans la mesure où, loin d’être un moment « initial » du mode de production capitaliste, elle décrit en réalité la logique même selon laquelle ce dernier fonctionne. C’est pourquoi il ne faut pas étudier les phénomènes rangés sous la catégorie d’accumulation primitive comme ce qui appartient à un passé ponctuel dont on pourrait ne plus tenir compte dans la réflexion sur le développement historique du capitalisme : en réalité ces phénomènes de violence politique brutale ne cessent de faire retour au sein de l’histoire du capitalisme, dans la mesure où ils sont au cœur de son fonctionnement. À ce titre, soulignons que Luxemburg ne dit pas simplement que le capitalisme a besoin de « sociétés » non capitalistes externes aux sociétés capitalistes, mais elle souligne que le mode de production capitaliste dépend aussi des couches non capitalistes au sein même des sociétés capitalistes, d’où son insistance sur la coexistence, au sein même de l’Europe, de régions capitalistes avec des régions non capitalistes. Comme le remarque Anthony Brewer à propos de Luxemburg, « le monde est divisé en États-nations, colonies etc., mais il est aussi divisé en un secteur capitaliste et un secteur non capitaliste, et c’est cette dernière division qui est importante pour son propos ». L’accumulation du Capital ne conçoit pas le capitalisme comme un phénomène interne à certains pays qui se serait ensuite étendu vers d’autres territoires une fois que l’économie de ces pays fonctionnerait entièrement selon ce mode de production : l’étude de Luxemburg ne se réduit pas à l’histoire de l’extension du capital dans le monde. Son projet est bien plus radical dans la mesure où Luxemburg étudie la tendance inhérente de la logique capitaliste reposant sur et reproduisant la division entre secteurs capitalistes et secteurs non capitalistes. De cette étude, Luxemburg conclut que le capitalisme fonctionne selon une logique de dépendance à l’égard de tout ce qui n’est pas le mode de production capitaliste : ce mode de production est intrinsèquement tourné vers son dehors car, fondé sur le réinvestissement infini de la survaleur, il est incapable de fournir les conditions de sa propre reproduction. En d’autres termes, dès son émergence, le capitalisme vise le monde entier. C’est pourquoi, pour Luxemburg la logique du mode de production capitaliste est intrinsèquement impérialiste : l’impérialisme n’est pas seulement un moment historique de l’accumulation du capital, il est la logique même de fonctionnement du mode de production capitaliste car ce dernier ne peut exister que par la prédation de son dehors. Pour Luxemburg, la survie du capitalisme tient à ce que ce dernier « impérialise » tout ce qui relève de logiques non capitalistes. C’est pour cette raison que l’accumulation primitive du capital renvoie certes aux origines historiques du mode de production capitaliste, mais en tant que, pour reprendre le mot d’Étienne Balibar,« les origines ne cessent de faire retour au sein de la structure ». Selon Luxemburg :
L’accumulation primitive, qui est la première phase du capitalisme en Europe de la fin du Moyen-âge jusqu’au milieu du XIXe siècle, a trouvé dans l’expropriation des paysans en Angleterre et sur le continent la meilleure méthode pour transformer massivement les moyens de production et les forces de travail en capital. Or le capital pratique aujourd’hui encore ce système sur une échelle autrement plus large, par la politique coloniale.
Selon cette thèse, le phénomène historique de l’impérialisme de la fin du 19e siècle est donc l’expression à l’échelle planétaire de la logique selon laquelle fonctionne le capitalisme depuis son émergence : l’impérialisme comme phénomène historique est donc fondé sur la logique impérialiste du mode de production capitaliste. En ce sens, la violence politique soulignée par Marx à propos de cette soi-disant accumulation primitive est en réalité « une méthode permanente de l’accumulation » : elle est donc nécessaire à la logique impérialiste du capitalisme et à son histoire. C’est ainsi que Luxemburg comprend la violence brutale et spectaculaire de l’impérialisme européen de la fin du 19e siècle : comme lors de l’accumulation primitive en Europe au 16e siècle, le capitalisme procède, pour son existence, à l’expropriation des populations, à des privatisations des terres qui leur sont communes, à la prolétarisation, aux massacres, à la guerre (contre les sociétés non capitalistes mais aussi des pays capitalistes entre eux). Ces phénomènes sont donc inhérents au mode de production capitaliste.
En ce sens, selon Luxemburg, ce n’est qu’en tant que phénomène duel, à la fois d’exploitation économique et de violence politique, que l’on peut comprendre l’histoire du capitalisme. Pour le formuler comme David Harvey, l’accumulation élargie du capital et l’accumulation par dépossession (nom qu’il donne à l’accumulation primitive) doivent être comprises comme « dialectiquement combinées ». Selon Luxemburg, l’aspect économique concerne l’échange marchand entre capitalistes et ouvriers, et dans cette perspective, nous pourrions considérer, d’après l’hypothèse formulée par Marx, que la reproduction du capital a lieu dans un monde exclusivement composé de capitalistes et d’ouvriers. Le mérite de Marx est d’avoir décelé la violence qui se dissimule dans les rapports de production capitaliste :
Il a fallu toute la dialectique acérée d’une analyse scientifique pour découvrir comment, au cours de l’accumulation, le droit de propriété se transforme en appropriation de la propriété d’autrui, l’échange de marchandises en exploitation, l’égalité en domination de classe.
Luxemburg considère, quant à elle, qu’on ne peut comprendre la logique de l’accumulation du capital si on ne considère pas le rapport de la société capitaliste avec les sociétés non capitalistes, c’est-à-dire la logique impérialiste propre à l’accumulation et sa violence politique. En ce sens, alors que la violence de l’aspect purement économique a nécessité l’analyse « dialectique acérée » de Marx pour être mise à jour, l’aspect politique de l’accumulation se manifeste par la violence ouverte :
La violence, l’escroquerie, l’oppression, le pillage se déploient ouvertement, sans masque, et il est difficile de reconnaître les lois rigoureuses du processus économique dans l’enchevêtrement des violences et des brutalités politiques.
Le phénomène historique de l’impérialisme du 19e siècle met au jour la logique impérialiste de l’accumulation ainsi que sa nécessité de recourir à une violence politique qui, contrairement à la violence dissimulée de l’échange économique, est manifeste, trop manifeste, à un point tel qu’il est difficile de voir l’échange économique qu’elle est censée permettre. Luxemburg identifie ainsi le fait que l’accumulation du capital, du fait de sa tendance à coloniser son dehors, comporte une dimension de pure violence, c’est-à-dire une violence excédentaire par rapport à toute « explication » de type économique. On voit donc que la violence politique brutale fait pleinement partie du fonctionnement du mode de production capitaliste. Dans la mesure où cette violence politique est ce par quoi le capitalisme absorbe son dehors, c’est-à-dire ce par quoi il lui est possible d’asseoir les rapports de production qui lui sont propres, elle est présentée par Luxemburg comme l’instrument privilégié de la dynamique capitaliste.
Reprise et renversement par Arendt des thèses luxemburgiennes sur l’accumulation primitive
Selon Arendt, l’apport décisif de Luxemburg à la compréhension de l’impérialisme est sa découverte de la « structure politique » de l’accumulation du capital – ce que nous avons appelé la logique impérialiste propre au capitalisme : le fait que l’accumulation capitaliste « se nourrit de tout ce qui est extérieur ». Sur ce point, Arendt est débitrice des thèses luxemburgiennes : dans L’Impérialisme, la singularité de la conception arendtienne de ce phénomène est de prendre toute la mesure de sa nature proprement politique. Aux yeux d’Arendt, la « dépendance fondamentale du capitalisme vis-à-vis d’un monde non capitaliste se retrouve à la base de tous les autres aspects de l’impérialisme ». Contre Marx et le marxisme, Arendt affirme que l’accumulation capitaliste est incapable de se développer à partir d’elle-même. « L’expropriation doit être répétée de temps à autre pour maintenir le système en marche » : l’impérialisme de la fin du 19e siècle est une manifestation de cette logique. Selon Arendt, ce n’est qu’à partir de ce fait fondamental de la dynamique capitaliste que l’on peut comprendre les crises connues par les pays européens à la fin du 19e siècle, quelle que soit par ailleurs la forme que ces crises ont pu prendre d’un point de vue économique, et que l’on peut expliquer de différentes manières.
En réhabilitant le travail de Rosa Luxemburg par la mise en avant de la dimension politique que cette autrice décèle dans la logique et l’histoire du mode de production capitaliste, Arendt procède à une radicalisation des thèses de L’accumulation du capital, ce qui marque en même temps sa prise de distance par rapport au texte de Luxemburg.
Lecture anthropologique de la « prétendue ‘accumulation primitive’ » dans La condition de l’homme moderne
Alors que Luxemburg conçoit les effets de l’expropriation des individus en termes de « prolétarisation », Arendt conçoit cette expropriation dans les termes anthropologiques et politiques de ce qu’elle définit comme « l’aliénation par rapport au monde (world alienation) ». Comme Luxemburg, Arendt affirme que « l’expropriation et l’accumulation de la richesse ont été réintroduites dans le processus afin d’engendrer d’autres expropriations, une plus grande productivité et encore plus d’appropriation ». Mais Arendt aborde ce problème depuis une perspective différente – celle, anthropologique, de La condition de l’homme moderne. Pour Arendt, les expropriés perdent ce qu’elle appelle le « domaine privé », c’est-à-dire « une parcelle du monde qui, jusqu’à l’époque moderne, avait abrité le processus vital individuel et l’activité de travail soumise à ses nécessités ». Arendt définit ce domaine comme le lieu de l’activité d’entretien de la vie biologique (zôè) – ce qu’elle nomme le « travail ». Ce domaine privé est matérialisé dans ce qu’Arendt appelle la « propriété privée » qui ne renvoie pas à la possession de richesses et de biens matériels et immatériels, mais à la cellule familiale dans laquelle chaque individu se voit attribuer une place dans le monde. À partir de là, on peut prendre la mesure de ce que signifie l’expropriation dans la compréhension arendtienne de l’accumulation primitive : être exproprié, cela signifie d’abord perdre la possibilité de subvenir à ses besoins par son propre travail. En ce sens, l’assouvissement des besoins vitaux par le travail ne va plus de soi. Ce point est décisif, car c’est lui qui permet de comprendre la thèse célèbre d’Arendt selon laquelle, à la modernité, les êtres humains sont tout entier dévoués au travail, au point d’être définis par le travail : c’est ce point qui permet de comprendre l’affirmation selon laquelle l’être humain moderne est, d’abord, un animal laborans. Si le sujet moderne arendtien est un travailleur et un consommateur – un individu chez qui la vie biologique a pris le dessus par rapport aux autres activités – c’est parce que la préoccupation principale des individus expropriés sera l’assouvissement de leurs exigences vitales, c’est-à-dire le travail. En d’autres termes, le travail devient d’autant plus central que, paradoxalement, son évidence est mise en crise par l’expropriation. Si les modernes accordent donc une telle importance à l’individu en tant qu’il travaille, ce n’est pas, pour Arendt, parce qu’ils seraient incapables de comprendre la grandeur de la politique : c’est le résultat d’un processus matériel de destruction du travail et de ses conditions, qu’Arendt comprend, par le détour de sa lecture de l’accumulation primitive, depuis Marx, quelles que soient les distances qu’elle prenne par ailleurs à son égard sur cette même question du travail. Quelles sont les conséquences de ce processus selon Arendt ?
Arendt soutient que le travail est l’activité humaine « la plus étrangère-au-monde (least worldly) » : le travail replie notre attention sur notre corps et nos besoins vitaux, car lorsqu’on travaille, on est « captif de la satisfaction de besoins que nul ne peut partager et que personne ne saurait pleinement communiquer ». Ainsi, l’individu moderne travaillant est rejeté en lui-même car toute son existence est orientée par l’urgence de ses besoins : le repli sur soi de l’individu travaillant est un repli sur ses propres nécessités, auxquelles se résume son existence. C’est ainsi qu’on comprend cette thèse décisive d’Arendt : « l’expropriation et l’aliénation par rapport au monde coïncident ». Si la propriété garantissait l’inscription des individus dans un milieu familial et, pour certains (les hommes libres), dans un milieu politique, l’expropriation crée des individus qui sont étrangers au monde, aliénés par rapport au monde, parce que contraints de passer tout leur temps à assurer leur existence. Arendt pense cette question de l’aliénation par rapport au monde depuis les théorisations sur la prétendue accumulation primitive de Rosa Luxemburg : si la dynamique du capitalisme est celle de la perpétuelle prédation des secteurs non capitalistes, alors cette dynamique est aussi celle de la perpétuelle aliénation par rapport au monde de ces mêmes secteurs. En d’autres termes, non seulement la violence politique de l’accumulation primitive dépouille violemment les êtres humains de leurs moyens de production, mais elle les aliène aussi par rapport au monde. Bien plus, puisque l’aliénation par rapport au monde va de pair avec l’expropriation capitaliste, laquelle, comme nous l’avons vu, vise toujours son dehors, l’aliénation par rapport au monde est aussi, d’emblée, un phénomène qui vise toute la planète. Ce que nous avons appelé la logique impérialiste du capitalisme porte en elle, selon Arendt, l’aliénation par rapport au monde. C’est pourquoi Arendt affirme que le processus d’expansion de l’accumulation du capital « reste lié au principe qui lui a donné naissance : celui de l’aliénation par rapport au monde ». C’est en ce sens que pour Arendt la modernité est marquée par la perte que les individus subissent de leur place dans le monde, perte qu’Arendt résume dans l’expérience du déracinement, défini ainsi dans Le système totalitaire (1951) : « être déraciné, cela veut dire n’avoir pas de place dans le monde, reconnue et garantie par les autres ». Retenons donc ceci : ce qui est perdu avec l’expropriation, c’est à la fois une place matérielle qui assure la subsistance, et une place relationnelle, assurée par la fonction que remplissent les individus au sein du domaine privé ainsi que par la reconnaissance du fait que cette place leur appartient.
Effets de l’expropriation sur le domaine public : l’avènement de la nation
Plus largement, selon Arendt, à la modernité, ce sont toutes les « conditions de base dans lesquelles la vie sur terre est donnée à l’homme » qui sont bouleversées : outre le travail, l’appartenance-au-monde (worldliness) et la pluralité (plurality) sont aussi mises en crise. Ces concepts de La condition de l’homme moderne sont bien connus : l’appartenance-au-monde et la pluralité sont étroitement liées dans la mesure où la première concerne le monde des objets et le réseau des relations qui relient et séparent les êtres humains pluriels, c’est-à-dire fondamentalement singuliers. Cette pluralité à la fois reliée et séparée est, pour Arendt, la condition de la politique. Or, l’animal laborans, ne produisant que ce qu’il consomme immédiatement et replié sur ses besoins biologiques, ne fabrique pas d’objets durables ni n’est capable d’établir des relations autres que celles nécessaires à la subsistance : les animales laborantes sont des « spécimens qui foncièrement sont tous semblables parce qu’ils sont ce qu’ils sont simplement en tant qu’organismes vivants ». En ce sens, une communauté fondée sur le travail se réduit à la juxtaposition d’individus identiques et interchangeables : chez Arendt ce type de communauté, qui advient à la modernité avec l’expropriation, porte le nom de « société ». En cette dernière a lieu à la fois le travail des expropriés et l’accumulation des capitaux. C’est pourquoi, selon Arendt, la société est marquée par la polarisation entre deux classes : le prolétariat et la bourgeoisie. Arendt affirme que la fonction des classes est d’assurer à leurs « membres la protection que la famille procurait autrefois aux siens ». Cela signifie que la société offre un nouvel enracinement aux individus au sein des classes, classes où ces individus prennent place du fait de leur travail. Selon Arendt ce type d’organisation des individus aboutit à la négation de la pluralité et donc à la négation de l’action, qui est l’être même du politique : c’est pourquoi Arendt affirme que l’animal laborans est un être antipolitique, incapable d’instituer un « domaine public » dans lequel les êtres humains sont directement au contact les uns des autres sans la médiation du travail. En ce sens, pour Arendt, l’expropriation du domaine privé a aussi pour conséquence la destruction du domaine public tel qu’il existe avant la modernité, car ce qui était logé dans le privé est projeté sur le domaine public : le travail, à travers la société, est projeté dans le domaine public, mais y sont projetés aussi les rapports à autrui sur le mode familial. C’est que, si les classes sociales constituent le nouvel enracinement des individus expropriés, elles mettent aussi la société en danger d’implosion, en raison de leurs intérêts divergents. D’où l’émergence, à la modernité, de la nation en tant que projection des rapports modelés par la famille dans le domaine public : cette projection fonctionne comme un lien censé transcender les appartenances de classe. La nation est ainsi définie par Arendt comme la « forme politique d’organisation » d’« un ensemble de familles économiquement organisées en un fac-similé de famille supra-humaine ». La nation est donc, pour Arendt, le lieu où le public est pensé suivant un schème ordonnant les rapports propres au privé : « partout la nation exige l’homogénéité de la population enracinée dans le sol de tel ou tel territoire ». La nation devient donc le foyer, famille et parcelle du monde, unifiant les classes sociales par l’idée d’une origine commune et par l’identification à un territoire commun, le territoire national, représenté comme une « propriété collective (collective ownership) ».
L’enracinement de l’appartenance de classe est donc doublé d’un enracinement de l’appartenance à la nation. Mais pour Arendt, il est nécessaire en même temps de comprendre que la nation relève du fantasme : en ce sens, la nation n’offre à ses membres une place dans le monde que sur un mode qui s’avère, en dernière analyse, insatisfaisant, précaire et, de fait, provisoire. En effet, un groupe humain ne peut s’organiser en nation qu’en présupposant une forme d’homogénéité de ses membres. Homogénéité de leurs opinions et de leurs intérêts : « la société exige toujours que ses membres agissent comme s’ils appartenaient à une seule énorme famille où tous auraient les mêmes opinions et les mêmes intérêts ». Homogénéité aussi de leur « origine », censée être commune : « l’intérêt de la nation en tant que totalité était prétendument garanti par le fait d’une origine commune qui trouvait son expression sentimentale dans le nationalisme ». Or, comme l’affirme Étienne Tassin : « Si la communauté [au sens des communautés d’appartenance familiales] est par définition le plus homogène possible, le domaine public est par définition le plus hétérogène possible. L’espace public est impropre, espace d’impropriété commune ; et c’est seulement en ce sens qu’il peut être dit commun ». L’homogénéité va donc à l’encontre de la définition arendtienne du politique qui est pluriel et donc hétérogène. En ce sens, la nation ne peut être une entité politique que de manière fantasmée. En outre, le remplacement par la nation de la propriété privée est aussi fantasmé car il n’existe pas en réalité une telle « propriété collective » : le territoire de la nation n’empêche pas l’aliénation par rapport au monde, tout simplement parce que dans les faits l’individu reste un exproprié privé d’une parcelle du monde où il peut subvenir à ses besoins. Comme l’affirme Arendt, au sein de la nation, « tout ce dont on avait besoin c’était de travailler, d’assurer son existence et celle de sa famille » : l’activité principale des individus au sein de la nation continue d’être la prise en charge de ce qui ne va plus de soi – l’entretien de la vie, le travail. C’est pourquoi, le remplacement de la famille par la nation peut « pallier la cruauté et la misère, mais il n’eut guère d’influence sur le processus d’expropriation et d’aliénation par rapport au monde ». La parcelle du monde perdue avec l’expropriation ne peut pas être remplacée par la nation car d’une part, politiquement, celle-ci se fonde sur le fantasme d’un lien familial entre ses membres, et d’autre part, matériellement, elle est incapable de fournir les conditions objectives d’enracinement dans le monde. C’est précisément ce qui apparaît avec l’avènement de l’impérialisme.
L’impérialisme, un phénomène politique
Cette conception de la modernité comme bouleversement anthropologique et politique de la condition humaine offre à Arendt un angle de lecture anthropologico-politique de l’impérialisme. Sur ce point, Arendt radicalise les thèses de L’accumulation du capital. Certes, pour Luxemburg le capitalisme est un phénomène « duel » mais sa dimension politique fonctionne comme « l’instrument et le véhicule du processus économique ». On peut, en forçant le trait, dire qu’Arendt renverse les termes de cette approche : la politique doit être au centre de l’étude de l’impérialisme et l’économique en dépend. En effet, selon Arendt, l’accumulation du capital n’est possible que parce qu’une politique proprement impérialiste se met en place. « Seule l’accumulation illimitée du pouvoir était capable de susciter l’accumulation illimitée du capital » car « l’exportation d’argent et l’investissement à l’étranger ne sont pas en eux-mêmes l’impérialisme, et ne mènent pas nécessairement à l’expansion érigée en système politique ». Aussi, Arendt montre que c’est sous la pression des nécessités du mode de production capitaliste qu’une nouvelle politique se met en place, qui est capable d’établir les conditions nécessaires pour que l’accumulation du capital puisse se déployer sans les limites que lui imposent les frontières de l’État-nation. Cette politique consiste, selon Arendt, en « l’accumulation illimitée du pouvoir » et elle est fondée sur le racisme des États européens. Pour le comprendre, il nous faut étudier ce que signifie pour Arendt le fait que l’impérialisme soit d’abord un phénomène politique, déclenché à l’occasion de crises économiques.
C’est du domaine économique que l’impérialisme tire son originalité politique majeure dans la mesure où il fait entrer en politique un concept économique, celui d’expansion. « L’expansion en tant que but politique permanent et suprême est l’idée politique centrale de l’impérialisme ». En économie, l’expansion fait référence à « l’élargissement permanent de la production industrielle et des marchés économiques » : par « expansion » Arendt se réfère donc à la reproduction élargie du capital qui permet le processus d’accumulation du capital. Selon Arendt, le concept d’expansion, dans le domaine économique, correspond au caractère potentiellement illimité de la « croissance industrielle » car « les processus de production sont aussi illimités que la capacité de l’homme à produire pour le monde humain, à l’organiser, à le pourvoir et à l’améliorer ». Si l’impérialisme est un phénomène politique qui rend possible l’accumulation illimitée du capital, c’est parce qu’il consiste en la transposition de ce concept, propre au mode de production capitaliste, dans le champ politique. En d’autres termes, la logique de l’économie capitaliste informe la politique. C’est pourquoi, selon Arendt, « l’impérialisme doit être compris comme la première phase de la domination politique de la bourgeoisie bien plus que comme le stade ultime du capitalisme ». Selon Arendt, alors que jusque-là la bourgeoisie se contentait d’une domination économique, elle se tourne au cours du 19e siècle vers la politique et y apporte le concept économique d’« expansion » afin de protéger ses propres investissements à l’étranger. En effet, dit Arendt, avant l’expansion impérialiste, des capitaux individuels avaient déjà été exportés, mais cette exportation aboutissait à des scandales financiers et à des escroqueries : la bourgeoisie s’est donc tournée vers la politique pour protéger les capitaux des dérives auxquelles ils s’exposaient en étant laissés à eux-mêmes. Selon Arendt, la politique impérialiste est une politique bourgeoise qui permet à l’accumulation du capital de se déployer en toute sécurité : c’est en ce sens que l’expansion illimitée du pouvoir constitue la condition de possibilité de l’expansion illimitée du capital. Mais que signifie au juste que le concept d’« expansion » soit transposé en politique ?
La « politique de pouvoir » et le racisme des états-nations européens
En changeant de domaine, le concept d’« expansion » garde son caractère d’illimitation. Mais cette illimitation ne s’applique plus à l’accumulation du capital : elle s’applique désormais au pouvoir de l’État. Le concept d’« expansion » renvoie à une accumulation illimitée du pouvoir de l’État fondée sur l’annexion de territoires dans lesquels des investissements rentables des capitaux sont possibles. En raison de ce caractère d’illimitation, Arendt voit dans la politique impérialiste l’idée que « l’expansion est une fin en soi et non un moyen temporaire ». Selon cette logique, les annexions de territoires nouveaux ne sont pas des objectifs qui, une fois atteints, seraient comme les « points culminants » de la politique expansionniste : selon Arendt, ces annexions ne sont que le tremplin en vue de nouvelles annexions. Se met ainsi en place ce qu’Arendt appelle une « politique de l’expansion pour l’expansion ». Cette politique d’expansion illimitée du pouvoir de l’État se fonde sur l’exportation des institutions de violence d’État, la police et l’armée. Mais en étant transposées aux territoires occupés, ces institutions sont séparées du corps politique censé limiter et contrôler leur action : elles se mettent à jouer elles-mêmes le rôle de « représentants nationaux ». En ce sens, Arendt affirme que la politique impérialiste est une politique déterminée par la violence : c’est ce que l’autrice appelle la « politique de pouvoir (power politics) »69. En effet, « le pouvoir devint l’essence de l’action politique et le centre de la pensée politique lorsqu’il fut séparé de la communauté politique qu’il était supposé servir ».
Pour comprendre cette thèse, nous devons nous arrêter sur le concept de « pouvoir » (power). Son acception dans L’Impérialisme et, plus largement, dans Les origines du totalitarisme, est problématique si on pense à la signification qu’Arendt lui donnera par la suite dans La condition de l’homme moderne et dans Du mensonge à la violence (1972). En effet, dans Les origines du totalitarisme le concept de pouvoir fait référence à la violence et à l’arbitraire de la domination impérialiste et totalitaire, alors qu’aussi bien dans La condition de l’homme moderne que dans Du mensonge à la violence « le pouvoir correspond à l’aptitude de l’homme à agir, et à agir de façon concertée ». Cette plurivocité du concept de « pouvoir » dans l’œuvre d’Arendt a déjà été relevée par Marie-Claire Caloz-Tschopp et par Anne Amiel. En partant de problèmes différents, ces autrices arrivent à des conclusions assez proches : elles voient dans le concept de pouvoir de L’Impérialisme une annonce du type de domination qui sera à l’œuvre dans le totalitarisme. En particulier, Anne Amiel affirme que, dans L’Impérialisme, Arendt n’a pas encore tout à fait élaboré son « lexique conceptuel ». Selon Amiel, Arendt utilise donc le terme « pouvoir » « selon une acception assez lâche (…) et commune » pour désigner la domination du gouvernement bureaucratique impérialiste, que reprendra le totalitarisme. Ce gouvernement a un comportement arbitraire, agit hors de tout contrôle public et se perçoit comme un simple instrument du processus d’expansion. Tout en marquant notre accord avec cette lecture, nous ajouterons pour notre part que la « politique de pouvoir » est, pour Arendt, une politique dans laquelle le pouvoir est de part en part déterminé par la violence sans fin, c’est-à-dire par une violence sans finalité et sans limite. Dans Du mensonge à la violence, Arendt définit la violence comme « ce qui a un caractère instrumental ». En ce sens, la politique de pouvoir impérialiste est fondée sur la violence comme instrument, mais un instrument dépourvu de toute finalité extérieure. Autrement dit, cette violence n’existe que pour elle-même : elle est à la fois le moyen et la fin du pouvoir – elle se confond avec lui. C’est pourquoi selon Arendt la politique impérialiste provoque un bouleversement profond de la politique telle qu’elle existait jusque-là : l’impérialisme met en place une politique qui consiste dans le détachement de la violence d’État du réseau législatif et juridique qui lui donne sens. Ne reposant sur aucune loi, sur aucun autre principe que celui de l’expansion, la violence de la politique du pouvoir n’est pas seulement le moyen de cette politique mais aussi sa propre finalité. Pour cette raison, cette violence ne connaît aucune limite. Il s’agit en réalité une « violence inconvertible », celle des atrocités commises par les États européens sur les peuples des territoires envahis. Cette compréhension de la « politique de pouvoir » explique l’affirmation d’Arendt selon laquelle l’impérialisme de la fin du 19e siècle met en place une nouvelle conception du politique : celle de l’accumulation du pouvoir qui a la violence pour seul principe.
Cette violence sans fin de la politique de pouvoir se cristallise dans le racisme d’État qui se met en place avec l’impérialisme. La question du racisme d’Etat, chez Arendt, tient à sa compréhension des motifs de l’impérialisme comme motifs politiques. Alors que pour Rosa Luxemburg, ce sont les nécessités économiques qui poussent le mode de production capitaliste à mettre en place une politique impérialiste, Arendt complexifie cette thèse : l’économie de type capitaliste pose des problèmes politiques que la politique impérialiste tente de résoudre. À la fin du 19e siècle, deux problèmes qui sommeillaient dans les principes mêmes de la nation refont surface : une masse importante d’individus perd son enracinement dans la nation et est exposée de ce fait à la perte absolue de sa place dans le monde ; corrélativement, le conflit entre les classes s’aiguise. La conjoncture qui déclenche l’impérialisme nous renvoie donc à la critique arendtienne de la nation comme entité d’enracinement précaire. Nous l’avons vu, la précarité de l’enracinement dans la nation tient à ce que celle-ci n’offre pas une place matérielle à ses membres (qui restent donc expropriés) : dans la nation les individus n’ont de place qu’en tant qu’ils travaillent. Or, Arendt affirme, en suivant Marx, que la dynamique capitaliste produit systémiquement une population superflue. Chez Arendt, cette superfluité prend la forme, à la fin du 19e siècle, d’une population exclue du marché du travail qui, perdant la possibilité de recouvrer un travail, perd également son enracinement dans la nation. En ce sens, Arendt constate qu’alors qu’elle est fondée sur une définition de ses membres en tant qu’animales laborantes, la nation est pourtant incapable d’endiguer la dynamique capitaliste de production d’une population en trop. Aussi, une masse importante des membres de la nation deviennent « des ‘travailleurs sans travail’ […] incapables d’incarner ce par quoi ils ont été définis ». C’est pourquoi nous pouvions dire plus haut que l’enracinement de l’individu dans la nation n’est pas seulement précaire, mais qu’il est aussi provisoire : il ne dure que tant que la dynamique capitaliste de l’exclusion du marché du travail l’épargne. Ainsi, lorsque l’individu perd son travail, il perd son appartenance-au-monde et la nation est incapable de le « protéger ». Arendt remarque que l’apparition de cette population superflue n’est pas nouvelle : cependant, en cette fin du 19e siècle, sa présence est à ce point massive que le conflit entre les classes devient critique. « Tous les gouvernements sans exception savaient parfaitement que leurs pays étaient secrètement en train de se désintégrer, que le corps politique se détruisait de l’intérieur et qu’ils vivaient en sursis » : Arendt ne cesse d’insister sur le fait qu’avant l’impérialisme les structures politiques et sociales en Europe étaient sur un point de rupture. De ce fait « la cohésion même de la nation était en péril » car le sentiment national, garant de la préservation de l’unité de la nation, était affaibli face à la lutte des classes.
Selon Arendt, l’impérialisme fonctionne donc politiquement comme une « planche de salut », une « panacée facile pour tous les conflits » contre ces problèmes inhérents à la nation. « L’expansion (…) fut accueillie par conséquent comme un instrument de la politique nationale ». En tant qu’il représentait un intérêt matériel pour les nations européennes, l’impérialisme a fonctionné comme régénérateur de l’unité nationale. Ce fantasme de l’homogénéité des membres de la nation est inséparable du racisme étatique qui émerge avec l’impérialisme. Arendt consacre le deuxième chapitre de L’Impérialisme au fait que les supposées « races » avaient été théorisées bien avant l’impérialisme : pourtant, selon Arendt, leur violence extrême est devenue, avec l’impérialisme, un outil politique dont les effets sont internes et externes aux nations européennes. À l’intérieur des nations européennes, le racisme exalte l’idée d’une supposée « mission civilisatrice » européenne en Afrique. Cette « mission » donne vie au fantasme d’un destin commun aux membres des nations impérialistes en même temps qu’elle accorde une place dans le monde aux individus qui, superflus au sein de la nation, deviennent les émissaires de la politique impérialiste. De cette manière, la politique impérialiste accorde aux superflus de la reconnaissance ainsi qu’une place matérielle dans les territoires occupés. Aussi, cette politique régénère l’enracinement des individus dans la nation et exalte son unité. Ce faisant, la politique impérialiste parvient à escamoter le problème de la distribution inégalitaire de la richesse : en offrant une place aux superflus, elle la dissimule. C’est ce que montrent les références d’Arendt à la politique des partis impérialistes qui se déclarent « au-dessus » ou « au-delà » des partis, « dépassant la guerre des partis et des intérêts individuels », et se présentant comme des représentants de l’intérêt national. Cette insistance des impérialistes sur un supposé intérêt commun plus important que les conflits intérieurs à l’État explique « l’indifférence méprisante des politiciens impérialistes à l’égard des questions intérieures » : pour Arendt, l’impérialisme parvient ainsi, provisoirement, à mettre de côté la lutte des classes. À l’extérieur de la nation, dans les territoires occupés, l’exaltation du fantasme d’un lien fraternel, un lien de « sang » entre les membres de la nation, couplée à l’idée d’une « mission », donne lieu à un autre fantasme : celui de l’appartenance des nations européennes à une supposée « race supérieure » dont la mission autorise et justifie aux yeux des Européens les massacres et les exterminations des peuples considérés par la politique impérialiste européenne comme des « races inférieures ». Non seulement, donc, le racisme fantasme un lien et une mission qui régénèrent l’unité nationale, mais en outre, c’est par ce biais que la politique de pouvoir se met en place : le racisme d’État encourage et justifie l’extrême violence.
La pertinence théorique actuelle de l’idée arendtienne de l’accumulation illimitée du pouvoir
La politisation radicale des thèses luxemburgiennes à propos de l’accumulation primitive permet donc à Arendt de comprendre les causes et les mécanismes à l’œuvre dans la politique impérialiste. Notre travail a montré, en outre, que cette radicalisation des thèses luxemburgiennes à propos de la structure politique de l’accumulation capitaliste est le levier de ce qu’Arendt avance à propos du bouleversement de la condition humaine à la modernité – et donc aussi le levier de la compréhension arendtienne de la politique moderne. Aussi, par l’idée d’une accumulation illimitée du pouvoir, Arendt, lectrice de Luxemburg, ouvre la possibilité de penser la domination politique du capital autrement que dans le seul cadre des rapports entre le capital et le travail. Arendt perçoit, dès 1948, la thèse qu’ont avancée récemment des penseurs comme David Harvey, Étienne Balibar ou Emmanuel Terray : pour le dire dans les termes de ce dernier, le capitalisme ne doit pas seulement être pensé comme un système d’exploitation économique (thèse du marxisme orthodoxe), mais en tant que sa logique et son développement sont de part en part fondés sur des rapports de domination politique. D’où toute l’importance aujourd’hui de la lecture arendtienne des thèses de Luxemburg. Par la thèse de l’accumulation illimitée du pouvoir, Arendt parvient à montrer comment la politique impérialiste conditionne l’accumulation du capital, mais aussi engage un décrochage par rapport à ses propres finalités économiques. C’est ce qu’elle fait lorsqu’elle remarque que dans l’impérialisme la logique d’accumulation du pouvoir et son fondement raciste l’emportent sur la logique d’accumulation du capital : « les raisons du profit furent sacrifiées plus d’une fois aux exigences de la société de race, et bien souvent à un prix exorbitant ». Autrement dit, en montrant la force politique du racisme impérialiste, Arendt met en évidence que ce phénomène politique est étroitement lié à la logique capitaliste, mais qu’il reste irréductible à celle-ci dans la mesure où la politique raciste ne fonctionne pas selon les finalités propres à l’accumulation capitaliste.
Ce qu’Arendt a à l’esprit dans cette étude du racisme impérialiste, c’est bien sûr la mise au jour des méthodes qui, nées dans le contexte des politiques impérialistes européennes, seront des pièces centrales du totalitarisme en Europe. Les thèses d’Arendt sur l’accumulation illimitée du pouvoir ont une double fonction dans la théorisation de la domination raciste : d’une part, comprendre la genèse du racisme étatique ; d’autre part, montrer l’intériorisation des méthodes impérialistes au sein des nations européennes. En ce sens, L’Impérialisme, malgré son ethnocentrisme et son ignorance manifeste de l’Afrique désormais établis, peut constituer un outil théorique pertinent dans le domaine des postcolonial studies. De même, l’idée de l’accumulation illimitée du pouvoir pourrait être mobilisée dans le contexte de recherches féministes à propos d’autrices – comme Silvia Federici – qui montrent comment la domination patriarcale, qui n’est pas née avec le capitalisme, a pourtant fonctionné aussi comme une de ses conditions de possibilité.