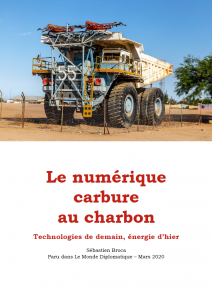
Lien vers la brochure en pdf : Le numérique carbure au charbon
Lien vers l’article : Le monde diplomatique
Texte de la brochure :
Partenariats des géants de l:a Silicon Valley avec l’industrie pétrolière, consommation massive d’énergie et de ressources : contrairement à ce qu’on a longtemps affirmé, l’économie numérique n’est ni « immatérielle » ni « verte ». Elle produit des dommages écologiques importants, dont les conséquences sont très inégalement réparties à la surface du globe.
C’est l’histoire d’un ingénieur de Microsoft que son employeur envoie à Atyraou, sur le plus grand site pétrolier du Kazakhstan, exploité par Chevron en partenariat avec l’État kazakh. Là, il participe à un séminaire sur la manière dont l’intelligence artificielle et l’informatique en nuage (cloud computing)[1] peuvent rendre l’industrie pétrolière plus efficace. Devant des cadres dirigeants qui ne comprennent pas grand-chose au jargon dont il les abreuve, il joue, en se forçant un peu, la partition que Microsoft lui a demandé d’interpréter. Les enjeux sont importants. En 2017, Chevron a signé avec l’entreprise fondée par M. Bill Gates un partenariat de sept ans, afin d’en faire son fournisseur de services à distance. Depuis cette date, Microsoft stocke et analyse les téraoctets de données que recrachent chaque jour les puits de pétrole couverts de capteurs. À Atyraou, le séminaire prend toutefois un tour un peu inattendu. Les cadres de Chevron questionnent l’ingénieur sur la possibilité d’installer des outils de surveillance sophistiqués, qui permettraient de détecter algorithmiquement les comportements suspects parmi les travailleurs du site ou d’analyser leurs courriers électroniques personnels ! À son retour aux États-Unis, il a le sentiment d’avoir vécu une « expérience surréaliste », où « toutes les personnes présentes discutaient, l’air de rien, de la mise en place d’un dispositif panoptique de surveillance au travail ». Il décide alors de raconter son séjour dans un long article[2].
Depuis quelques années, les rapprochements entre les principaux acteurs du capitalisme numérique et les grandes compagnies pétrolières se multiplient. Amazon a créé le service d’informatique en nuage AWS Oil and Gas Solutions, financé des conférences de l’industrie pétrolière et recruté de nombreux experts en intelligence artificielle spécialisés dans les applications au secteur de l’énergie. Google a de son côté signé des accords avec Total, Anadarko et Nine Energy Service, tout en lançant sa division Oil, Gas and Energy au sein de Google Cloud. Quant à Microsoft, il a conclu des partenariats non seulement avec Chevron, mais également avec BP, Equinor et Exxon.
Ces alliances sont dues aux perspectives ouvertes par les données de masse (big data) et par l’intelligence artificielle. L’industrie pétrolière compte sur ces technologies pour localiser plus précisément les réserves et réduire ses coûts grâce à l’automatisation. Les géants du numérique y voient de leur côté un marché juteux pour leurs services de stockage et de traitement de données, mais aussi pour leurs solutions d’apprentissage automatique (machine learning). Seule ombre au tableau : ces partenariats font tache alors que les services de communication rabâchent l’engagement sans faille de la Silicon Valley en faveur des énergies renouvelables. Sommé par certains de ses salariés de renoncer à toute collaboration avec l’industrie pétrolière, le fondateur d’Amazon, M. Jeff Bezos, expliquait en septembre 2019 qu’il ambitionnait d’apporter à l’industrie pétrolière les « meilleurs outils possibles » pour effectuer sa « transition »[3]. Stopper la dépendance aux combustibles fossiles en aidant les principaux fournisseurs à rendre leurs affaires plus profitables : il fallait effectivement y songer.
Ravages de l’« Internet des objets »
Si l’extraction du pétrole et celle des données constituent les deux faces d’une même pièce, c’est en réalité toute l’opposition entre le capitalisme thermo-industriel né au XIXe siècle et un capitalisme numérique prétendument « immatériel », « postindustriel » ou « vert » qu’il faut remettre en question. « L’informatique en nuage commence avec le charbon », affirmait en 2013 un rapport du consultant Mark P. Mills, financé par… l’industrie minière[4]. Nos sociétés numériques poursuivent en effet une trajectoire historique entamée il y a deux siècles au Royaume-Uni avec l’exploitation à grande échelle du charbon. Depuis, la consommation mondiale de ce combustible n’a cessé d’augmenter, malgré l’addition progressive d’autres sources d’énergie primaire : gaz naturel, pétrole, nucléaire, solaire, etc.[5]. Selon l’Agence internationale de l’énergie, l’utilisation du charbon, tirée par la Chine, l’Inde et l’Asie du Sud-Est, ne devrait pas décliner ces prochaines années[6].
De manière générale, la consommation énergétique mondiale croît toujours (+ 2,3 % en 2018), et elle découle encore à plus de 80 % des énergies fossiles[7]. La quantité d’énergie nécessaire pour produire de l’énergie croît également, à mesure que sont exploités des gisements de plus faible qualité ou des hydrocarbures dits « non conventionnels », comme les sables bitumineux. Ainsi, ce que les spécialistes appellent le « taux de retour énergétique » ne cesse de décliner. Alors que, « il y a un siècle, il fallait en moyenne un baril de pétrole pour en extraire cent, aujourd’hui, le même baril n’en produit, dans certaines zones de forage, que trente-cinq [8]».
Certes, l’économie numérique n’est pas seule en cause, mais elle participe grandement au maintien de cette trajectoire funeste. Selon deux rapports récents, elle représente plus de 4 % de la consommation d’énergie primaire au niveau mondial, et cette consommation augmente de 9 % par an, à mesure que les pays émergents s’équipent et que les usages se diversifient[9]. C’est la fabrication des terminaux et des infrastructures de réseaux qui pèse le plus lourd dans ce bilan, suivie par la consommation des équipements, du réseau et des fermes de serveurs (data centers). La construction d’un ordinateur portable émet ainsi environ 330 kilogrammes d’équivalent CO2, tout en nécessitant énormément d’eau et de matières premières, notamment des métaux comme le palladium, le cobalt ou les terres rares. Le fonctionnement des data centers génère à lui seul 19 % de l’empreinte énergétique totale du numérique.
Le simple visionnage en ligne de vidéos, qui sont stockées au sein de ces gigantesques infrastructures matérielles, aurait engendré en 2018 autant de gaz à effet de serre qu’un pays comme l’Espagne. En effet, si Apple et Google se targuent d’opérer avec 100 % d’énergies renouvelables, c’est loin d’être le cas du principal acteur de l’informatique en nuage, Amazon. Selon un rapport de Greenpeace, son gigantesque centre de traitement en Virginie, où transite environ 70 % du trafic Internet mondial, en intègre seulement 12 %. Il bénéficie notamment de l’électricité bon marché produite grâce au charbon des Appalaches, extrait en écrêtant à l’explosif le sommet des montagnes avoisinantes… En Chine, c’est 73 % de l’énergie consommée par les data centers qui provient toujours du charbon[10]. Ces chiffres peuvent inquiéter lorsqu’on sait l’explosion prévisible de la quantité de données dans les années à venir, conséquence de la prolifération attendue des objets connectés.
Plus fondamentalement, les technologies sur lesquelles repose le capitalisme numérique ont été conçues sans tenir compte de l’impératif écologique. Le champ de l’intelligence artificielle en offre un exemple édifiant. Une étude de l’université d’Amherst (Massachusetts) a montré qu’un projet standard d’apprentissage automatique émet aujourd’hui, pendant l’ensemble de son cycle de développement, environ 284 tonnes d’équivalent CO2, soit cinq fois les émissions d’une voiture de sa fabrication jusqu’à la casse[11]. Comme le relève le chercheur Carlos Gómez-Rodríguez, « la majorité des recherches récentes en intelligence artificielle négligent l’efficacité énergétique, parce qu’on s’est aperçu que de très grands réseaux de neurones [plus énergivores] sont utiles pour accomplir une diversité de tâches, et que les entreprises et les institutions qui ont accès à d’abondantes ressources informatiques en tirent un avantage concurrentiel[12] ». Autrement dit, les géants de la technologie n’ont guère intérêt à mettre au point des méthodes plus sobres.
Ils n’ont pas davantage intérêt à ce que leurs utilisateurs adoptent des comportements écologiques. Leur prospérité future nécessite que chacun s’habitue à allumer la lumière en parlant à une enceinte connectée, plutôt qu’en appuyant sur un bête interrupteur. Or le coût écologique de ces deux opérations est loin d’être équivalent. La première nécessite un appareil électronique sophistiqué muni d’un assistant vocal dont le développement a consommé énormément de matières premières, d’énergie et de travail[13]. Prôner simultanément l’« Internet des objets » et la lutte contre la crise climatique est un non-sens : l’augmentation du nombre d’objets connectés accélère tout simplement la destruction de l’environnement. Et les réseaux 5G devraient doubler ou tripler la consommation énergétique des opérateurs de téléphonie mobile dans les cinq prochaines années.
Considéré sous l’angle écologique, le capitalisme numérique ne se réduit ni aux mastodontes de la Silicon Valley ni au milieu des start-up. Il constitue plutôt une « économie-monde », au sens que l’historien Fernand Braudel donnait à ce terme : un ensemble cohérent d’acteurs économiques dont les relations sont structurées par une division entre centres et périphéries. La baie de San Francisco en est le cœur, et sa prospérité découle largement des relations asymétriques qu’elle entretient avec des espaces dominés, des mines de coltan africaines aux usines d’assemblage asiatiques en passant par les dépotoirs électroniques ghanéens. Dans ce système, les processus industriels engendrent des coûts écologiques inégalement répartis. Ainsi les injustices environnementales prennent-elles la forme d’un échange écologiquement inégal, déclinaison de l’« échange inégal » théorisé notamment par l’économiste marxiste Arghiri Emmanuel dans les années 1960 : derrière l’apparente équité de l’échange monétaire, l’économie-monde capitaliste repose sur des transferts asymétriques de ressources naturelles entre centres et périphéries[14]. Quand une entreprise du Nord achète pour 1 000 dollars de matières premières et lorsqu’une entreprise du Sud paye 1 000 dollars de droits de propriété intellectuelle, les valeurs monétaires sont identiques, mais les impacts sur la nature ne le sont pas, car les centres externalisent les conséquences environnementales de leur développement.
Le capitalisme numérique illustre parfaitement cette logique. La fabrication des ordinateurs et des téléphones portables absorbe à elle seule 23 % de la production mondiale de cobalt et 19 % des métaux rares[15]. Or le cobalt provient majoritairement de la République démocratique du Congo, où il est souvent extrait par des enfants dans des zones de conflit, au mépris des droits humains et de l’environnement[16]. Quant aux terres rares, la Chine domine leur production mondiale, mais au prix de pluies acides et d’une contamination aux métaux lourds de ses terres arables et de ses réserves en eau. Le journaliste Guillaume Pitron résume la situation : « Les Chinois et les Occidentaux se sont tout bonnement réparti les tâches de la future transition énergétique et numérique : les premiers se saliraient les mains pour produire les composants de la green tech, tandis que les seconds, en les leur achetant, pourraient se targuer de bonnes pratiques écologiques[17]. » Le fonctionnement de l’économie-monde numérique n’abolit pas les limites écologiques : il les déplace.
[1] Stockage et traitement des données d’un client sur les serveurs distants d’un prestataire spécialisé.
[2] Zero Cool, « Oil is the new data », Logic, n° 9, San Francisco, 7 décembre 2019.
[3] Cité par David McCabe et Karen Weise, « Amazon accelerates efforts to fight climate change », The New York Times, 19 septembre 2019.
[4] Mark P. Mills, « The cloud begins with coal » (PDF), Digital Power Group, New York – Washington, DC, août 2013.
[5] Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’Événement anthropocène, Seuil, coll. « Anthropocène », Paris, 2013.
[6] « Coal 2019. Analysis and forecasts to 2024 », IEA, Paris, 2019.
[7] Christopher J. Rhodes, « Endangered elements, critical raw materials and conflict minerals », Science Progress, vol. 102, n° 4, Thousand Oaks (Californie), 2019.
[8] Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares. La face cachée de la transition énergétique et numérique, Les Liens qui libèrent, Paris, 2018.
[9] Frédéric Bordage (sous la dir. de), « Empreinte environnementale du numérique mondial » (PDF), GreenIT.fr, octobre 2019 ; Maxime Efoui-Hess (sous la dir. de), « Climat : l’insoutenable usage de la vidéo en ligne », The Shift Project, Paris, juillet 2019.
[10] Naomi Xu Elegant, « The Internet cloud has a dirty secret », Fortune, New York, 18 septembre 2019.
[11] Cité dans Karen Hao, « Training a single AI model can emit as much carbon as five cars in their lifetimes », MIT Technology Review, Cambridge (Massachusetts), 6 juin 2019.
[12] Emma Strubell, Ananya Ganesh et Andrew McCallum, « Energy and policy considerations for deep learning in NLP » (PDF), 57es rencontres de l’Association for Computational Linguistics, Florence, juillet 2019.
[13] Kate Crawford et Vladan Joler, « Anatomy of an AI System », AI Now Institute & Share Lab, université de New York, 7 septembre 2018.
[14] Alf Hornborg, Nature, Society, and Justice in the Anthropocene : Unraveling the Money-Energy-Technology Complex, Cambridge University Press, 2019.
[15] Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, op. cit.
[16] Annie Kelly, « Apple and Google named in US lawsuit over Congolese child cobalt mining deaths », The Guardian, Londres, 16 décembre 2019.
[17] Guillaume Pitron, La Guerre des métaux rares, op. cit.
